Ecrit-dicté en 53 jours, ce gros roman en deux livres et 28 chapitres est l’acmé de Stendhal. Primesaut, généreux, tout de mouvement, il est la vie même. Dans ce siècle bourgeois où, après l’épopée napoléonienne, les Français deviennent compassés et bienséants, Henri Beyle se moque de la moraline pour placer le désir égotiste en premier. Foin du devoir social, le plaisir personnel avant tout.
Ce pourquoi il invente une Italie princière où l’aristocratie survit comme à la Renaissance. Le Prince et son Machiavel se divertissent en salon de duchesse, tandis que le bas peuple se réjouit des fêtes et des intrigues dont les rumeurs parviennent jusqu’à lui par l’intermédiaire des valets et cochers. Dans cette « utopie », pourrait-on dire, l’auteur place des personnages qu’il aime et auxquels il donne de forts caractères.
Fabrice est le béjaune cueilli à 16 ans – cet âge où l’adolescent devient plat, disait l’auteur dans Lisimon – pour lui faire chevaucher en fugue vers Waterloo, rejoindre ce Napoléon qu’il admire et qu’il ne verra que de loin. En passant par Paris, il perd son pucelage lors d’une « orgie » (I.2 p.169 Pléiade), ce qui accentuera son inclination naturelle envers les femmes. Ce sont elles qui le feront homme, puis héros, puis grand d’Eglise, avant de le perdre par l’amour. Car cet attrait qui mêle sexe, sentiment et admiration a son revers : lubricité, attachement et déraison. Fabrice dont le désir est par-delà le bien et le mal, aristocrate empli de jeune énergie qui définit ses propres valeurs, est pris à son jeu. Egotiste plutôt qu’égoïste, car son plaisir n’existe que lorsqu’il en donne aux autres, il se moque des convenances et des devoirs civiques – sinon d’être aimable et reconnaissant à ceux qui l’aiment.
Fils cadet d’un père déchu, frère d’un aîné qui le dénonce à la police pour être « libéral » (jacobin) dans un régime despotique, Fabrice est adulé par sa tante Gina del Dongo qui n’a pas d’enfant. Elle sort dans le monde le prime adolescent beau comme un Corrège pour lui éduquer le goût. Car Fabrice apprécie peu les livres, ne connait à 18 ans « pas même le latin, pas même l’orthographe », avoue-t-il (I.6 p.251 Pléiade) – il n’étudie que ce qu’il faut ; il ne préfère rien tant que chevaucher les destriers comme les donzelles. Mais il a « un courage si simple et si parfait, que l’on peut dire qu’il ne s’en aperçoit pas lui-même », dit sa tante (II.16 p.400 Pléiade). La règle qu’elle lui donne pour arriver à l’école comme dans l’Eglise ou ailleurs est simple : « Crois ou ne crois pas ce qu’on t’enseignera, mais ne fais jamais aucune objection. Figure-toi qu’on t’enseigne les règles du jeu de whist ; est-ce que tu ferais des objections aux règles du whist ? » (I.6 p.251 Pléiade). Tout l’art d’être bon élève, conforme aux codes sociaux, est dans cette règle minimale : il s’agit de faire semblant, tout en gardant son quant à soi.
Angelina-Cornelia-Isota Valserra del Dongo sera comtesse Pietranera, duchesse Sanseverina avant de redevenir comtesse Mosca, selon ses maris successifs. Elle est éprise de son neveu (après l’avoir été de son père biologique à 13 ans) mais sa passion est exaltation de cœur et d’âme plus qu’envie ailleurs. Fabrice, lui, ne tombe jamais amoureux – dans le premier livre : « j’aime sans doute, comme j’ai bon appétit à 6 heures ! » (I.13 p.336) ; « la nature m’a privé de cette sorte de folie sublime » (I.7 p.273). Il est seulement « léger et libertin » (II.22 p.490 Pléiade), ce qui est le meilleur de « l’amour » dont l’enflure romantique agacera Flaubert sous le terme d’Hâmour. Ce n’est qu’à 25 ans et après 9 mois de forteresse (comme une gestation de maturité) qu’il fixera son désir sur Clélia, qu’il a rencontré lorsqu’elle avait 15 ans et lui 17. Elle est la seule femme accessible à son regard dans la prison où il enfermé par une traîtrise du prince. L’esprit suivra le cœur qui suit lui-même le désir : c’est ainsi que l’on tombe amoureux, de bas en haut et non l’inverse.
Mais la nature reprend ses droits, dans une ellipse typiquement stendhalienne pour dire que l’acte est consommé : « Elle était si belle, à demi vêtue et dans cet état d’extrême passion, que Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne lui fut opposée » (II.25 p.543 Pléiade). Il suggère plus tôt que Fabrice, « à peine âgé de 16 ans » (I.2 p.165 Pléiade), a contenté la geôlière de la prison de B*** (Beaumont en Belgique ?) où il a passé 33 jours pour avoir été soupçonné d’être espion : « Le lendemain, avant l’aube, cette femme tout attendrie dit à Fabrice… » (I.2 p.171 Pléiade). L’attendrissement du cœur est révélateur du contentement du corps…
La figure de la duchesse Sanseverina est égale dans le roman à celle de Fabrice. Cette mère de substitution, passionnée et possessive, d’une féminité toute méditerranéenne, entretient le roman dans une atmosphère d’ébriété érotique à l’italienne où le paraître et la sociabilité constituent une aventure de chaque instant. Elle fait du jeune libertin un ecclésiastique, de Fabrice rêvant d’être soldat à Waterloo un évêque rentier qui ne peut se marier, gardant pour elle toute seule ce neveu trop chéri. Sauf que le prince la trahit et que le jeune homme, qui a tué en se défendant d’un coquin amant jaloux, est bouclé en citadelle comme Alexandre Farnèse jadis (futur pape Paul III) pour un semblable duel. Alexandre s’évadera à l’aide d’une corde, ce qu’imitera Fabrice poussé par la duchesse et forcé par Clélia, fille du général geôlier. Mais Fabrice est tombé réellement amoureux de Clélia, bien qu’elle ait juré à la Madone d’épouser un marquis sur les ordres de son père s’il ne meurt pas. Sorti de prison, Fabrice y revient volontairement pour voir Clélia, au risque du poison – ce qui arrangerait tout le monde. C’est faire bon marché de la Sanseverina qui fait empoisonner d’abord le prince par un exalté amoureux d’elle et de la république, puis séduit son fils héritier afin de sauver son neveu.

Le Corrège, L’Education de l’Amour (détail), illustration de Fabrice et de son fils Sandrino avec Clélia
Mais à trop vouloir garder pour elle le jeune homme, elle gâche tout. Fabrice est lié à Clélia, qu’il a prise dans un transport et dont il a un fils, Sandrino (le petit Alexandre), considéré comme l’aîné du marquis époux. Son propre père ne l’a jamais aimé (il n’est d’ailleurs pas son vrai père… qui serait le lieutenant français Robert, de l’armée de l’empereur dont la duchesse était amoureuse à 13 ans). Fabrice veut à l’inverse aimer et éduquer ce fils conçu par hasard. Être fils d’évêque n’avait rien d’étonnant pour les catholiques italiens, même si cela se passait plutôt dans les siècles précédant le XIXe. Mais cette embrouille ne pouvait être clarifiée sans un autre volume, et l’auteur préfère une fin rapide. Ce n’est pas dévoiler un secret de dire que tout le monde meurt au final – car nous sommes au siècle romantique même si Stendhal a un style plutôt de Code civil (comme Napoléon) et des exaltations, en pleine nature, moins panthéistes que celles de Rousseau.
A cette histoire d’amours mêlés (le paternel, le maternel, le sexuel) s’ajoute une intrigue politique de grand art. Lorsque j’ai lu ce livre pour la première fois, vers 16 ans, cela a décidé de mon goût pour l’analyse politique et orienté mes études. Car le Machiavel du prince de Parme s’appelle Mosca (la mouche) et il est d’une grande subtilité dans la conduite des affaires de la cité. Le prince ne peut se passer de lui, malgré son pouvoir absolu, et les opposants sont tous inférieurs malgré leur « libéralisme » (au sens des libertés politiques du XVIIIe siècle). Pas plus Mosca que Stendhal n’aiment la démocratie ni « la canaille » ; l’exemple américain est pour Stendhal le summum de l’avilissement : « le culte du dieu dollar, et ce respect qu’il faut avoir pour les artisans de la rue, qui par leurs votes décident de tout » (I.6 p.250 Pléiade). La politique mérite mieux que le nivellement par les envies et le vote des ignares. Ce pourquoi la description de la société de cour et ses intrigues est ciselée avec « esprit, profondeur et concision », comme le dira Balzac, qui « trouve cette œuvre extraordinaire » (p.622 Pléiade). Le comte Mosca sait que la politique n’est pas un combat « moral » entre le bien et le mal mais un choix provisoire et de circonstance entre le préférable et le pire. Mosca le ministre, c’est Stendhal le diplomate ; Mosca l’amoureux de la duchesse (qui deviendra sa femme), c’est Beyle amoureux. Et Fabrice est le fils inventé qu’il n’aura jamais eu.
Stendhal, La chartreuse de Parme, 1839, Garnier-Flammarion 2009, 687 pages, €4.50
Stendhal, Œuvres romanesques complètes tome 3, Gallimard Pléiade 2014, 1498 pages, €67.50
Les œuvres de Stendhal chroniquées sur ce blog

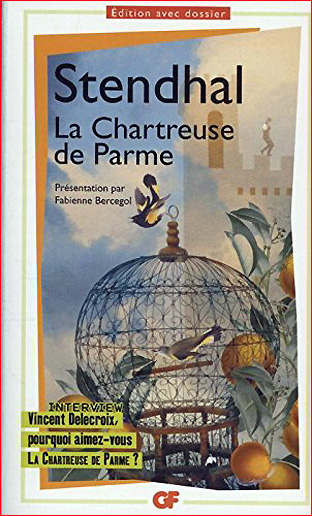

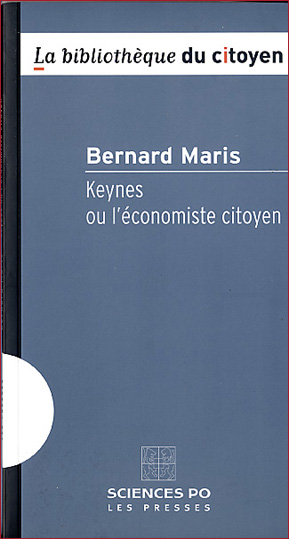

Commentaires récents