
Deux nouvelles tirées de faits vécus mais dans un décor imaginaire et dans un temps indéfini. Colette se recycle ; durant l’Occupation, elle s’occupe. Partant de petites anecdotes ou personnages rencontrés, elle en brode tout un roman, ou plutôt de longues nouvelles. Elle en publie ici deux dont le thème est l’amour. Colette est spécialiste de l’amour sous toutes ses formes, pour les avoir expérimentées durant sa longue existence (elle a alors 67 ans).
Chambre d’hôtel décrit la rencontre d’un couple dans un hôtel de repos à la montagne, à « X-les-Bains », un lieu qu’elle a fréquenté en Isère à la Belle époque (au vrai Uriage). Ce couple est « insignifiant », écrit-elle dès les premiers mots, mais s’attache au passant comme un « anatife », « mollusque à cordon extensible » qui la « dégoûte ». Elle se fascine cependant pour la vie des bêtes, Madame Haume en phase précoce de tuberculose et son mari Gérard, fils de famille raté qui entretient des liaisons. Si elle se trouve dans l’hôtel, c’est que Lucette, une copine de music-hall un brin pute de la haute, a loué un chalet à X-les-Bains avec son jeune amant Luigi mais qu’elle a, pour la même période, trouvé un nouvel amant bourré de diamants qui l’emmène sur son yacht. Le chalet est donc libre. Mais la narratrice le trouve trop petit-bourgeois pour elle et préfère l’hôtel. D’où la rencontre de hasard.
Dès lors, les différentes formes de « l’amour » vont se contraster. Celui de Lucette pour Luigi est pur mais soumis à condition de moyens ; celui de Lucette pour le nouvel amant (après bien d’autres) n’est qu’utilitaire, comme on « aime » ce qui vous nourrit. L’amour du couple Haume est classique, usé par l’habitude et abîmé par la maladie, mais cette faiblesse est ce qui retient Gérard de quitter sa femme pour courir l’aventure. Outre qu’il n’a guère de moyens, ayant ruiné pour partie l’entreprise familiale que son frère peine à redresser, ne lui assurant qu’une pension juste à condition qu’il ne s’en mêle plus. D’où sa recherche d’aventure ailleurs. Il entretient une jeune maîtresse à Paris mais s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Forcé par la maladie de sa femme de prolonger son séjour à la montagne avec elle, il voudrait y aller voir. Il s’y trouve même une autre sorte « d’amour » qui est la séduction sans le vouloir des très jeunes filles pubères de 14 ans qui flirtent innocemment avec les hommes adultes de l’hôtel, suscitant le désir interdit. « Miss Morphy » a un nom qui suggère à la fois le dieu qui endort, le papillon aux ailes bleues qui séduit et le joueur d’échec Paul qui pose ses pions.
C’est alors que la narratrice, sous la forme de Colette dans une situation semblable, propose de porter un message à la belle puisqu’elle doit se rendre à Paris pour signer un contrat pour un nouveau spectacle. Ce qu’elle trouve, c’est l’oiseau envolé, l’appartement vide et à louer. La belle a quitté l’amant trop lointain pour un autre sans laisser d’adresse. Effondrement du Gérard, mais c’est le jeu : il n’y a pas d’amour mais que des preuves d’amour, qui va à la chasse perd sa place. C’est alors que Lucette revient de son aventure avec le riche à diamants ; elle est meurtrie, blessée, sans un. Elle use donc du chalet puisque la location dure encore et Luigi va chercher du travail alentour. Gérard la rencontre parce que Colette lui en a parlé, et Lucette joue l’anatife pour se trouver une nouvelle tirelire… avant de mourir de sa blessure mal soignée. Conclusion de ces péripéties ? L’amour véritable a peu à voir avec ce que « nous » appelons en société « l’amour », réduit le plus souvent comme il est montré au sexe et au fric.
La lune de pluie est plus bizarre. L’histoire se passe à Paris, lorsque Colette fait taper ses manuscrits à livrer en feuilletons aux journaux par une vieille fille consciencieuse. Laquelle habite un ancien appartement de Colette, d’où le sentiment particulier qu’elle ressent lorsqu’elle s’y rend (au vrai, le 28 rue Jacob). Elle s’y trouve comme chez elle, les nouveaux locataires sont comme des intruses.
Car la vieille fille a recueilli sa jeune sœur, mariée mais séparée volontairement, ayant « chassé » son mari Eugène pour on ne sait quelle futilité. Elle s’est mise à le haïr et use de procédés superstitieux pour lui faire avoir du mal, comme de répéter à l’infini son nom pour que les oreilles lui tintent, et autres billevesées de bonne femme oisive, très petite-bourgeoise et cancanière. Le mari Eugène, que Colette croise en bas de l’immeuble où il regarde la fenêtre de son épouse, est en mauvaise santé, fumant et bouffant trop. Il mourra à la fin et son ex s’en fera gloire, comme si sa haine avait opéré sur le physique.
Il y a donc, là encore, trois amours : celui, filial, de la sœur aînée pour sa cadette, sentiment profond mais qui fait excuser trop de mauvaiseté de celle qui se laisse aimer ; celui, marital, de la femme qui ne veut plus voir son mari et qui s’est inversé en haine tenace ; celui enfin de la pureté initiale, où le mari aimait plutôt la sœur aînée avant de jeter son dévolu sur la cadette. En bref un gâchis : l’amertume de la délaissée, la haine de la choisie, la faiblesse de l’aînée pour la cadette. Rien de cela ne donne envie…
Il semble que tout cela soit un peu compliqué pour notre époque, le livre n’est pas réédité et aucun film n’a été tourné sur ces histoires d’amours contrastés. Colette, d’ailleurs, les conte avec détachement, sans ces notations précises ou sensuelles sur la vie alentour qui la caractérisent, comme si elle accomplissait la besogne d’écriture pour seules raisons alimentaires, sans y mettre son cœur.
Colette, Chambre d’hôtel suivi de La lune de pluie (nouvelles), 1940, Livre de poche 2004, 157 pages, €7,70, e-book Kindle €4,99
Colette, Œuvres tome 4 (1940-54), Bibliothèque de la Pléiade 2001, 1589 pages, €76,00



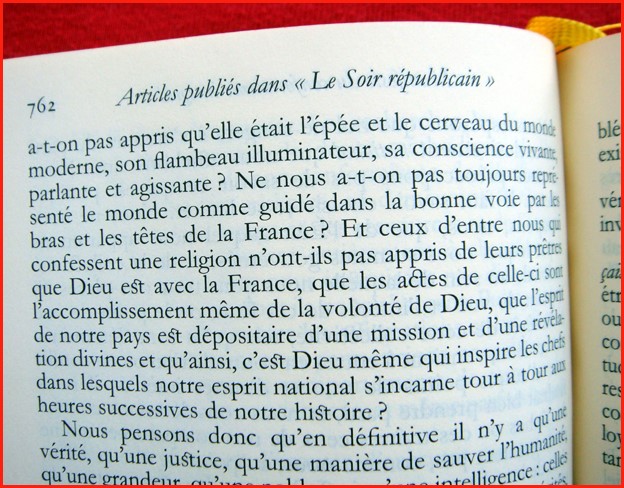
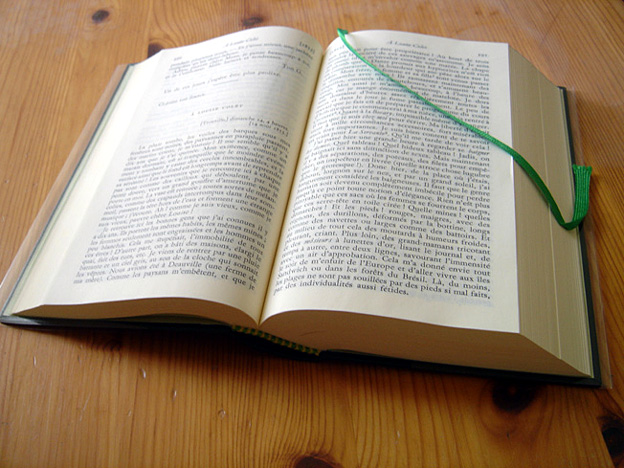
Commentaires récents