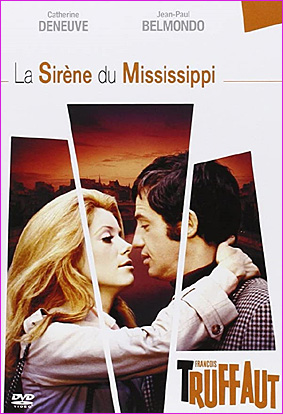
La sirène ici n’a rien du clairon ni le Mississippi du grand fleuve qui roule ses eaux aux Amériques. La sirène est une femme, diabolique, qui envoûte les marins pour les attirer dans ses eaux – où ils se noient. Catherine Deneuve joue le rôle en sourdine, se contentant d’être là, sirène maléfique plus encore parce qu’elle n’en fait pas trop et plutôt moins. Le Mississippi est ce bateau des Messageries maritimes qui amène de France les passagers pour la Réunion, la grande île au tabac où un homme seul, propriétaire cigarettier, amoureux malheureux après la mort de sa première femme, désire une rencontre. Jean-Paul Belmondo est bon dans le rôle du mâle pris dans les rets d’une intrigante sans scrupules ; il est à la fois naïf et patriarcal, donc roulé dans la farine des sentiments.

1969 n’était pas cette « année érotique » chantée par Gainsbourg mais cet entre-deux des Trente glorieuses où la reconstruction d’après-guerre et le baby-boom avaient rendu les gens optimistes en même temps qu’ils faisaient craquer les gaines sociales. Ainsi le mariage, cérémonie obligée pour coucher ensemble devant tous, avec son corollaire de soumission de la femme et du rôle de chef de famille du mari. Le film subvertit l’institution en innovant la rencontre par petites annonces puis en rendant l’homme dépendant de la femme, celle-ci égoïste à mort et profitant de la bénévolence du mari pour vider ses comptes, y compris ceux de sa société, avant de disparaître. L’amour, revivifié romantique par cette incertitude nouvelle du lien, est vécu comme absolu par le mâle musclé (pas encore bouffi de gonflette à l’américaine) – tandis qu’il n’est qu’une façon d’arriver à ses fins pour la femelle séduisante, capricieuse et perverse qui joue de son corps depuis l’âge de 14 ans et a connu de multiples coucheries et plusieurs avortements.


Choc des conceptions que ce mari à l’antique et cette coureuse de dot. Lui rêve d’un couple idéal dans la grande maison coloniale ; elle d’un coup de maître pour ramasser du fric et vivre ensuite la belle vie. Les liens contre la liberté. Ils vont se marier, se démarier, se provoquer, se retrouver. Elle va lui mentir, le voler, se remettre avec lui en acceptant qu’il la tue, ce qu’il ne peut faire car elle est « trop belle », il va tuer pour elle ce détective (Michel Bouquet) qui la traque sur commande de lui-même et de la sœur pour avoir éliminé sa rivale, il va s’embarquer en cavale, se ruiner, se faire empoisonner avant que… happy end ? Pas sûr. Une fin aussi absurde que cet amour diabolique qui n’a guère du nom d’amour que l’aura romantique qui subsiste dans les cœurs. Peut-on « aimer » une archi égoïste qui ne pense qu’à ses fesses (charmantes, prolongée par des jambes fines gainées de fil), son manteau (cher et hideux) et ses goûts de nouvelle riche (la voiture américaine rouge vif qui en jette) ? On ne peut qu’être sous emprise, hypnotisé, envoûté. La beauté est une souffrance, l’amour un calvaire, l’attachement une expiation en vain. Sa femme est une sorcière – d’autant que Marion n’est pas légalement sa femme Julie, puisque ayant usurpé une autre identité.


Comme dans le roman de William Irish dont est tiré le scénario, la fausse Julie a fait tuer la vraie par son amant Richard, qui l’a passée par-dessus bord, avant d’endosser son identité, de prendre ses papiers et sa malle, et d’apparaître plus jolie que sur la photo. Elle a accepté avec joie les comptes-joints proposés par son nouveau mariche (mari riche) avant de les assécher un vendredi soir, un quart d’heure avant la fermeture de la banque, et de fuir aussitôt en métropole. Où Richard s’est accaparé tout l’argent (27 millions et demi de francs 1969) avant de s’évaporer, forçant la fausse Julie et vraie Marion à nouveau sans un à jouer les entraîneuses dans une boite de nuit toute neuve d’Antibes. Où le gogo épris la retrouve par hasard, ayant vu un reportage aux nouvelles télévisées dans la clinique où il se repose de sa blessure amoureuse (et d’amour-propre). Ne pouvant se venger en l’éliminant, comme il en avait l’intention, il succombe aux charmes vénéneux de la fausse innocence en Eve mâle devant le serpent femelle.


Truffaut en rajoute comme à son habitude sur l’enfance malheureuse en excuse de l’égoïsme forcené de la pute qui profite de sa jeunesse et de ses charmes – tout-à-fait dans le vent post-68. Il laisse le doute pour la fin : Marion-Julie va-t-elle une fois de plus jouir de la bêtise de son beau mâle ou est-elle véritablement touchée (pour la première fois dans sa vie) par l’amour inconditionnel de quelqu’un pour elle ?
DVD La sirène du Mississippi, François Truffaut, 1969, avec Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Michel Bouquet, MGM United Artists 2008, 1h55, €15,39 blu-ray €43,99




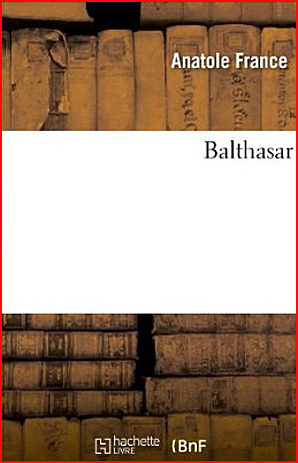
Commentaires récents