Tout va mieux aujourd’hui. La nuit a été très humide, probablement la plus froide du séjour. Nous lisons dans le guide des « Plantes et fleurs rencontrées » sur la Corse que les températures estivales nocturnes, au-dessus de 1000 m, vont de 4 à 8° !
Lors de la montée du Mont Incudine à 2134 m, se découvre un beau paysage d’arêtes rocheuses tachetées de vert. Mais une barre de brume mauve monte jusqu’à 2000 m et cache les détails de la plaine.
Joli dégradé du ciel vers l’horizon : d’un bleu soutenu à un blanc presque transparent. Certaines nuances me rappellent le bleu grec. Une grande croix chrétienne marque le sommet du mont Incudine.
La descente pierreuse est pénible pour les pieds mais en une heure nous sommes au refuge d’Asinao à 1545 m où nous déjeunons de saucisson et de coquillettes au thon comme prévu dans la liste de nos menus. Suivent des descentes et des remontées à chaque ruisseau dans la forêt qui coulent obstinément vers la vallée. C’est ce que le topo-guide appelle « un chemin approximativement en courbes de niveau ».
Nous rencontrons une vipère – ma première – courte et brune, tachetée de noir, la tête triangulaire. Elle se glisse sous un rocher à mon approche, avertie probablement par les vibrations de mes pas sur le sol. Je marchais devant. La leçon est qu’il vaut mieux marcher en chaussures fermées couvrant la cheville plutôt qu’en sandales comme les randonneuses des premiers jours. Surprise, une vipère peut piquer.
Nous dînons à 18h30 d’un goulasch Buitoni à la boîte un peu bombée qui fait splash quand je l’ouvre. Ma chemise bleu ciel se retrouve tachetée d’orange et ressemble à une peau de limande maintenant. Je devrai la laver demain au ruisseau et marcher sans chemise jusqu’à ce qu’elle sèche. Espérons que nous n’aurons pas mal à l’estomac : le contenu était mangeable et même bon. Le bombement était probablement dû à la différence de pression due à l’altitude. La soupe de poireaux pommes de terre en sachet Knorr l’a précédée et un thé très sucré l’a suivie.
Et nous repartons comme le soleil tombe derrière les montagnes. En forme, et pour changer un peu, nous marchons au crépuscule jusqu’à 22 heures, lorsque la nuit est noire. Il fait frais, ce qui est plus agréable pour randonner que la touffeur du jour ; la bruyère libère ses parfums à l’heure du soir et embaume la citronnelle. J’ai l’impression de retrouver mes 10 ans et l’émotion d’accomplir l’inhabituel. Comme les balises griffées blanc et rouge sont de plus en plus difficiles à trouver, même à la lampe de poche, nous stoppons à un endroit plat derrière un gros rocher, sans doute près du col de Bavella à 1218 m. Mais comme on ne voit rien, la surprise sera pour demain matin.
























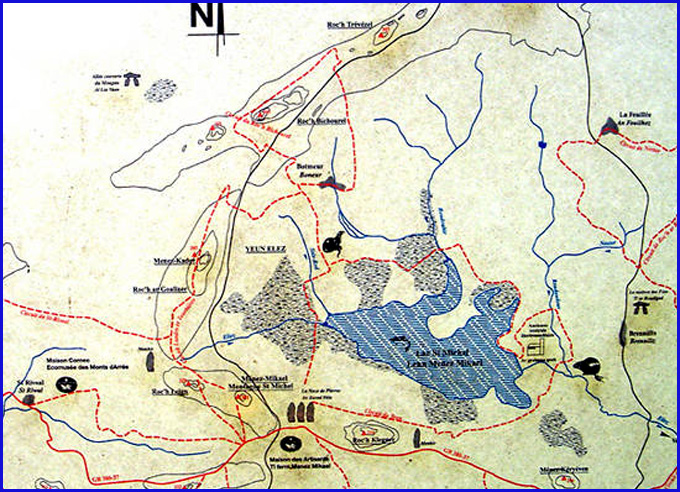


Commentaires récents