 Il y a 20 ans, je lisais ce livre majeur de Jacques Gravereau. Tout ce qui est écrit s’est réalisé. La Chine a pris son essor silencieusement, ne relevant la crête qu’avec l’éléphant yankee qui barrit de la trompe pour faire le clown devant ses partisans, petits blancs frustrés et chrétiens mystiques.
Il y a 20 ans, je lisais ce livre majeur de Jacques Gravereau. Tout ce qui est écrit s’est réalisé. La Chine a pris son essor silencieusement, ne relevant la crête qu’avec l’éléphant yankee qui barrit de la trompe pour faire le clown devant ses partisans, petits blancs frustrés et chrétiens mystiques.
Dans ma jeunesse, le monde intellectuel voyait l’avenir à l’est, dans la Russie immense et rouge. Il s’agissait de s’adapter, au moins dans sa tête, à l’inéluctable prééminence de l’Etat-Léviathan, à son discours manipulateur à destination des masses et aux réseaux soigneusement entretenus de sa nomenklatura bureaucratique. Et l’on voit aujourd’hui les « révolutionnaires » hier les plus affichés s’être installés avec cynisme dans la société française des privilèges, en fonctionnariat confortable, en mandarinat professoral et dans les lieux de pouvoir médiatique. Certains, plus en retard ou plus provocateurs, avaient poussé l’avenir jusque dans la profondeur des masses chinoises, alors guidées à coup de pensée unique par un instituteur primaire. La simple démographie a donné raison à ces derniers, mais ce phénomène n’a rien d’idéologique. Il est resté « physique » : c’est le nombre qui impose ses idées et non les idées qui mènent le monde. L’URSS en déclin de population s’est effondrée, la Chine en plein essor démographique s’est imposée.
C’est ce que montre Jacques Gravereau, professeur à HEC, dans ce livre de 2001 où il dissèque cette révolution asiatique, non plus tonitruante sous les drapeaux rouges mais silencieuse par l’entreprise et l’intérêt des hommes – jusqu’au dernier empereur rouge qui, désormais, relève la crête. Mais, pas plus que l’idéologie marxiste, ce n’est l’idéologie libérale à l’américaine via la mondialisation qui l’a emporté. « La standardisation des normes techniques n’entraîne pas l’uniformisation des valeurs par la grâce des médias et du consumérisme (…) L’économie de marché n’entraîne pas un alignement sur des principes occidentaux d’égalité, d’individualisme et autres valeurs absolues » p.18. Il suffit d’observer le Japon depuis 1945 ou la Corée depuis 1950 : ils n’ont rien renié de leur civilisation tout en surfant à la pointe de la modernité.
Si la pensée occidentale est logique, causale, analytique, abstraite, la pensée chinoise enregistre des alternances d’aspects appariés tels l’endroit et l’envers, le yin et le yang. A la raison seule, elle préfère les sensations, les émotions, l’empathie pour les choses. L’Occidental se croit le maître d’une nature qu’il vise à expliquer par une science objective et neutre. Le Chinois suspend son jugement et laisse venir les choses pour se couler dans leur mouvement. Si la pensée logique aboutit à l’idéal d’objectivité scientifique, elle exige la liberté de recherche et de critique, donc des droits individuels au scepticisme et, in fine, une propension à un régime politique démocratique. La pensée chinoise, englobante et toute de mouvement, s’accommode de la hiérarchie collective, du respect aux anciens et des devoirs envers la tradition (fût-elle celle du parti), comme de la structure sociale. Les individus sont enserrés dans des familles, des quartiers, des clans, des groupes d’intérêt. Le rite social prime la critique et la honte est la punition. La valeur n’est pas à une « vérité » abstraite mais à la confiance, qui nait d’un dialogue évolutif avec le pouvoir. Ce qui est visé n’est pas la connaissance mais l’harmonie. Ce qui s’écrit en chinois « avoir des céréales plein la bouche », et qui rapproche cette conception de notre épicurisme.
Le « vide » n’est pas le silence à emplir de discours mais une « possibilité totale ». Les choses naissent du mouvement et des transformations, et non pas toutes armées de la cuisse d’un penseur. L’ordre est en perpétuelle altération et le pouvoir n’est que l’action d’accompagner le mouvement avec la même souplesse et obstination que l’eau qui coule et s’infiltre partout où elle peut. Il s’agit de se fondre dans les apparences pour vaincre sans bataille.
Cette conception du monde donne à la Chine une bonne capacité à gérer le long terme. L’ordre y est confortable car les situations y sont prévisibles. La tactique de la non-confrontation permet de s’adapter au mouvement constant tout en restant au pouvoir. L’horreur absolue est l’impatience – et Xi Jinping, dirigeant la Chine depuis 2013, devrait se rendre compte de cet écart à l’harmonie. Le langage n’a pas à être précis ou sincère mais « joli » et « acceptable ». C’est à cela que sert la langue de bois, une sorte de politiquement correct issu des choses mêmes.
Il ne s’agit pas de respecter un contrat politique ou juridique mais de maintenir la relation humaine entre le dirigeant et le peuple. « C’est particulièrement vrai au Japon où l’adhésion est fondée sur une émotion partagée en commun, presque d’ordre esthétique » p.114. Le chef n’est pas celui qui décide mais celui qui, par sa seule présence, permet au groupe hiérarchique de fonctionner et de s’épanouir. Les ralliements y sont féodaux et cette société apparaît peu capable de créativité. En revanche, l’imitation minutieuse et le perfectionnement technique y sont poussés à l’extrême. Le conformisme y est grand, bâti sur la relation personnelle, la parole donnée et un faisceau d’obligations réciproques construit au fil du temps.
« 1960 : L’Asie du sud-est est à parité exacte avec l’Afrique en termes de revenus par habitant » p.142. On voit ce qu’il en est aujourd’hui. « La volonté de s’en sortir puise aux mêmes sources que les Chinois de la diaspora. (…) Trois facteurs communs : le traumatisme de sociétés déplacées par l’exil (…), la guerre d’abord, les valeurs confucéennes de travail, de discipline, de respect de l’autorité et de passion pour l’éducation ensuite, enfin le pragmatisme et la vitalité des entrepreneurs » p.153. Nul « péché » ne s’attache à l’argent, l’éducation est un investissement, le réalisme d’expérience règne à tous niveaux, y compris au sommet de l’Etat. « En Asie, les relations humaines sont un enchaînement de compréhensions réciproques et non le résultat automatique de l’application de principes démocratiquement admis. Le pragmatisme importe plus que les grands concepts abstraits. La discipline est importante et la liberté individuelle est sévèrement limitée au bénéfice des intérêts de la communauté » p.250.
Le matérialisme qui règne changera peut-être cet état d’esprit ; il s’adaptera, mais cela demandera deux ou trois générations. Les Asiatiques ne deviendront pas Occidentaux pour cela ! Même après deux siècles de révolution industrielle, nous Européens restons régis par des conceptions qui remontent au christianisme de l’an mille, au droit romain et à l’éthique grecque. Ne rêvons donc pas de transformer les Chinois et autres Japonais en Américains bien tranquilles : observons-les, apprenons de leurs initiatives te de leurs erreurs, gardons-nous de leurs capitaux et de leurs promesses de coprospérité.
Jacques Gravereau, L’Asie majeure : l’incroyable révolution de l’Asie pacifique, 2001, Grasset, 280 pages, €22.40 e-book Kindle €5.99


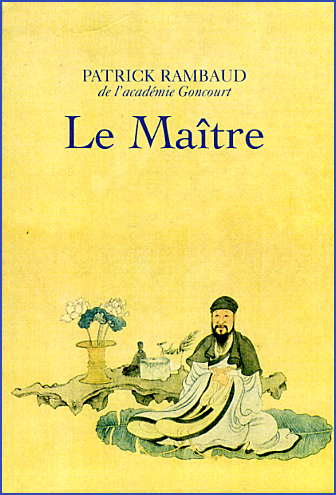

Commentaires récents