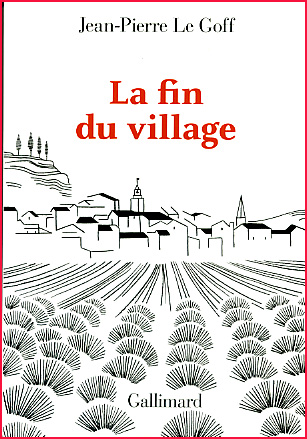
Sociologue au CNRS, Jean-Pierre Le Goff scrute les bouleversements de la société française depuis la guerre. Il livre dans La fin du village, son devoir de vacances. Il s’inspire du livre culte des cours de sociologie qu’il admire : Un village du Vaucluse de Laurence Wylie, paru en 1950. Cadenet est un gros village du Vaucluse, dans le Luberon, non loin de Lourmarin mais moins connu. Assez proche de la ville d’Aix, mais isolé dans les collines, il a su préserver durant des décennies une organisation sociale et une manière de vivre traditionnelles – qui sont en train de disparaître. En vacances en famille durant des décennies pour l’été dans le village, le sociologue se fait participant. Sur demande de l’éditeur, il décide d’en faire un livre.
Disons-le de suite : c’est passionnant !
Sans jargon de caste universitaire, empli de sympathie pour les habitants qu’il a côtoyés, gardant un regard critique sur les évolutions plus ou moins subies, parfois poussées par certains groupes de pression, l’auteur analyse comment, de 1945 à 2005, Cadenet a perdu son « authentique » pour devenir « bariolé ». A l’image de la France et probablement des pays développés – en tout cas à l’encontre de la croyance dominante où une certaine écologie rencontre les naïvetés des utopies post-68 et le narcissisme égoïste des bourgeois de gauche.
Cadenet attire, comme la bergerie attirait Marie-Antoinette : ne voilà-t-il pas un village qui a su garder sa taille modeste, enserré dans un paysage de Provence tel que le veut le mythe, avec des personnages tels que Pagnol en a filmés ? Cadenet attire le bobo stressé de la ville comme le miel les abeilles. Ceux qui ont quelques moyens viennent s’immerger dans « la nature » parmi les « naturels ». Sans trop se mêler, imbus qu’ils sont parfois de leur statut et de leur bagage culturel.
L’auteur analyse en 5 parties la communauté villageoise de jadis – qui subsiste à l’état de traces -, la fin d’un monde avec l’irruption de la télé et de la bagnole, suivies très vite des petit-bourgeois socialistes de la gauche Mitterrand (fonctionnaires, techniciens de Cadarache, cadres moyens travaillant à Aix), enfin le nouveau monde des années 2000, jusqu’au « village bariolé » de la postmodernité ; il garde la partie dernière pour étudier la jeunesse et la vieillesse, et leur prise en main par l’idéologie « citoyenne » écologique, dispositif impressionnant de « mobilisation » à « visée éducative » qui fait enchaîner les « activités » au point de stresser enfants, parents et vieux par un bourrage de crâne idéologique sans précédent au prétexte d’« épanouissement » – sans imaginer ni isolement ni solitude au milieu de la foule individualiste.
Jadis – jusque dans les années 1960 – le village vivait en communauté où la solidarité n’était pas un vain mot. La période de l’Occupation et la Résistance à Cadenet l’ont prouvé ; les parents d’un certain Laurent Fabius y ont trouvé refuge et n’ont jamais été dénoncés. Tout le monde se connaissait, les familles étaient interdépendantes, chacun aidait le voisin selon ses moyens et les enfants jouaient tous ensemble dans la rue et sur les collines. Les adultes cultivaient leurs terres propres, en vigne, fruits et maraîchage, vendaient au marché et dans les villes et villages alentour, certains travaillaient la vannerie en chantant, du gamin au vieillard, et le labeur n’était pas une contrainte mais un grand moment de socialisation.
Cette description transmise par les anciens au sociologue ressemble curieusement au « communisme réalisé » selon Karl Marx – utopie que les écolos politiques et certains « socialistes » continuent de véhiculer. « La libre sociabilité, la qualité et la beauté de l’objet fabriqué de ses mains constituaient des éléments clés de ce que les managers modernes dénomment ‘motivation au travail’ et qu’ils réduisent à une mécanique psychologique. Bien plus, ces conditions s’inséraient dans une collectivité villageoise avec son tissu de relations et de rapports humains qui permettaient de transcender leur dureté ; elles étaient partie intégrante d’un univers quotidien et familier qui leur gardaient figure humaine » p.69. Comme le dit un ancien du pays, « quand on dit communisme, c’est la mise en commun. Le commun : on vit ensemble et chacun apporte ses compétences. (…) Ce n’est pas prendre, c’est partager » p.78.
Y compris la femme du voisin si elle consent et que cela ne se sait pas. Car « les rapports sexuels font partie des plaisirs de la vie et, comme tels, ils ne sont en eux-mêmes nullement honteux et condamnables, mais au contraire fort appréciés » p.91.
Les nouvelles couches sociales arrivées depuis à Cadenet interprètent le partage selon leur égoïsme bourgeois : on ne partage que ce qui appartient aux autres. Les bobos qui se revendiquent de gauche construisent leur villa à l’écart, l’entourent de murs et de pancartes « propriété privée », interdisant le passage des chasseurs sur leur terrain.

« La dissolution de la tradition et de ses anciens liens a entraîné une autonomie et une liberté individuelle plus grandes. Pour positive que soit cette évolution en regard des contraintes et du conformisme villageois, elle ne s’en est pas moins payée d’une solitude et d’un souci de soi qui comportent leur lot de pathologies nouvelles » p.274. Jusqu’à la « déglingue », « l’absence de travail combinée avec la dislocation de la famille et des liens d’appartenance et de solidarité. Il en résulte une dégradation du rapport à soi-même et aux autres qui, si elle se prolonge, entraîne l’individu dans une spirale délétère » p.437.
La bêtise politiquement correcte est une pathologie plus commune : « Avec les profs, il n’y a rien à faire – dit David Lenormand, ancien appelé en Algérie – le courant ne passe pas. Ça ne sert à rien. Ils ont une vision bête. Ils pensent que tous ceux qui ont fait l’Algérie sont des fascistes. Il n’y a pas de discussion possible. C’est à se taper la tête contre les murs, jamais on ne retournera les voir ! » p.150. les jugements à connotation morale sont, pour les anciens du pays, le propre des « cons ». Certaines gens de la ville méprisent les gens des champs : « On peut s’engueuler sur beaucoup de sujets sans remettre en cause les gens personnellement. Mais les cons étalonnent les gens par rapport à eux, alors tu ne peux pas parler librement, tu es catalogué dans un camp », déclare un Cadenétien p.417. D’autant que les moralistes « tiennent de beaux discours tout en se gardant bien de les appliquer dès que leur intérêt personnel est en jeu » id.
Le Parc régional du Luberon en est un exemple. Créé pour protéger la vie sauvage et la tradition en aménageant la modernité nécessaire, il apparaît plaqué depuis Paris, sans concertation ni vocabulaire commun avec les populations locales. « Ce n’est pas seulement découvrir un rapport à l’environnement porté par de nouvelles couches sociales dont le comportement est en contradiction avec les traditions séculaires. C’est pénétrer dans un étrange univers où les thèmes environnementaux sont formulés dans une phraséologie qui laisse pantois » p.309.
La culture devient le domaine d’entre-soi des « cultureux » : « Intégrée dans une logique d’animation et de communication à tout crin, la ‘culture’ apparaît comme un vaste fourre-tout sur fond d’individualisme consumériste et de chômage de masse » p.346. L’animation, l’artisanat, l’expression corporelle, sont autant de petits boulots pour petits intellos qui n’ont pas trouvé de vrai travail à la ville. Ils se placent donc, parmi les bouseux, comme les missionnaires du nouveau monde. « Les anciennes couches populaires n’ont pas disparu, mais elles se considèrent comme des laissées-pour-compte d’une ‘modernisation’ dont elles ne profitent pas, contrairement à celle des Trente Glorieuses » p.384.
Ce pourquoi ces couches populaires votent de plus en plus Front national, et surtout pas socialiste ni Front de gauche, assimilés aux bourgeois bohèmes citadins. Ce ne sont pas les immigrés arabes qui posent problème à Cadenet, ils sont en général intégrés : « C’est l’individu qui compte avant tout et le moindre regroupement ‘à part’ peut être vite considéré comme une volonté de se séparer » p.431. Mais ce sont les « cultureux » qui vivent à part, partant le matin tôt travailler à la ville ou à Cadarache, revenant tard, se reposant le week-end dans leur quant à soi après avoir fait les courses au supermarché de la ville, et qui prennent souvent les gens du pays pour des « cons » en « faisant le fier » p.414. Consommateurs qui ne participent pas, ils n’hésitent cependant jamais à appeler les pompiers du village pour remplir leur piscine ou les gendarmes pour une musique trop forte. C’est contre ces nouveaux exploiteurs du terroir – en quelque sorte une lutte de classe contre La barbarie douce d’un libéralisme économique sans frein véhiculé par ceux qui se posent comme élite de la nation – que les gens du cru manifestent leur opposition en votant pour un parti censé les venger…
En suivant le fil du récit, qui se lit très agréablement, vous comprenez la France, celle qui est et qui a changé, sa partie populaire qui votait communiste et qui vote désormais lepéniste, ses bourgeois qui se croient du peuple alors qu’ils ne cherchent qu’à s’en distinguer, ses très riches qui, au fond, apparaissent plus sympas aux humbles parce qu’ils « se la jouent » moins, ses intellos « cultureux » qui vont chercher des « expressions » à l’autre bout du monde par mépris anticolonial de ce qui existe chez eux. Car ce qui est arrivé dans ce village est arrivé peu ou prou dans tous les villages – y compris en Île de France, je l’ai vécu.
Un grand moment de sociologie sur la génération qui atteint aujourd’hui la retraite, mais aussi un bonheur de lecture, un plaisir de comprendre. L’auteur décrit, fait parler les gens, expose les textes, montre les engrenages qui dépassent le collectif. Il fait penser et rend notre vision plus riche du monde et des gens.
Jean-Pierre Le Goff, La fin du village – une histoire française, 2012, Gallimard, 593 pages, €26.00
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Pingback: Gauchisme culturel | argoul
Pingback: Capitalisme et socialisme | argoul
Vous avez parfaitement raison sur l’urbanisation qui vide les campagnes depuis la révolution industrielle, et sur la métropolisation des nouveaux nomades du marketing et de la finance (j’en fus).
Mais le propos de Jean-Pierre Le Goff est de montrer :
1/ que la vie communautaire au village, millénaire depuis Montaillou étudié par Le Roy Ladurie, s’est effondrée à la fin des années 1960 à cause de l’individualisme croissant né des progrès de l’instruction et du travail spécialisé,
2/ que le retour au village des néo-ruraux venus des villes n’est pas un retour à une vie communautaire mais, au contraire, importe l’hyper-individualisme égoïste de la ville (les pompiers pour faire remplir la piscine – mais personne au bal des pompiers annuels),
3/ que la justification idéologique du marxisme, chez ces petit-bourgeois, tout comme celle de conserver la nature chez les nouveaux écolos, n’est pas l’idéologie émanant d’un mode de vie (comme par exemple la fraternité chez les hippies) mais un placage intello abstrait (partager ? oui mais pas m piscine ; la nature ? oui mais pas pas de randonneurs sur mon terrain).
Le libéralisme (idéologie du laisser-faire) qu’il ne faut pas confondre avec le capitalisme (système d’efficacité économique), engendre un mode de vie plus individuel (justifié par les libertés), mais ne suscite pas l’idéologie pseudo-marxiste de justification que l’on constate à l’œuvre dans le gauchisme culturel des bobos retournés aux champs (sans surtout y travailler).
L’écologie, à base de resucée marxiste d’harmonie retrouvée avec la nature, avec les autres et avec soi, apparaît comme une nouvelle religion avec ses croyances abstraites (le blabla sur le parc régional), ses clercs (fonctionnaires du ministère) et son catéchisme (jusque dans les écoles).
L’individu doué d’égale raison, rationnel et calculateur de l’idéologie libérale n’est qu’une caricature : dans la réalité, les gens sont submergés par leurs émotions, réagissent selon le mimétisme et la mode, et ne calculent pas autrement leur intérêt que parce qu’il conforte leur narcissisme (ils « se la jouent » disent les villageois).
En tout cas un livre passionnant à lire et qui fait réfléchir.
Je reviendrai sur Jean-Pierre Le Goff dans un mois, la note est déjà programmée.
J’aimeJ’aime
Bonjour,
vous lire m’a donné envie de me procurer ce livre. Je connais Le Goff de nom mais je ne l’ai jamais lu.
La lecture de votre article m’inspire cependant deux choses :
-la fin du village est à mettre en perspective avec le développement de grandes métropoles, de plus en plus imposantes, qui écrasent tout autour d’elles, aspirant emplois, jeunesse, richesses… et ne laissant subsister autour d’eux que quelques îlots grâce aux seuls flots des touristes, retraités et redistributions en tout genre. L’essor de ces grandes métropoles a été saisi par une image intéressante du géographe Olivier Dollfus qui, dans son ouvrage « La mondialisation », parle d’Archipel Mégapolitain Mondial. L’expression est laide, mais au moins elle est claire.
Ce phénomène de destruction du village au profit de cet archipel est à mon avis clairement lié au capitalisme libéral, qui noie tout ce qui est simple, beau, authentiquement socialiste dans les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx. C’est que le petit village, ce n’est pas une entité optimale dans la mondialisation : aussi le petit village disparait-il. D’ailleurs il est intéressant – et inquiétant – de voir que l’entité géographique idéale des libéraux est la cité-Etat, c’est-à-dire la ville libérée de tous ces territoires inutiles – campagnes, petites villes, villages – qui pèsent sur une ville comme Paris par exemple, contrainte à toute une série de redistributions.
– les liens de solidarité qui existaient dans ces villages – et dont j’ai eu la chance de voir les dernières traces quand j’étais gosse, il y a 15 ans, chez mes grands parents, alors paysans dans un petit village -, ces liens n’existent évidemment pas dans les grandes métropoles où tout est organisé mathématiquement, ou tout est procédural, ou tout est mécanique, ou tout est à vomir en fait. Ces liens me font penser à l’expression d’un écrivain célèbre : la « common decency » (c’est d’Orwell). Une solidarité qui allait de soi à une époque où le petit village existait encore, où l’anthropologie libérale – l’individu froid, rationnel et égoïste qui ne pense qu’à lui – ne s’était pas imposée à tous.
En tout cas merci de cet article, ça fait réfléchir, ça montre qu’il a existé et donc qu’il existe encore des organisations alternatives, et ça me rappelle avec nostalgie la pensée politique que j’essayais de développer quand j’étais ado et que je croyais pouvoir changer le monde!
J’aimeJ’aime