« Je n’ai aucune biographie », écrit-il à son ami Ernest Feydeau. « On ne peut plus vivre maintenant ! du moment qu’on est artiste, il faut que messieurs les épiciers, vérificateurs d’enregistrement, commis de la douane, bottiers en chambre et autres s’amusent sur votre compte personnel ! Il y a des gens pour leur apprendre que vous êtes brun ou blond, facétieux ou mélancolique, âgé de tant de printemps, enclin à la boisson, ou amateur d’harmonica. Je pense, au contraire, que l’écrivain ne doit laisser de lui que ses œuvres. Sa vie importe peu. Arrière la guenille ! » 21 août 1859, III 35.
Pourquoi donc « les gens » veulent-ils fourrer leur nez dans les dessous des écrivains ? Est-ce par envie, pour rabaisser l’artiste au commun des mortels qui bâfre et dort et va à la selle ? Est-ce pour mettre l’œuvre au niveau de leur compréhension utilitariste des choses ? Est-ce pour compléter le tableau par du saignant tout cru de voyeur ? L’énumération desdites gens par Flaubert montre le peu de cas qu’il fait de cette espèce : ce sont les médiocres, des matérialistes, « messieurs les épiciers, vérificateurs d’enregistrement, commis… » Les bourgeois. Les très petits qui se croient, parce qu’ils ne sont plus serfs à la glèbe mais ont pu agioter sur les biens nationaux…
Ces « épiciers » n’apprécient une œuvre que parce qu’elle est louée dans les journaux de la « bonne » société et qu’on en parle dans les salons. Aujourd’hui, on dirait Télérama et la télé. Ce n’est pas l’œuvre qui importe pour ces « vérificateurs », mais le bruit qui est fait autour d’elle et surtout sa morale. Qu’importe le talent, la culture ou le style, il faut que votre « compte personnel » soit moralement acceptable. Les salons (et la télé) vous disent quoi en penser pour être à l’unisson des autres « commis de la douane » qui censurent socialement les œuvres. Surtout ne rien penser par soi-même ! Suivre le troupeau est meilleur pour sa réputation.
Flaubert, dans la même lettre, tourne ce travers en dérision : « Après mille réflexions, j’ai envie d’inventer une autobiographie chouette, afin de donner de moi une bonne opinion : 1° Dès l’âge le plus tendre, j’ai dit tous les mots célèbres dans l’histoire : nous combattrons à l’ombre – retire-toi de mon soleil (…) 2° J’étais si beau que les bonnes d’enfant me m… à s’en décrocher les épaules (…) 3° (…) Avant dix ans, je savais les langues orientales et lisais ‘La Mécanique Céleste’ de Laplace ; 4° J’ai sauvé des incendies 48 personnes ; 5° Par défi, j’ai mangé un jour 15 aloyaux, et je peux encore, sans me gêner, boire 72 décalitres d’eau-de-vie ; 6° J’ai tué en duel trente carabiniers. Un jour, nous étions trois, ils étaient dix mille. Nous leur avons f… une pile ! 7° J’ai fatigué le harem du grand Turc (…) 8° Je me glisse dans la cabane du pauvre et dans la mansarde de l’ouvrier pour soulager des misères inconnues (…) 11° Je sais le « secret des cabinets » ; 12° (et dernier) Je suis religieux ! »
Le jeune Gustave raille tous les poncifs à la mode, à la manière de Rabelais en les poussant au ridicule : la précocité de mémoire et de sexe, la lecture cuistre pour épater le bourgeois, l’enflure des bonnes actions, le socialisme bêlant des foules sentimentales, les secrets de la politique, la bien-pensance. « Je suis religieux ! » – on dirait aujourd’hui « je suis de gauche, forcément de gauche ! », et demain : « écologiste, altermondialiste, vegan et anti-croissance » ! ou peut-être, plus probablement vu la frilosité de crise : « national et socialiste, catho-islamo réactionnaire toute ! »
Dans une lettre ultérieure au même, Flaubert précise, sur ces pipoleries : « j’ai pour principe qu’il ne faut jamais rien répondre. Les œuvres, voilà tout. Qu’importe le Nous, le Moi et surtout le Je ? » (12 novembre 1859, III 55). « Les œuvres »… certains éditeurs aujourd’hui s’en préoccupent moins semble-t-il que des harpies qui volettent dans le milieu en décidant de ce qui « doit » être lu ou pas.
Gustave Flaubert, Correspondance janvier 1859-décembre 1868, tome 3, édition Jean Bruneau, Pléiade, Gallimard 1991, 1727 pages, €62.50

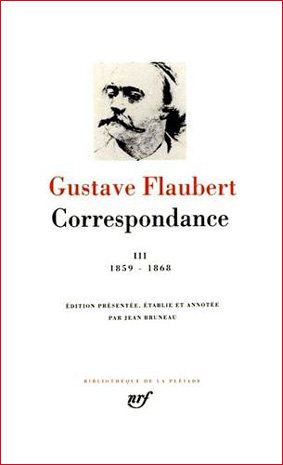


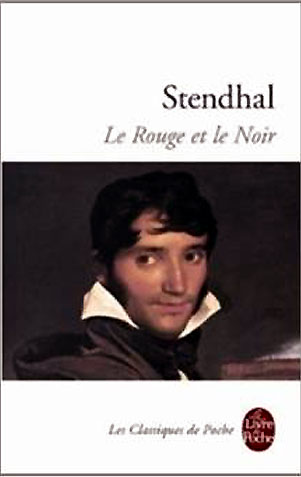

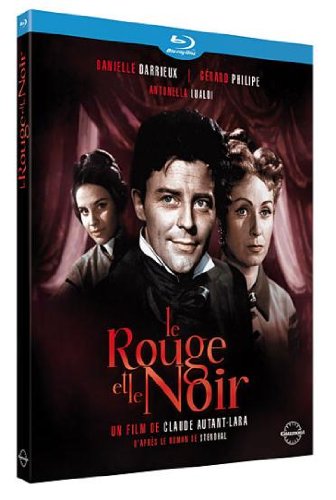
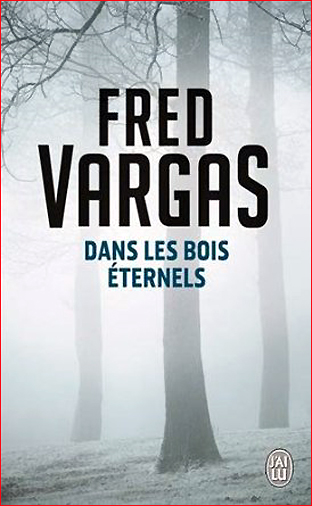
Commentaires récents