Dans ce musée, nous négocions pour entrer (on n’y accède qu’en ayant pris le passe touristique qui comprend tous les sites de la ville et d’alentour !). Figure une étonnante photo en noir et blanc du site de Machu Picchu vers 1925, 14 ans après sa découverte. La végétation envahit tout et l’on distingue à peine quelques substructions sous le moutonnement végétal.
Autres curiosités : une momie de femme nazca ; une broderie où des lettres de l’alphabet latin, mises dans n’importe quel ordre, montrent que la brodeuse n’en savait pas le sens. Les lettres étaient utilisées comme décor par quelqu’un qui ne savait pas lire. Les corps que l’on voulait momifier étaient traités comme les patates : après éviscération, on les exposait alternativement à la dessiccation du soleil et à la lyophilisation du gel nocturne
Toute une salle est consacrée à la peinture cuzquenia, la peinture métisse du XVIIIe siècle. Influences espagnoles et réminiscences indiennes. Elle est caractérisée par le manque de perspective, des couleurs intenses et sans relief, un dessin expressif, un décor de brocard et d’or à la feuille. Les images sont peintes à la manière des icônes sur des sujets de la religion catholique. Mais une autre forme de la résistance morale indigène réside dans certains détails, comme nous l’explique un gardien complaisant. Par exemple de peindre les trois symboles de Dieu, Père, Fils et colombe du Saint-Esprit sur le même plan, sans hiérarchie ; ou de remplacer la colombe par un être humain ; ou de placer un chien au pied de la Croix ; ou d’y mettre un bâton à poudre (ancêtre de la dynamite)… Les Vierges sont super-perlées, l’uniforme des évêques sont clinquants, toute la pompe espagnole est ridiculisée dans son excès.
La Compaña, Compagnie de Jésus, a donné son nom à l’église construite pour les Jésuites à Cuzco. L’autel est monumental, tout doré avec des anges offrant leur poitrine rose et glabre, tout à fait dans le goût religieux du baroque pâtissier occidental.
Un Argentin d’origine asiatique s’agenouille devant l’autel pour prier, tandis que sa femme tente de le photographier dans cette posture édifiante. L’intention n’était pas pure mais il s’agit ici d’un véritable scandale ! Le gardien qui rôde, comme un chien renifle les dépôts odorants de ses congénères, tape vigoureusement dans ses mains, brisant le silence sacré. Pas de photo dans l’église. Strikt verboten ! Par respect ? Que non pas ! Il se lance dans un discours explicatif des scènes représentées au-dessus de l’autel, notamment la vie du Christ. Il ne faut tout simplement pas priver l’église des deniers récoltés à vendre les cartes postales à l’entrée. Au dos du survêtement de l’Argentin était imprimé : « Tai chi chuan / Argentina ».
Dans une chapelle latérale, les chérubins nagent dans la crème chantilly aux pieds de la Vierge. Un adolescent de 16 ans à peine, crasseux et sentant fort, mendie à mi-voix auprès de chaque fidèle de l’église. Il débite sa litanie automatique d’un air triste. Quelles misères peuvent se cacher dans cette ville ? Dans le bâtiment attenant à l’église se tient une vente de charité. Des tables entières de livres sur le Pérou ancien et contemporain attendent l’acheteur – en espagnol – des rebuts de greniers, publications universitaires, revues de cuisine, recueils de poèmes locaux, albums pour enfants.
Accolée à tout cela, ancienne partie de l’ensemble, l’Université de Cuzco. Déjà aux temps inca s’élevait à proximité la maison du savoir où étaient formés comptables et chroniqueurs. La porte est ouverte, les enseignants tentés par leurs semblables, Camélie, Gusto et moi entrons. Nul ne nous prête attention, pas plus les étudiants que les gardiens postés à l’entrée qui « contrôlent » les mouvements. L’université se tient dans l’ancien cloître de l’église, les élèves ont remplacé les moines, mais la mission reste sans doute la même : remplir les esprits de savoir divers. Sous les arcades de l’entrée, ont quand même été placées deux statues en bronze de jeunes hommes nus brisant les chaînes de l’ignorance. A l’intérieur, mieux cachée, se dresse une statue de femme nue elle aussi, mais elle a les mains dans le dos. Les mâles à l’entrée, la femme dans l’alcôve – telle est sa place ici. Seuls les hommes sont libérés, les femmes ont encore quelque chose qui les attache. Cela ne nous empêche pas de constater que beaucoup d’étudiants sont des filles. Le travail s’effectue le plus souvent porte ouverte, dans un brouhaha constant. La modernité a fait irruption dans cet enclos de savoir sans âge car il existe un « servicio de Internet ». Les exposés que doivent faire les étudiants en langues vivantes ont été affichés dans le couloir pour l’édification des visiteurs. Pour ceux qui apprennent le français, ces exposés portent sur les principaux monuments comme « l’arco de triumfo », la tour Eiffel ou ces « castillos de la Loyre ».


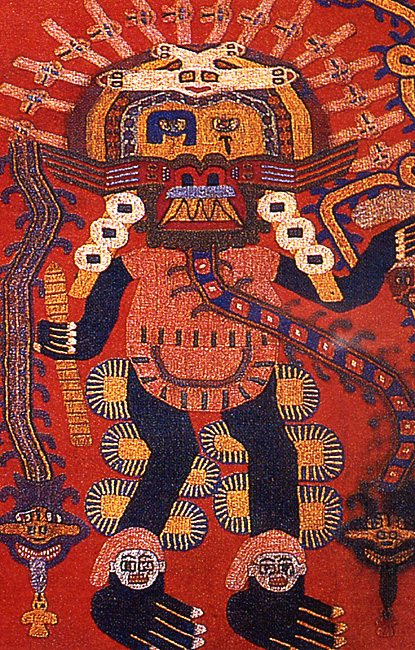






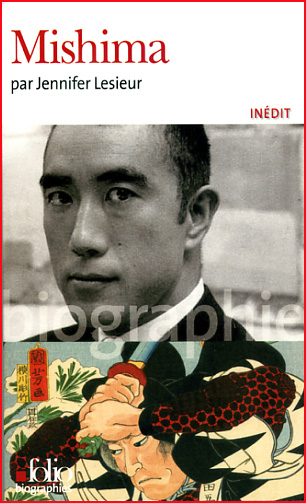
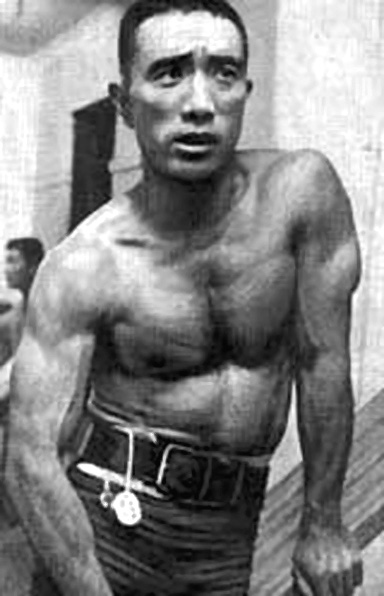
Commentaires récents