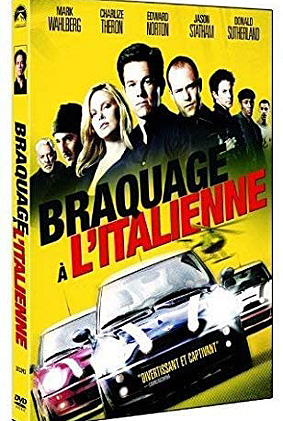
Pour plusieurs tonnes d’or possédées par des trafiquants, que ne ferait-on ? Il s’agit, en 2003, de 35 millions de dollars. A se partager en cinq, ce qui fait quatre de trop… Voler Venise en faisant sauter un plancher de palais à l’explosif, voilà qui est très audacieux, c’est-à-dire américain. Le scénario est donné, assez convenu ; reste à le réaliser – et là, c’est une réussite.
John Bridger (Donald Sutherland), cambrioleur de la vieille école « à l’écoute » du coffre-fort et Charlie Crocker (Mark Wahlberg), fils spirituel et audacieux se complètent. Ils rassemblent autour d’eux une équipe de quatre avec Handsome Rob, spécialisé en bagnoles et drague (Jason Statham), Lyle (Seth Green) qui se fait appeler Naspter parce qu’il dit qu’il a inventé le concept que son copain de chambre lui aurait volé quand il dormait, le rappeur Mos Def qui joue Dur d’oreille pour avoir fait sauter la porte des chiottes de son école à 9 ans, et Steve (Edward Norton) sans aucune imagination.
Le plan est rusé et réussit au-delà de toute espérance : tout est calculé, minuté, exécuté avec brio. Le canot automobile s’engage sous le palais après avoir dézingué la serrure de la grille, l’informaticien mesure en 3D d’après plans les emplacements les meilleurs pour faire sauter les planchers, les deux autres placent les charges et… boum ! Le lourd coffre quitte son salon stable pour s’effondrer deux étages plus bas dans la lagune. Le canot quitte alors le soubassement du palais avec le coffre bien en évidence sur le pont. Sauf que c’est un faux coffre, que les trafiquants vont poursuivre comme la police, sans succès. La maîtrise du volant de Rob fait merveille, négociant des virages serrés dans les canaux, slalomant entre les embarcations et les gondoles, se faisant aider d’éboueurs de la Ville – bien payés – pour laisser le poursuivant sur le sable d’une barge cachée entre deux péniches de travail. C’est du grand art et le spectateur est ravi de l’action trépidante et de l’audace des braqueurs.
L’équipe en camionnette fuit vers la frontière de l’Autriche avec l’or (il s’agit de barres de 10 kg et pas de « lingots » d’1 kg comme le laisse croire la bande son). Un véhicule venant en sens inverse leur barre la route sur un barrage : les braqueurs sont braqués ! Mais pas par ceux à qui ils ont piqué l’or : par l’un des leurs. Steve a décidé de la jouer solo et sort son flingue pour descendre tous ses copains. Face à l’or, la fièvre monte et la camaraderie ne pèse pas lourd, sans même évoquer une quelconque amitié, dont il n’a jamais été question. On se demande d’ailleurs quel a été le rôle de Steve dans la préparation et quelle pouvait bien être sa spécialité. En tout cas, il descend le vieux Bridger comme s’il avait une revanche à prendre sur le Père. Rob, pas fou, écrase l’accélérateur et, en bousculant le 4×4 d’obstruction, pousse la camionnette dans l’eau glacée de la retenue. Tous sont gelés mais en vie, malgré un Steve qui tire à la mitraillette sur la surface tant qu’il peut, en gros connard d’Américain qui préfère arroser que penser. Je n’aime pas cet acteur au visage mou (comme pété d’héroïne) et à la petite moustache d’impubère. Ado schizo de Peur primale à 27 ans, il est devenu gros naze d’American History X à 29 ans avant de jouer le traître de l’équipe à 34 ans.
Mais le coffre a été ouvert sous l’eau par un Bridger en scaphandre autonome, assisté de Crocker. La camionnette recèle donc des bouteilles d’oxygène, ce qui peut être utile lorsqu’on est coincé sous la glace en attendant que la grêle (de balles) se tasse. Comme Bridger est mort et bien mort, d’un premier tir surprise, les autres rejettent son cadavre en surface pour faire croire qu’ils sont tous trépassés. Ils sont en fait tous vivants et ne jurent que de se venger.
Il faut attendre, la vengeance est un plat qui se mange froid et non quand on est glacé. Une fois localisé en Californie (évidemment) dans une grande baraque sécurisée avec câble haut débit et écran géant, voitures de sport et coffre dernier cri, Steve n’a plus que du mouron à se faire. Il ne s’en doute pas car un an est passé et il a déjà dépensé 8 des 35 millions d’or, fourguant à un cave en cheville avec la mafia ukrainienne (accent savoureux) les barres ornées d’une danseuse balinaise.

Charlie va reconstituer l’équipe pour braquer le braqueur de braqueurs, ce qui est fort réjouissant. Manque Bridger, il sera remplacé par sa fille, la blonde et canon Stella (Charlize Theron), 28 ans et experte en coffre-fort pour la police. Elle hésite mais le souvenir de son père l’emporte : elle sera de l’aventure et mettra sa Mini rouge et son professionnalisme au service du sport. Car il s’agit moins d’argent (encore qu’il ne reste jamais loin dans l’esprit yankee) que d’honneur (laver l’affront fait à l’équipe solidaire et le meurtre de l’un des leurs). Stella se fait passer pour une technicienne du téléphone de la compagnie qui dessert Steve, après que Dur de la feuille ait « débranché » (comme José Bové son MacDo) le câble reliant la propriété. Avec une caméra miniature planquée sur le sein gauche (ouille, ça pique ! Lyle gaffe une fois de plus avec une nana en lui pénétrant le globe) elle va filmer l’intérieur de la maison pour trouver le coffre.
Mais elle est trop sexy et Steve l’invite à dîner. Elle refuse puis finit par accepter, entorse primaire à toutes les règles de sécurité, au prétexte de l’éloigner de la forteresse tandis que les braqueurs de braqueurs vont agir. Même si elle boit du Perrier (en bouteille bleue), elle parle trop et cite malencontreusement son père sur « le diable en chacun », expression que l’intelligent Steve capte aussitôt. La couverture de Stella s’effondre et l’équipe de faux morts surgit dans le restau comme des zombies. Steve est estomaqué.
Commence alors un « jeu » entre Charlie et lui pour savoir moins qui a la plus grosse que qui a le cerveau le plus affûté et l’imagination la plus osée (ce qui change des habituels navets hollywoodiens pour trumpistes bornés). Le spectateur s’attend à ce que Monsieur « Manque d’imagination » perde, et c’est ce qui va se produire, mais pas sans un baroud d’honneur fort bien mené. Le train est mené par un trio de Mini Cooper (le film a-t-il été sponsorisé par la marque tout juste reprise par BMW ?), renforcées et allégées (exit, déjà, le système antipollution) pour supporter le poids des barres d’or dont il reste pour 27 millions. Prévues pour se faufiler dans le vaste couloir de la maison de Steve, ces autos vont hanter à fond les couloirs du métro où Charlie le téméraire a prévu de faire tomber – par explosifs comme le coffre – le fourgon blindé qui transporte le magot de Californie vers le Mexique, opportunément stoppé par un feu rouge.

Malgré Steve qui loue trois camions blindés et les envoie dans trois directions différentes, malgré l’escorte de gardes en motos et son suivi par hélicoptère, les Mini se faufilent, ronflent du moteur et dérapent en tous sens pour arriver à temps au train qui les emportera, camouflées, loin de la Californie. Ce qui est amusant est que, les couloirs du métro interdisant tout véhicule à combustible, les moteurs des Mini aient été électriques ! En 2003, la technologie était parfaitement au point et il a fallu attendre 20 ans pour que le constructeur daigne enfin les offrir au public et contrer la pollution.
C’est Lyle, naturellement, qui découvre quel est le bon fourgon grâce aux caméras de surveillance de la ville et un algorithme du poids de chaque véhicule d’après l’image des pneus ; c’est Lyle également qui pirate du clavier la gestion des feux rouges de Los Angeles, puis fait stopper le métro pour que les Mini puissent s’y enfiler alors que la rame à l’arrêt vient juste après elles boucher le tunnel. Quelques explosions et une course poursuite en voitures et motos, clous du spectacle hollywoodien, offrent aux spectateurs la tension suffisante pour parvenir non sans peine jusqu’à la gare où les Mini sont enfermées tranquillement en wagon. Steve alors se pointe, ayant suivi par hélico puis en 4×4 volé lorsque son pilote a crashé le rotor arrière dans un entrepôt. Il soudoie pour 5000 $ (ça ne se refuse jamais) le préposé aux wagons qui lui ouvre… mais trouve Charlie devant lui.
Steve sort son flingue, comme sur le barrage, mais cette fois la mafia ukrainienne est dans son dos car il a descendu son fourgue qui commençait à en savoir trop, séduit par la danseuse balinaise gravée sur l’or. C’était le cousin du mafieux – dommage pour lui. Il ne sera pas descendu en vengeance primaire devant les spectateurs comme dans un film de base mais lui sera réservé un traitement « en usine » où sa mort sera lente et raffinée, on peut le supposer, en juste rétribution de ses méfaits.
Finalement, l’or ne comptait pas mais chacun comptait sur l’or. Rob s’est payé la bagnole de ses rêves, une Aston Martin, et doit user de ses talents de dragueur (avec une blonde, pas un gros moustachu) pour éviter la contredanse pour excès de vitesse ; Dur de la feuille s’est offert une grosse baraque en Andalousie où farnienter au soleil ; Lyle a investi dans la chaîne stéréo de ses rêves et a réussi à faire la couverture de Wired, le magazine de la technologie, pour affirmer être le vrai créateur de Napster, le service de partages de fichiers ; Charlie a investi la gironde Stella en souvenir de son père et de son conseil : finir sa vie avec quelqu’un qu’on aime.
Il y a du spectacle, de l’invention dans un scénario banal mais resserré – c’est en bref un excellent thriller sans autre prétention que le divertissement bien mené que l’on voit et revoit quelques années plus tard avec plaisir.
DVD Braquage à l’italienne (The Italian Job), Felix Gary Gray, 2003, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Mos Def, Seth Green, Donald Sutherland, Paramount Pictures 2004, 1h36, €5.25 blu-ray €16.02, édition collector €12.90

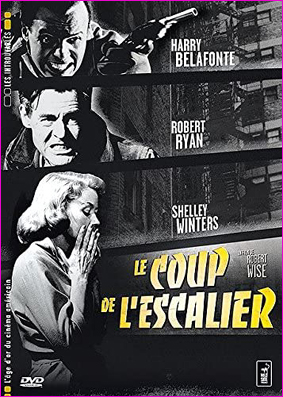




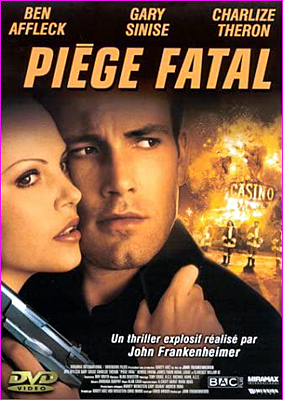





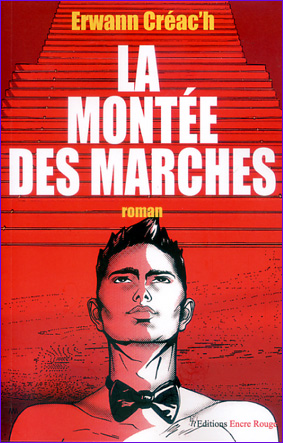
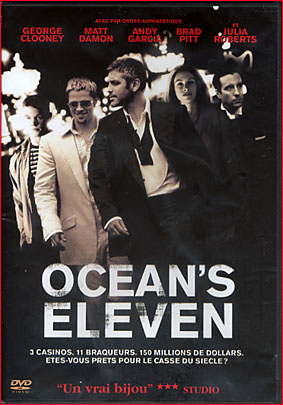


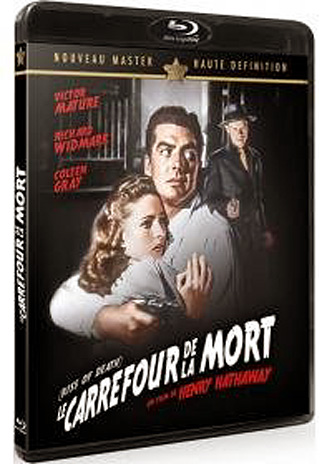





Commentaires récents