Paul Doherty, professeur d’histoire médiévale en Angleterre, écrit de nombreux ‘detective novels’ ayant pour théâtre l’histoire, l’époque d’Alexandre le Grand ou l’Angleterre du 14e siècle. ‘L’ordre du Cerf blanc’ est le premier d’une série nouvelle, se passant dans l’Angleterre du début de la guerre de Cent ans, un peu après 1400.
Matthew Jankyn, la vieillesse et le statut social venus, y conte ses aventures comme espion de l’évêque de Beaufort, demi-frère du roi Henri IV de Lancastre. Ce dernier a démis le blond Richard II. Le roi Richard n’a pas tenu les promesses de sa jeunesse ; il est devenu tyrannique et écrase d’impôts sa population. Henri de Lancastre se révolte, arrête Richard et le laisse périr dans une forteresse. Mais, durant des années, la rumeur voit l’ex-roi Richard II ici ou là, au Pays de Galles, en Écosse. Son emblème, le Cerf blanc, surgit dans toutes les révoltes populaires et religieuses, comme celle des Lollards, partisans de l’égalité biblique.
Matthew n’a pas connu sa mère, morte en couche. Son père s’est désintéressé de lui jusqu’à ses 17 ans, le confiant au curé, puis au monastère pour y faire son éducation à la dure. A 17 ans, il l’envoie à Oxford y décrocher une licence. Mais le gamin a appris à dissimuler et jamais à aimer. « Jankyn est un espion. Jankyn est un lâche et, par-dessus, tout, Jankyn est un menteur. » C’est ainsi qu’il se présente lui-même à la première page du livre. Mais Matthew Jankyn est avisé, fidèle à ses intérêts, et suffisamment prudent pour se garder en vie. Il est l’espion parfait pour les mœurs du temps. Et l’évêque Beaufort, intriguant politique de première force, découvre ses talents : il lui ressemble.
Sa mission, à supposer qu’il ait le choix de l’accepter, est d’enquêter sur ces rumeurs de roi vivant, sur cet ordre caché du Cerf blanc. Jankyn ira en France, vainqueur d’Azincourt parmi d’autres, au Louvre interroger l’ancien valet de Richard II, en Écosse rencontrer l’imposteur qui lui ressemble. Il sera archer, lépreux, émissaire mandaté. Il agitera ses petites cellules grises pour faire la lumière sur cette énigme historique.
Car il s’agit d’une énigme réelle. Les chroniques du temps en rendent compte. La théorie de Doherty en vaut une autre, mais l’historien ne peut rien dire par manque de sources fiables. Seul le romancier peut prendre le relais. Il s’agit donc d’une histoire vraie, complétée et mise en récit pour notre plus grand plaisir. A la fin, vous saurez la vérité plausible sur la fin de Richard II, et pourquoi son successeur Henri IV reste tourmenté des rumeurs dont il devrait se fiche.
Vous assisterez aussi à la bataille d’Azincourt, vue côté anglais, et vous comprendrez ce qui sépare irrémédiablement les tempéraments des deux peuples : la vanité. Les chevaliers français sont au théâtre, ils se regardent entre eux et agissent scolairement comme les codes sociaux le prévoient. Leur bravoure n’est pas en cause, mais leur stupidité de classe grégaire. Les soldats anglais sont pragmatiques, ils agissent en fonction du terrain et préfèrent l’efficacité des arcs plébéiens aux trop lourdes armures nobles, condamnées par l’histoire. Quand je pense qu’il faudra attendre Vauban puis Napoléon pour qu’enfin l’armée française s’adapte à son époque !… avant de retomber dans le passé avec les badernes de 14 et de 40.
Paul Doherty, L’ordre du Cerf blanc (The Whyte Harte), 1988, ,10/18 2008, 348 pages, €7.50

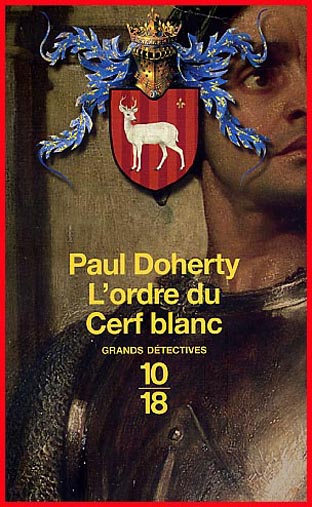

Commentaires récents