
C’est le quatrième roman de ce littéraire d’aujourd’hui 86 ans passionné de journalisme et d’Amérique. Il fut de la génération des colonisés par le soft-power yankee, les fantasmes de modernité d’après-guerre et d’épopée western. Il a osé demander – et a obtenu – en 1954 à 17 ans une bourse Zellidja pour étudier aux États-Unis, à l’université en Virginie, et il voyage au pays de ses rêves. Il en tirera plusieurs romans. Des bateaux dans la nuit reprend à 46 ans la manne biographique très riche de l’auteur en sa maturité. Il est revenu des Yankees, du vide abyssal de leur existence matérialiste, et tente de dresser un état mental de l’après-68.
Woijek Drifter est un journaliste qui a l’âge de l’auteur. Il a beaucoup bourlingué, ne s’est jamais fixé. Marié à une immigrée qui lui impose sa nombreuse famille, il est assez lâche pour ne pas divorcer. Il a une maîtresse américaine à Washington, Joyce, mais elle n’est pas « joice » comme on disait dans l’argot des années soixante, autrement dit pas heureuse. Et puis soudain…
Le destin bascule. Alors qu’il est en infiltration dans une dictature d’Amérique du sud (très à la mode dans les années 70) pour contacter un prêtre français emprisonné et torturé, son chef grand patron de presse le rappelle en urgence à Paris. Henri Lescrabes se meurt du crabe, un cancer. Il est obsédé par la fin d’un jeune chanteur célèbre passé par la fenêtre de son appartement. Jason Villaï un soir s’est envolé – et s’est empalé sur les piques de la grille du jardinet. On a parlé de suicide mais Lescrabes n’est pas convaincu. Il y a quelque chose à creuser, quelque chose d’important pour Drifter, qui tient à sa vie personnelle.
Le drifter est en anglais celui qui dérive, qui charrie, en bref le vagabond qui accumule. Labro ne choisit pas ses noms au hasard, ils ont tous un sens caché. Drifter est orphelin d’origine polonaise, probablement juif comme Lescrabes ; il a été élevé par un parrain humaniste, prof de lettres célibataire qui l’a pris sous son aile. Il est devenu journaliste pour sortir de cette atmosphère de livres et il en porte l’uniforme de ces années-là, l’imperméable blanc à ceinture.
A l’enterrement au Père Lachaise de Lescrabes, il renoue avec Andrea, une jeune collègue qui a été dépêchée la première sur les lieux de la mort de Villaï. Il commence donc son enquête avec elle. Puis il creuse en se rendant sur place. Il rencontre le concierge, ancien « factionnaire français » des colonies qui a pris un polaroïd maladroit du cadavre empalé, surpris alors qu’il essayait l’engin, cadeau d’une nièce. La photo est floue mais une tache jaune en arrière-plan intrigue : il y avait quelqu’un. Drifter finira par savoir qui – et cela ne lui plaira pas. Lescrabes avait raison, l’événement le touche en effet dans sa vie personnelle.
Le roman alterne en cinq parties les histoires des personnages : Lescrabes, Drifter, Andréa, Marie-Luc, Joyce. La partie IV est la plus indigeste. Elle comprend moins d’action et plus de verbiage psychologique. La plongée dans les turpitudes égoïstes et sexuelles d’une riche épouse oisive et frigide de magnat américain pouvait peut-être émoustiller les lecteurs sous Mitterrand ; elle écœure et lasse aujourd’hui. Ce monde des vieux qui ont bâti l’actuel est répugnant et l’on comprend pourquoi le sexe, l’argent, l’appétit de pouvoir et le narcissisme férocement égoïste peuvent régner aussi fort quarante ans plus tard. La pute des stars Joyce, qui a « feuqué » (de l’américain to fuck – faut-il traduire ?) avec tous les mâles qu’elle voulait détruire faute elle-même de pouvoir jouir, a quelque chose de diabolique, possédée d’un instinct de mort destructeur. Drifter s’y est brûlé les ailes ; Lescrabes réussit in extremis à lui donner les moyens de s’en sortir. Il revivra avec Marie-Luc, elle-même divorcée d’un mari violent.
Les « bateaux dans la nuit » sont une métaphore : « Voilà, c’est simple : il y a des bateaux qui se croisent dans la nuit, et nous, on est à bord. Si on a de la chance, si c’est la pleine lune et s’il n’y a pas de brouillard,et si les navires se rapprochent et s’abordent enfin, on peut se reconnaître de pont à pont et qui sait, parfois, s’atteindre et s’étreindre. La plupart du temps cela ne se passe pas ainsi » p.328. Mais l’on peut rencontrer alors une personne à aimer. « On en revient toujours à ceci, qui est l’amour et son manque » p.337. Or le journalisme, à force de voir des horreurs et d’en rendre compte, pousse au cynisme et pourrit l’être par mimétisme avec le monde. On ne veut plus voir : comme Drifter avec Joyce. Lescrabes finalement l’a sauvé.
L’auteur cause en style simple, un brin vulgaire, en bref journaliste. Ce pourquoi cela se lit bien, hors les longueurs déjà indiquées. Il ponctue son roman de détails glanés en professionnel, comme le crack qui surgissait, plus puissant que la cocaïne et qui allait faire des ravages en favorisant la psychose paranoïde ; ou encore ce « virus jamaïcain » (découvert en 1983 seulement) qui affectait les gays lurons de New York et de Londres et qui allait entraîner la réaction puritaine la plus vive, alors même que la gauche au pouvoir libérait les mœurs (toujours en décalage, les gens de gauche) ; ou enfin cette remarque que les stars ne regardent jamais leurs fans inconnus dans les yeux pour éviter le phénomène d’adoration due au lien par le regard, déclenchant une fixation maladive qui pourra finir par du harcèlement ou un assassinat (p.142).
Philippe Labro, Des bateaux dans la nuit, 1982, Folio 2019, 407 pages, €7,25 e-book Kindle €9,49
Les romans de Philippe Labro déjà chroniqués sur ce blog



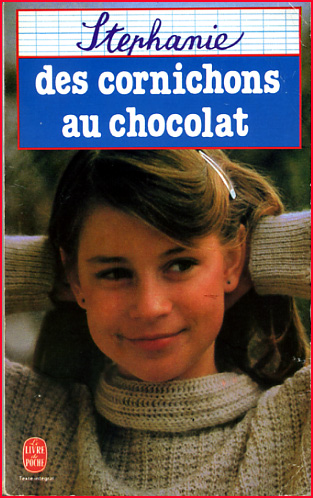
Commentaires récents