La Russie des années 1400 est barbare, écartelée entre moujiks grouillants, superstitieux et ignares, boyards brutaux s’entredéchirant et moines qui savent lire et se croient au-dessus du monde et de ses vicissitudes. Andreï Roublev (Anatoli Solonitsyne) est l’un de ces moines, peintre d’icônes et de fresques, et il parcourt le pays appelé par les princes ou les évêques afin de décorer leurs palais et églises. Il rêve d’un monde meilleur, comme tous ceux qui sont inadaptés au leur. Il a pour armes la foi et l’art.
Mais suffit-il d’obéir aux Commandements et de respecter la Bible à la lettre ? Ne dit-elle pas que la femme est soumise et que l’amour charnel est péché ? Que rire est grave au point d’être fouetté ? Qu’il est d’un orgueil puni de Dieu de vouloir voler comme les anges ? Ce film est une fresque visionnaire plus qu’une biographie historique. Andreï Roublev est « le Russe », celui qui vit dans la fange et aspire au ciel, les pieds dans la boue sempiternelle du printemps et de l’automne mais qui peint des icônes lumineuses et colorées ; celui qui creuse l’argile de ses mains pour y fondre une cloche dont le son va s’élever dans les airs ; celui qui a pour viatique l’espérance et en permanence dans les yeux un monde meilleur à venir.
Quant à l’art, Andreï Roublev, constatant la barbarie du peuple, ne peut plus peindre ; il ne veut plus. Figurer les horreurs du Jugement dernier est au-dessus de ses forces : pourquoi ajouter du malheur au-delà à celui qui règne en-deçà ? Dieu est-il implacable à ses créatures ? L’artiste peut-il donner une quelconque espérance sous une idéologie totalitaire (la religion en est une) ? Que peuvent les images de la Vierge et du Christ face à la trahison des siens et à plus barbare que soi : le Tatar ?
Le film, en noir et blanc, est long, trois heures à cinq minutes près, trop long ; il engourdit, surtout dans la première partie où l’action est lente et sans cohérence apparente. Selon moi, il est à voir en plusieurs fois, comme une série ; et à voir plusieurs fois pour en goûter les détails, qui foisonnent. Il est composé en trois parties : les années 1405, 1408, 1423 et se termine en couleur par plusieurs minutes des vraies icônes peintes par Roublev et ses contemporains, sorte d’hommage à l’art russe du passé. Leçon aussi d’immortalité : ce qu’on réalise de toute son âme reste.
Le premier tableau narre le périple des moines de l’école Andreï Roublev en route pour la capitale, où ils doivent décorer la toute neuve cathédrale de l’Annonciation sur demande de Théophane le Grec (Nikolaï Sergueïev). Un bouffon (Rolan Bykov) fait rire grassement les paysans en se moquant de tout, y compris de lui-même, mais aussi du boyard ; il est dénoncé par Kirill, l’un des moines (Ivan Lapikov). Saisi par la soldatesque, il sera fouetté dos nu et collé au cachot pour cinq ans. Le « respect » de la lettre biblique commande-t-elle de renoncer à l’amour du prochain ?
Dans la plaine, des torches flamboient : c’est le printemps, la nuit de l’alliance des corps. Andreï y voit un sabbat de sorcières car les gens courent nus et se roulent dans les buissons, baisant frénétiquement. Cette païennerie n’est-elle pas une offense à Dieu ? « C’est pourtant Dieu qui a créé l’amour », lui dit une femme à poil qui l’embrasse (Nellie Sneguina) après que les hommes l’eurent attaché pour qu’il ne parasite pas leurs ébats ; « Dieu a créé l’homme à son image » – « mais pas la femme, issue d’une côte de l’homme », renchérit le jeune Sergueï à qui l’on fait lire les Ecritures.
Second tableau, l’invasion tatare favorisée par le frère du « grand » prince Vassili Ier de Russie ; il veut devenir calife à la place du calife (Youri Nazarov). Trahison, massacre, viols et mépris du peuple russe, tel est le bilan. La sainte ville de Vladimir et ses hautes murailles est prise sans coup férir, tous les soldats sont partis en Lituanie, guerroyer pour la gloire du « grand » prince, laissant sans défense le sud et l’est du pays. La cathédrale est enfoncée, pillée, saccagée ; ceux qui se sont réfugiés dedans sont tués ou violés. Andreï Roublev est parmi eux mais en réchappe avec une simplette (Irma Raush), contrairement aux jeunes de son atelier, impitoyablement sabrés ou fléchés un par un par la main jaune sous le regard du traître qui renie sa parenté, sa race et sa religion. Dès lors, tuer un homme qui veut violer et massacrer, est-ce péché ?
Le tableau final se passe en reconstruction car « sans cesse sur le métier remettons notre ouvrage » pourrait être la devise du peuple russe. Il s’agit sans cesse de bâtir l’avenir en le rêvant radieux. Le « grand » prince – dont on ne sait s’il s’agit du traître enfin au pouvoir ou de son frère légitime qui a repris la main – cherche des artisans pour refondre une cloche à la cathédrale de Vladimir. Mais tous sont morts ou ont fui vers le nord. Seul un adolescent, Boriska, végète dans son isba, fils d’un fondeur de cloche mort dont « il a appris les secrets », déclare-t-il (le spectateur retrouve Nikolaï Bourliaïev, l’Ivan de l’Enfance, à désormais 19 ans).
En fait il s’y connait peu mais la jeunesse improvise ; elle est optimiste et croit qu’il vaut mieux tenter que d’attendre et que l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace (mot du révolutionnaire Danton) est à la racine de l’esprit du peuple. Il va donc rameuter une équipe d’ouvriers, chercher l’argile adéquate pour mouler, creuser le trou où fondre, récolter auprès du prince les métaux nécessaires et auprès des marchands le bois et les cordes pour l’opération.
Et puis la cloche est fondue, sortie de sa gangue, élevée à la lumière avec saint Georges gravé sur ses flans : elle sonne ! Le gamin s’écroule en larmes : il a réussi ! Car il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer (mot de Guillaume d’Orange-Nassau). Certains y voient le « don » de Dieu comme une grâce par essence, moi pas ; j’opte plus pour la volonté vitale de la jeunesse prête à tout essayer. Mais l’URSS en 1966 était-elle encore dans cet état d’esprit ?
Le film Andreï Roublev a été présenté au Festival de Cannes 1969 puis interdit par les autorités soviétiques jusqu’en 1972 : mysticisme et foi étaient en contradiction avec l’idéologie communiste, selon Léonid Brejnev.
DVD Andreï Roublev, Andreï Tarkovski, 1966, avec Anatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko, Nikolaï Sergueïev, Irma Raush, Nikolaï Bourliaïev, Youri Nazarov, Youri Nikouline, Rolan Bykov, Potemkine films 2017, 2h55, €18.42
Intégrale Tarkovski (version restaurée sous-titrée français), Potemkine films 2017, standard €68.32 blu-ray €73.28

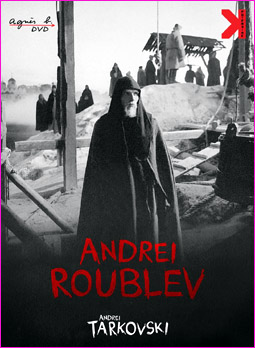












Commentaires récents