
Ce film intimiste et dépouillé recycle Arnold Schwarznegger comme on ne l’imaginait pas : en vieux papa brisé par un accident d’avion où sa femme, sa fille et le bébé à naître ont péri. Le scénario reprend la tragédie de la zone d’Überlingen en Allemagne arrivée réellement en Juillet 2002, où une erreur du contrôle aérien a fait entrer en collision deux avions, un de ligne et un cargo. Le film transpose les faits aux États-Unis et fait se crasher deux avions de ligne avec 271 victimes.
Roman Melnyk (Arnold Schwarzenegger) est un contremaître en bâtiment qui part attendre l’arrivée de sa femme Olena et de sa fille enceinte Nadiya par le vol AX112 en provenance de New York. A l’aéroport, le vol est « délayé » et, lorsqu’il se renseigne, on le conduit à part dans une salle vide, où on lui apprend que l’avion s’est crashé et qu’il n’y a aucun survivant. Son petit bouquet de fleurs à la main, Roman est anéanti. La guirlande souhaitant la bienvenue pour Noël dans sa maison l’avait averti : elle s’était détachée et pendait à terre.


Le vieux mari et père mettra des mois à se remettre, envisageant le suicide du haut du bâtiment en construction qu’il entreprend. Il cherche surtout à comprendre, à trouver un coupable. Ni la compagnie aérienne, avec ses avocats, ne lui présentent d’excuses publiques, personne ne regarde sa famille. Les gens ne sont que des numéros de dossier, pas des personnes. Les bâches sous lesquelles sont les cadavres récupérés au sol le montrent. Alors que Roman s’est engagé comme sauveteur volontaire pour retrouver sa fille morte ; il a tenu son corps sans vie dans ses bras, c’était une personne, pas un numéro. L’argent est censé compenser la perte affective, mais c’est dérisoire. Roman se promène avec la photo de sa femme et de sa fille, mais nul ne les regarde, c’est cela qui lui fait le plus mal. Il veut que chacun reconnaisse sa responsabilité et avoue, présentant ses excuses. Mais ce n’est plus la norme dans la société bureaucratique d’aujourd’hui.


Au fond, dans cette catastrophe que personne n’a voulue, chacun cherche à se défausser : c’est pas moi, c’est l’autre ; je n’ai commis aucune erreur, c’était un accident ; je ne suis pas coupable, c’est le système. Le contrôleur aérien était seul dans sa tour, en soirée. Son acolyte était parti « manger » et deux techniciens sont venus permuter le téléphone (donc le couper provisoirement) en pleine activité de la tour de contrôle. Jonglant entre le fameux téléphone pas réactivé et ses écouteurs de contrôle sur deux postes, Jacob Bonanos (Scoot McNairy) n’a rien vu de la collision proche. Ce n’est pas de sa faute mais c’est de sa faute. Juif, il se sent coupable des vies perdues, ses voisins ne lui font sentir en taguant sa maison de sigles « assassins, meurtrier » ; employé, il est recyclé dans une autre ville sous une autre identité avec un autre travail, après une confortable indemnité. Façon de dire que la compagnie reconnaît ses manquements et son peu de rigueur, et les masque sous la banalité du destin.


Outre les vies fauchées dans le crash aérien, ce sont deux couples qui sont aussi brisés par cette catastrophe. Aftermath est en anglais une seconde coupe, une séquelle. Roman n’a plus de famille, lui qui était venu d’Europe centrale avec le rêve américain en tête ; Jacob voit son couple exploser parce qu’il devient irritable et obstiné, servant des œufs pas cuits à son fils Samuel que pourtant il adore, et ne comprenant pas pourquoi son épouse veut les faire recuire – comme s’il était incompétent, comme dans son travail de contrôleur aérien.


Un an plus tard, tout serait-il apaisé ? Non pas, Roman cherche à retrouver Jacob et use pour cela d’une journaliste qui s’asseoit sur la déontologie en lui donnant le nouveau nom et la nouvelle adresse de l’ex-contrôleur. Un cancer que cette presse qui veut tout savoir sur tout et exige la vérité de chacun, au risque du pire. Car c’est bien le pire qui survient. Si l’hypocrisie et la poussière sous le tapis de la compagnie aérienne doit être dénoncé, la vérité sur le bouc émissaire commode aussi. Ni le mensonge, ni la vérité ne sont absolus – mais relatifs aux circonstances, aux nuances, à l’humain. Les médias comme les compagnies aériennes ne le veulent pas. Pas plus Jacob que la compagnie ne veut penser à lui, Roman, à sa famille et aux victimes. Lorsque Roman vient sonner à la porte de son appartement, après avoir hésité (il est déjà venu une fois et est parti sans attendre), Jacob se contente de crier que c’était un accident, refusant de voir la réalité en face : la photo de la femme et de la fille – enceinte. C’en est trop pour Roman, vous le découvrirez dans le film.
Dix ans plus tard le fils de Jacob, Samuel (Lewis Pullman), est jeune adulte. Il retrouve Roman mais n’applique pas la loi du talion, qui est celle de sa religion. Il laisse aller Roman avec sa peine et avec la séquelle de son acte qui lui a valu la prison. Il lui donne une leçon : la vengeance ne sert à rien, qu’à perpétrer le crime. Roman aurait dû agir comme lui au lieu de s’enfermer dans sa douleur.


Tout le film se passe en hiver ou dans des atmosphères froides, grises, anonymes, comme une tristesse sur le monde. L’aéroport est banal, la maison de Roman conventionnelle, le nouvel appartement de Jacob sans âme. La musique même de Mark Todd insiste de façon lancinante. Tout le début est en rodage, comme un moteur grippé par l’ampleur de la catastrophe. Ce n’est que lorsque les deux personnages sont présentés alternativement, Roman et Jacob, que l’histoire peut commencer.
Au total un petit film avec le grand Schwarzy, endormi dans l’intimisme et qui se révèle bon acteur.
DVD Aftermath, Elliot Lester, 2017, avec Arnold Schwarzenegger, Maggie Grace, Scoot McNairy, Kevin Zegers, Hannah Ware, Metropolitan Films et Video 2017, 1h31, €8,99 Blu-ray €14,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)




















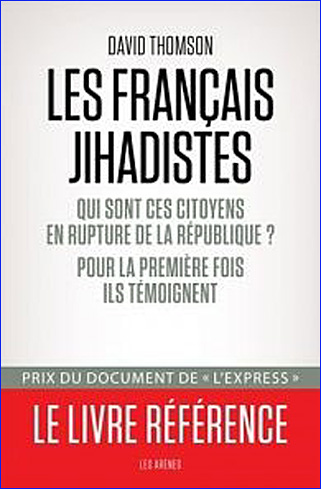

Commentaires récents