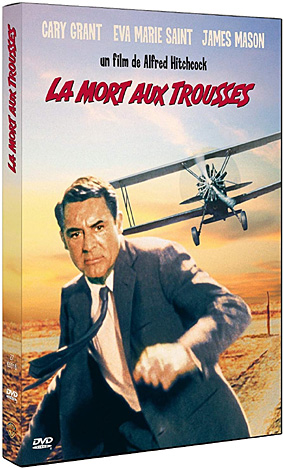
Roger Thornhill (Cary Grant) est un publiciste connu et pressé, deux fois divorcé. Il est élégamment vêtu d’un costume gris bien coupé avec une cravate dans le même ton. Drôle, direct, chic, il dicte à sa secrétaire les tâches qu’elle a à faire et à lui rappeler dans le taxi qui l’emmène au Plaza Hotel, grand palace de New York où il a un rendez-vous d’affaires. La dernière consigne, la plus urgente, est de rappeler sa mère pour un rendez-vous le soir même au théâtre. Mais le taxi est déjà reparti lorsque Thornhill se rend compte que sa mère va être injoignable, jouant au bridge à cette heure-ci.
Sitôt entré dans l’hôtel et assis devant ses hôtes, il mande un chasseur pour faire porter un message mais celui-ci lui indique la personne adéquate un peu plus loin derrière le comptoir. Thornhill se lève et se dirige vers l’endroit. A ce moment est diffusée une annonce qu’on demande un certain Monsieur Georges Kaplan au téléphone. Ceux qui guettaient Kaplan croient donc en toute bonne foi que Thornhill est leur homme et ils l’enlèvent carrément en plein hall en le menaçant sous la veste d’un pistolet.
Embarqué dans une puissante voiture péniche de ces années-là, le trio et le chauffeur se dirigent vers une imposante demeure sur la côte nord de Long Island, appartenant à un certain Mr Townsend. Kaplan est tenu de révéler comment il a connu l’organisation de ceux qui l’ont enlevé – sauf que Thornhill n’est pas Kaplan et ne voit pas de quoi ils veulent parler. Il résiste, maniant l’humour avant les poings, mais est terrassé. Puisqu’il ne veut pas avouer, il doit au moins disparaître. On lui fait avaler de force le contenu d’une bouteille de whisky avant de le coller, bourré, dans une décapotable et de le lancer sur la route en bord de falaise. Il va se crasher au prochain virage et la police croira à un accident.
Sauf que le conducteur est un grand gaillard qui résiste aux effets de l’alcool tant qu’il peut. Cary Grant effectue une performance d’acteur en roulant des yeux et en maniant le volant comme s’il était schlass. Heureusement, le capot des Mercedes ont un utile viseur en plein centre, ce qui permet de garder la route dans le collimateur. Thornhill évite donc le virage, tangue sur le ruban asphalté mais ne quitte pas la route. Les autres le poursuivent et il doit foncer. Jusqu’à ce qu’une voiture de police le prenne en chasse et l’arrête en état d’ivresse avancée. Il est sauvé, provisoirement.
Il appelle « maman » (Jessie Royce Landis) et son avocat qui va le tirer de là après « une nuit » de dégrisement. Le juge charge la police d’enquêter sur le soi-disant enlèvement dont Thornhill aurait été victime. A la demeure Townsend, personne, le maître des lieux prononce un important discours aux Nations-Unies et sa femme (Josephine Hutchinson) prétend que Roger s’est bien murgé et qu’il a pris par erreur la voiture d’une amie alors qu’il n’aurait même pas dû conduire. Tout le monde est alors persuadé qu’il affabule. Mais Roger Thornhill ne l’entend pas de cette oreille, il veut en avoir le cœur net. Il retourne à l’hôtel Plaza pour rencontrer le mystérieux George Kaplan mais constate que personne ne l’a jamais vu. Il laisse des messages, se fait livrer ses bagages, nettoyer ses costumes. Thornhill peut aisément demander sa clé en se faisant passer pour lui et fouille sa chambre mais ne trouve pas grand-chose, sauf que les costumes sont trop petits pour lui et qu’une photo représentant ceux qui l’ont enlevé traîne sur le bureau.
Il se rend donc aux Nations-Unies, après avoir échappé de justesse à ceux qui le traquent une fois de plus. Il rencontre là le « vrai » Mr Lester Townsend (Philip Ober), le diplomate, qui n’est pas celui qui s’est présenté sous son nom à la villa. Car elle est censée être vide, sous la garde du seul jardinier – et Mr Townsend est d’ailleurs veuf depuis des années ! A ce moment, comprenant qu’ils vont être en danger, l’un des sbires qui ont suivi Thornhill lance un poignard dans le dos du diplomate qui s’effondre. Thornhill a le stupide réflexe de le soutenir et d’empoigner le manche pour l’ôter : un photographe le prend à ce moment-là, l’air hagard, le couteau à la main. Cette photo fera le tour des journaux en première page et Thornhill sera accusé et activement recherché.

Il fuit donc la police jusqu’à la gare où il veut prendre un train pour la prochaine destination programmée de Kaplan, comme le lui ont appris ses ravisseurs, confirmé par le portier d’hôtel : Chicago. La blonde Eve Kendall (Eva Marie Saint), l’aide à échapper aux policiers en le cachant dans son compartiment couchette. Ils se retrouvent au wagon-restaurant, où elle a soudoyé le maître d’hôtel pour qu’il soit dirige vers sa table. En fait, elle craque pour lui et lui-même n’est pas insensible à cette femme maîtresse d’elle-même, pleine de ressources et qui sait ce qu’elle veut. Une femme bien différente des personnages féminins habituels d’Hollywood, hystériques, émotives et sans cesse en faiblesse. Surtout qu’elle joue triple jeu, le spectateur l’apprend en quelques minutes : si elle a aidé le faux Kaplan, c’est pour mieux l’attirer dans les filets des ravisseurs ; sauf qu’elle est infiltrée par les services secrets des États-Unis pour confondre les espions au service de l’Est ; et qu’elle joue au fond son propre jeu en cherchant à sauver la personne qui l’a si bien baisée dans le compartiment (le film ne montre que des embrassades, mais la suite donne une version plus ambiguë…).


Déguisé en porteur des bagages Kendall, Thornhill passe sans encombre la surveillance de la police et va se changer dans les toilettes tandis qu’Eve téléphone pour obtenir un rendez-vous avec Kaplan. Elle donne par écrit les instructions qu’elle a notées à Thornhill qui peut donc prendre le car pour descendre à un croisement de routes désertes en pleine cambrousse de l’Indiana et attendre. Suspense : il ne se passe rien et les rares véhicules qui traversent ne s’arrêtent pas. Soudain un homme descend d’un pick-up et attend, en face de Thornhill – mais ce n’est qu’un péquenaud qui va prendre le car en sens inverse. Dans la discussion, il s’étonne de voir un petit avion épandre ses pesticides au-dessus d’un champ qui n’est pas planté. D’ailleurs, une fois le champ libre, l’avion biplan fonce sur Thornhill avec l’intention de le tuer. C’est un grand moment de spectacle qui reste dans les anthologies. Thornhill se réfugie dans un champ de maïs pour ne pas être vu mais l’avion le déloge en épendant un nuage chimique. L’homme se précipite alors sur la route à la rencontre d’un camion d’essence qui freine in extremis, alors qu’il passe juste sous le capot. L’avion, qui cherchait à dézinguer Thornhill ne peut éviter la citerne et se crashe.


Le publiciste peut donc voler une voiture de badauds arrêtés devant le spectacle et rejoindre Chicago et l’hôtel de Kaplan. Mais le réceptionniste lui apprend qu’il a quitté les lieux le matin même à 7 h. C’est curieux, deux heures avant le soi-disant coup de téléphone à Kaplan par Eve… Laquelle réside dans le même hôtel. Thornhill monte à sa chambre et elle a l’air surprise bien qu’heureuse de le voir en vie, même si elle avait passé son amant chic par pertes et profits. Elle reçoit un appel qui lui confirme un rendez-vous, qu’elle note sur le calepin mais ôte la page. Elle convie Thornhill à prendre une douche – froide – et à faire nettoyer son costume plein de poussière et de pesticide par le groom. Cela lui fait gagner du temps. Mais Thornhill retrouve aisément l’adresse en noircissant la feuille pour faire apparaître ce qui est écrit en relief. Il s’agit d’une salle des ventes, dans laquelle la bande sous la direction du faux Townsend nommé Vandamm (James Mason) enchérit pour une statuette. Les issues sont surveillées par les sbires armés et Thornhill, décidément inventif et plein d’humour, n’a d’autre choix que de susciter un esclandre afin d’être exfiltré par la police. A qui il révèle son identité réelle, et il est libéré.


Sur les instances du Professeur (Leo G. Carroll), chef d’une agence de renseignements du gouvernement, lequel confie à Thornhill que Kaplan n’existe pas et qu’Eve est un agent ami infiltré dans l’organisation au péril de sa vie. Thornhill, qui avait pour elle des sentiments et s’est trouvé bafoué, comprend et pardonne. Malgré les ennuis que cela va encore lui valoir, il veut la sauver. Le Professeur prend avec lui un vol de la Northwest Airlines (d’où le titre américain du film) pour Rapid City au Dakota du Sud. C’est la prochaine destination programmé du fictif Kaplan, où Vandamm possède une demeure et d’où il envisage de fuir en avion vers le Canada.
Thornhill a donné rendez-vous à Vandamm et Kendall dans une cafétéria en contrebas du monument du mont Rushmore. Pour lever les soupçons sur elle et parfaire sa couverture, Eva abat Roger de deux coups de feu… à blanc. Dans la séquence, le spectateur peut apercevoir un gamin en chemise bleu roi en arrière-plan qui se bouche les oreilles AVANT le coup de feu, signe que la scène a été répétée plusieurs fois. Eve fuit et Thornhill, laissé pour mort, est emmené en ambulance par le Professeur. Ils se rencontrent dans un bois où chacun avoue à l’autre qu’il tient à lui. Mais Eve doit retourner auprès de Vandamm, qui a le béguin pour elle, et s’envoler avec lui pour en savoir encore plus sur l’organisation. Roger refuse car elle risque sa vie, et le chauffeur, sur ordre du Professeur, le met KO ; ils vont l’enfermer plusieurs jours dans l’hôpital, pour la vraisemblance.
Mais Roger s’enfuit et rejoint la villa de Vandamm où il surprend une conversation entre lui et Leonard (Martin Landau), son sbire numéro deux. Ce dernier a découvert que le pistolet d’Eve ne portait que des balles à blanc et les espions décident de l’éliminer en le jetant du haut de l’avion dans les flots lorsqu’il seront partis. Thornhill fait alors des pieds et des mains, au sens littéral acrobatique, pour grimper à la chambre, écrire un petit mot sur la pochette d’allumettes à ses propres initiales, et avertir Eve qu’elle ne doit surtout pas monter dans l’avion. Celle-ci, in extremis, s’empare de la statuette qui contient en fait les microfilms des documents récoltés par les espions, et fuit en direction de Roger. Il a dû s’extirper d’une matrone intendante de la villa qui braquait un pistolet sur lui… qu’il a reconnu être celui d’Eve chargé à blanc.


Le couple fuit donc avec les documents, poursuivi par les espions, jusqu’au sommet des fameuses têtes de présidents sculptées dans la roche du mont Rushmore. Valerian le sbire numéro un (Adam Williams) dérape de lui-même et s’écrase en bas tandis que Leonard saute sur Thornhill et récupère la statuette. Mais Eve est en difficulté et Roger lui tend la main, qu’elle attrape in extremis, le reste de son corps pendant dans le vide. C’est alors que la godasse du sbire vient écraser la main du sauveur pour les précipiter tous deux dans l’abîme. Une balle providentielle, commanditée par le Professeur sur la rive d’en face, met fin au suspense et le couple est sauvé, ainsi que les microfilms. Ils furent heureux et eurent (peut-être) de beaux enfants.
DVD La mort aux trousses (North by Northwest), Alfred Hitchcock, 1959, avec Cary Grant, Eva Marie Saint, Jessie Royce Landis, Leo G. Carroll, James Mason, Warner Bros Entertainment France 2011, 2h11
DVD Alfred Hitchcock : La Collection 6 Films, Le Grand alibi, Le Crime était presque parfait, La Loi du silence, La Mort aux trousses, L’Inconnu du Nord-Express, Le Faux coupable, Warner Bros Entertainment France 2012, 10h27

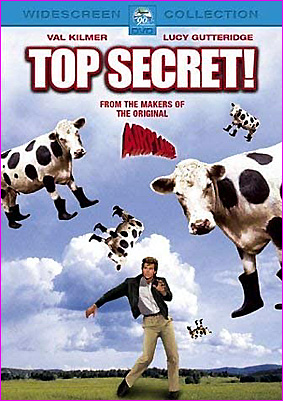






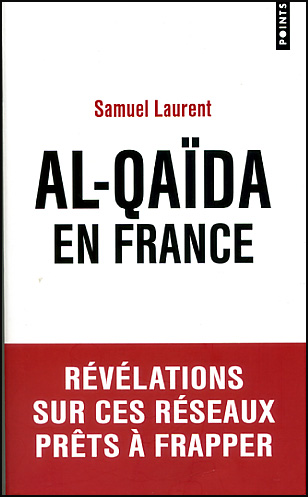



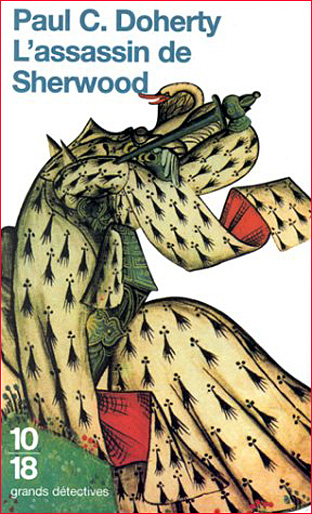





Commentaires récents