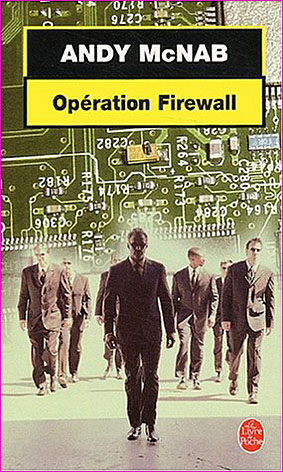
Un thriller efficace et orienté sur tous les détails précis de la mission, ce qui change des thrillers yankees. Car Andy McNab (pseudonyme) est anglais, enfant trouvé, mauvais élève, entré dans l’armée à 16 ans et à 25 ans dans le Special Air Service (SAS), les services spéciaux. Lorsqu’il écrit des romans, il sait donc de quoi il parle. Il n’est ni scénariste, ni journaliste reconverti dans l’écriture populaire, mais un vrai spécialiste qui compose ses scénarios à partir de la réalité qu’il a vécue.
Nick Stone le narrateur est un baroudeur qui a foiré une mission aux États-Unis à cause d’une pétasse qui l’a embobiné. Suspendu par les services secrets de Sa Majesté, il a cependant de pressants besoins d’argent. Il a adopté la fille d’un coéquipier massacré avec toute sa famille – sauf la fillette, Kelly, traumatisée à 7 ans. Elle est dans une clinique psychiatrique privée qui coûte les yeux de la tête mais qui représente sa seule chance de guérison. Comme le service ne lui paie qu’un salaire minimum en disponibilité, il se voit dans l’obligation de se proposer à des clients privés.
La mafiocratie russe grenouille en plusieurs bandes concurrentes qui se battent en guerre ouverte pour accéder aux secrets informatiques derniers cris de l’Occident. C’est ainsi que le commando se retrouve à Helsinki, chargé avec une équipe de bras cassés plus ou moins russes, d’enlever un mafieux tchétchène rusé enrichi dans le trafic d’armes et de putes nommé Valentin Lebed. Tout est minutieusement préparé, à la militaire, les lieux repérés, les points de fuite, le nombre de gardes du corps, les armes, le minutage. Nick se repasse en boucle le film prévisionnel du déroulement des opérations et tout à l’air de coller.
Sauf que, dans le réel, rien ne va jamais comme prévu. L’un des sbires, Carpenter, est un psychopathe shooté qui a perdu du temps à flinguer des gens déjà devenus cadavres au lieu de dézinguer les gardes surpris, encore au dehors. Nick, en bon professionnel, est obligé de se débrouiller tout seul. Il enlève Val et le mène à la planque, où un certain Sergueï, ex-Spetnaz, les commandos spéciaux du KGB, doit jouer les médiateurs pour le commanditaire et faire passer en fraude le colis en Russie, où l’une des mafias concurrentes en prendra livraison. Sauf que Sergueï est mort dans l’assaut et que Nick ne sait pas quoi faire de son prisonnier. Lequel lui propose une affaire s’il le relâche. Faute de mieux, et n’étant lié par aucun patriotisme ni aucune idéologie en ce qui concerne les bagarres entre mafias de l’est, Nick accepte.
Il s’agit d’aller télécharger, sans se faire repérer et en ne laissant aucune trace, des fichiers informatiques gardés dans une maison isolée en Finlande. Pour cela, Nick doit recruter un hacker déjà connu de lui, Tom Mancini. Nick assurera le repérage, l’entrée en douceur et l’évacuation tandis que Tom piratera les codes et aspirera sur support adéquat les disques durs. Mais Val ne veut pas apparaître, il est trop surveillé. C’est une belle compagne blonde aux longues jambes, Liv, qui est chargée de l’interface.
Là encore, tout se passe comme prévu sauf – à l’ultime moment – le grain de sable sous la forme d’un commando spécial américain qui surgit de nulle part. Bagarre, fait prisonnier, la maison cible vidée et nettoyée, les ordinateurs embarqués dans de gros 4×4 noirs très US, Nick se retrouve une fois de plus seul et en mauvaise posture. Pas grave, il a de la ressource. Il parvient à se libérer des liens et de la cagoule, assomme le chef de mission chargé de le liquider, puis vient rendre compte. Liv lui dit qu’elle sait déjà mais que Val ne lui en veut pas, l’intervention des Américains n’était pas prévisible à ce moment.
Par l’intermédiaire de la fille, le mafieux lui propose une autre mission, en doublant ses émoluments. Retrouver Tom, enlevé par une mafia russe au moment de la dernière intervention, détruire entièrement la ferme à espionnage située près de Narva, à la frontière russe de l’Estonie. Il est tout seul, il se débrouille. Faute de plastic pour faire exploser les murs, il malaxe des intérieurs de vieilles mines antichars soviétiques qu’un mafieux « de 17 ou 18 ans » lui livre, sur les ordres d’Ignaty, un copain de Val. La vieille Lada rouge rouillée du maltchik ne démarre qu’à coup de marteau mais elle fait l’affaire pour transporter le matériel, minutieusement décrit.
Tout se passe bien et la ferme explose, détruisant tout le système informatique. Nick parvient même à récupérer Tom, sonné et grognon, mais vivant. Sauf que la Lada n’est plus là où il l’a laissée, volée par des paysans en tracteur qui n’ont eu qu’à la faire glisser sur le sol gelé pour l’embarquer. Il faut aller à pied par un froid intense. Tom, peu aguerri à ces exercices, y laisse la vie d’hypothermie, comme deux compagnons du véritable Andy en Irak. Lui rejoint Tallinn par le train, puis la Finlande par ferry et l’Angleterre avec des immigrés somaliens clandestins. Il n’a plus de passeport.
Mais quand il retrouve Liv, selon la procédure de « boite aux lettres » morte convenue, ce n’est pas Liv mais une déguisée. En revanche, Val est bien là et lui révèle dans quoi il a mis les pieds. Bon prince, pour lui avoir sauvé la vie, il le paie comme convenu, mais « en appartements à Saint-Pétersbourg » – ce qui ne fait pas l’affaire de Nick qui a besoin de cash pour payer la clinique de Kelly.
Il se retrouve donc accepter une nouvelle mission pour le Service, où il retrouve… Je vous laisse le suspense.
L’histoire est tordue et à épisodes, mais tout le plaisir réside dans la description quasi maniaque des préparations de missions. Un bon professionnel vaut mieux qu’un mauvais romancier et la précision des détails des vrais spécialistes exerce un effet de fascination plus grand que les ellipses invraisemblables des héros de papier. Où l’on rencontre la guerre des mafias russes entre elles, la guerre des services contre elles, le réseau Échelon de surveillance planétaire des écoutes de la part des quatre anglo-saxons (USA, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande) – et le froid polaire des pays du nord. Même après la chute de l’Ours, l’Occident reste en guerre froide contre les Méchants…
Andy McNab, Opération Firewall (Firewall), 2000, Livre de poche 2003, 474 pages, occasion €1,54 (liens sponsorisés Amazon partenaire)


Commentaires récents