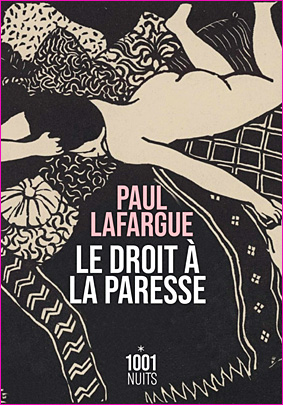
La vulgate croit, au vu du seul titre, qu’il s’agit d’une revendication à la flemme par un fout-rien révolutionnaire. Il n’en est rien. Il s’agit certes d’un pamphlet, certes du gendre de Karl Marx, certes pour contester le culte du travail, mais qui rappelle quelques évidences de bon sens. Un bon sens tordu par deux mille ans de christianisme et par deux siècles de bourgeoisie capitaliste.
Ce bon sens est : le travail fatigue, il doit être effectué pour vivre, mais limité pour bien vivre.
Paul Lafargue est né à Cuba, d’où son expérience enfantine de l’indolence propre aux tropiques où la nature offre en surabondance ses fruits – mais où il a aussi connu l’esclavage des nègres dans les plantations. Issu d’un Bordelais et d’une Juive à ascendance caraïbe, il appartenait donc à « trois races » comme on disait alors, faisant de lui l’exemplaire métèque d’une humanité en soi, sortie des glèbes et des gènes. Étudiant en médecine à Bordeaux, il devient proudhonien et franc-maçon avant d’adhérer à l’Internationale, où il va beaucoup s’investir en faveur des ouvriers et rencontrer Karl Marx. Il tombera amoureux de Laura, sa fille gâtée surnommée Kakadou, et l’épousera.
Il réunit en 1883 en un pamphlet de moins d’une centaine de pages une série d’articles qu’il a fait paraître en 1880 dans la revue hebdomadaire L’Égalité. Il réfute surtout le « droit au travail », de 1848, réclamé par les ouvriers alors qu’il faisait d’eux des esclaves. Il lui oppose un « droit à la paresse » qui n’est pas une fainéantise de chômeur (vue bourgeoise) ou de SDF hippie antisystème (vue gauchiste après 68) mais une saine régulation du labeur (vue démocratique et écologiste d’aujourd’hui). La Constituante de 1848, cette fameuse « révolution » chantée par toute la gauche après celle de 1789, dont par le « charlatanesquement romantique Victor Hugo », avait en effet instaurée la journée de douze heures, enfants de 8 ans et vieillards décrépits compris. Quel progrès depuis les Grecs raille Lafargue ! Ceux-ci considéraient en effet le travail comme une fonction d’esclave ou de machine ; les vrais hommes préféraient le sport et la philosophie, s’entraînant à être plutôt de parfaits citoyens votant aux assemblées et participant à la défense de la cité.
La bourgeoisie du XIXe siècle industriel, au contraire, reprend la vilenie chrétienne de l’homme voué à la souffrance ici-bas, selon le discours de Thiers. « Aux XVe et XVIe siècle [la bourgeoisie] avait allègrement repris la tradition païenne et glorifiait la chair et ses passions, réprouvées par le christianisme ; de nos jours [1880], gorgée de biens et de jouissances, elle renie les enseignements de ses penseurs, les Rabelais, les Diderot, et prêche l’abstinence aux salariés. La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d’anathème la chair du travailleur ; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci. » Une idéologie de l’exploitation qui fait croire au salut par le travail tout en organisant la misère : payer juste ce qu’il faut pour la survie, mais sans aucun surplus qui entamerait le profit. Capital et goupillon, même combat ! Assuré par le sabre qui est aux ordres et ne produit rien. Il s’agit d’une religion du capital, dit Lafargue, dont l’excommunication est le chômage, l’exclusion de la communauté des vrais hommes qui, eux, travaillent.
Or exercer un travail est bienfaisant au corps et à l’esprit tout en étant utile à la société, dit encore Lafargue, à condition qu’il soit limité dans le temps. Pour lui, « trois heures par jour » devraient suffire ! « Pour forcer les capitalistes à perfectionner leurs machines de bois et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures de travail des machines de chair et d’os. »
Assez prémonitoire sur l’essor de la technique et de la productivité, convenons-en.
La production poussée par le surtravail aboutit à la surproduction cyclique, analyse Lafargue. C’est alors « la crise » – économique avec ses destructions d’emplois et de marchandises afin d’assainir les prix, – sociale avec l’essor de la misère et de la grogne allant jusqu’aux émeutes de banlieues, de casseurs ou de gilets jaunes, – et politique avec la montée de la défiance, le recours aux croyances et au Complot, la démagogie populiste qui favorise l’élection des extrêmes. Le travail excessif provoque donc du gaspillage et du désordre qui, par contrecoup, encourage l’aspiration à la dictature.
Dans le même temps, les bourgeois oisifs qui vivent de la rente se sentent obligés de s’empiffrer, au mépris de leur santé, et d’attifer leurs grognasses jamais contentes de colifichets luxueux et inutiles, qui sont d’autres gaspillages, tout en allant aux putes pour tenir leur rang social et ne pas déranger l’ordonnance de la coiffure de Madame.
Quant aux capitalistes actionnaires, ils attisent les désirs pour conquérir de nouveaux marchés : intérieurs par l’obsolescence programmée (« tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l’écoulement et en abréger l’usage »), la publicité et le marketing afin de susciter des besoins inutiles ; extérieurs par l’exportation, voire la colonisation, et l’évangélisation afin que « les culs noirs qui vont tout nu » soient forcés de se vêtir des cotonnades de Manchester. « Ils forcent leur gouvernement à s’annexer des Congo, à s’emparer des Tonkin, à démolir à coups de canon les murailles de la Chine, pour y écouler leurs cotonnades. » En attendant notre moderne soft power où les Américains sont devenus experts, imposant leurs logiciels qui aspirent sans notre consentement nos données, leurs fiestas commerciales de la Fête des mères, d’Halloween et du Black Friday, fourguant leurs « marques » et leurs « produits dérivés » à tout va – encore un gaspillage de ressources et de temps.
Assez prémonitoire sur nos préoccupations écologiques, convenons-en.
Même sous l’Ancien régime, au temps des corporations les artisans avaient des jours fériés et des fêtes religieuses qui coupaient le temps de travail. « Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l’amour et rigoler ; pour banqueter joyeusement en l’honneur du réjouissant dieu de la Fainéantise », s’exclame Paul Lafargue. Aujourd’hui, la natalité décline et la « fête » est droguée pour s’évader.
Assez prémonitoire sur notre aspiration aux trente-cinq (puis trente) heures et sur les revendications à ne pas augmenter l’âge légal de la retraite, convenons-en.
Surtout que Paul Lafargue s’est suicidé au cyanure à l’âge exact de 70 ans avant que la vieillesse ne le dépouille de ses forces et des plaisirs de l’existence – d’où sa revendication à une retraite précoce. Il y a entraîné sa femme qui n’avait que 66 ans, mais l’époque imposait à la femme le pouvoir de l’homme.
Au total, ce court pamphlet écrit d’un ton allègre recense nombre d’arguments utiles et toujours d’actualité sur le temps de travail, la souffrance au travail, l’épanouissement au travail. Il mérite d’être (re)lu.
Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1880, Fayard Mille et une nuits 2021, 80 pages, €3,00 e-book Kindle €0,99 ou emprunt abonnement

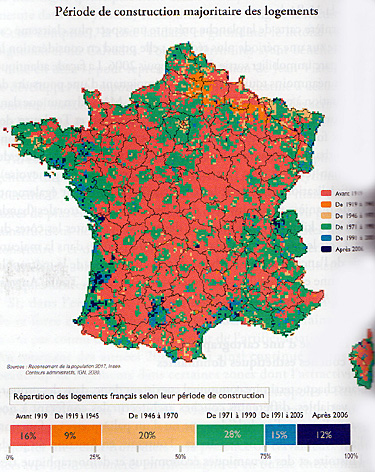
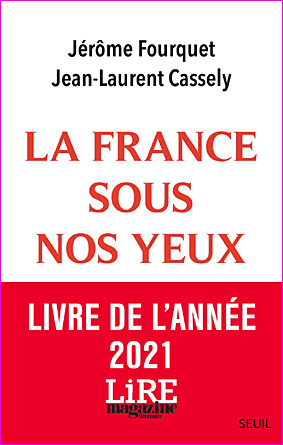
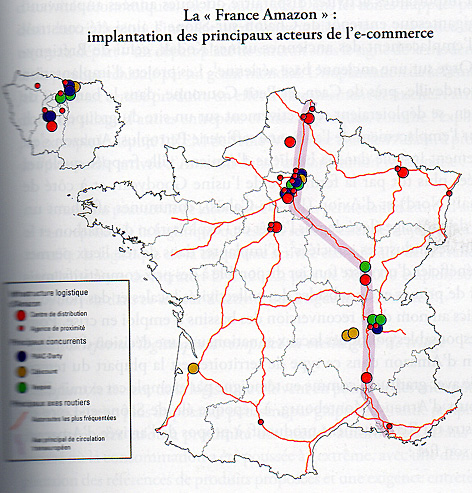
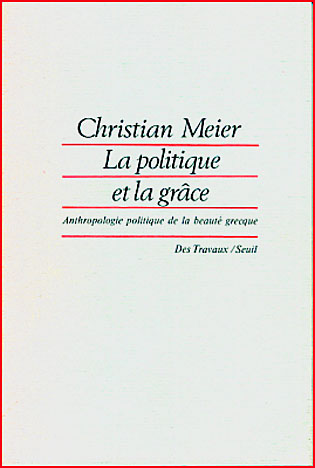
Commentaires récents