C’est un petit bijou de synthèse et de clarté commandé par Georges Dumézil que nous a laissé l’historien anthropologue de la Grèce antique Jean-Pierre Vernant, premier à l’agrégation de philo 1937, accessoirement colonel Berthier dans la Résistance avant d’être nommé professeur au Collège de France. En trois parties, il part de l’histoire pour aborder l’univers de la cité et l’organisation du cosmos humain. La pensée grecque était l’émanation d’une culture originale, une façon de voir le monde.
Lors de l’invasion achéenne entre 2000 et 1900 avant notre ère, des indo-européens importent un nouveau style de mobilier et de sépulture, donc un autre mode de vie ; ils s’étendent dans tout le Proche-Orient du XIVe au XIIe siècle avant. La vie sociale est centrée autour du palais dont le rôle est religieux, politique, militaire et administratif, économique. Tous les pouvoirs sont concentrés en la personne du roi (anax) qui contrôle un territoire étendu, soumis à la comptabilité et aux archives des scribes, une caste fermée qui fixe la langue écrite. Le roi s’appuie sur une aristocratie guerrière liée par une fidélité personnelle d’allégeance. Ce n’est ni une royauté bureaucratique comme à Sumer, ni une monarchie féodale comme au Moyen Âge, mais un service du roi. Les dignitaires du palais manifestent, partout où la confiance du roi les a placés, le pouvoir absolu de commandement qui s’incarne dans le fief non héréditaire.
L’invasion dorienne du XIIe siècle avant détruit le système palatial achéen et l’écriture dite Linéaire B. L’anax disparaît, la distance entre les hommes et les dieux devient incommensurable et deux forces sociales sont laissées en présence : les communautés villageoises et l’aristocratie guerrière. Cet état de fait n’est pas sans nous rappeler certains états sociaux contemporains.
La recherche d’un équilibre entre ces deux forces antagonistes fait naître, au début du VIIe siècle avant, une « sagesse » fondée en ce monde-ci.
Pour la guerre, le char a disparu avec la centralisation politique et administrative qu’il exigeait pour le payer et l’utiliser. En religion, chaque clan familial (genos) s’affirme possesseur de rites et de récits secrets qui leur confère du pouvoir. En politique, la joute oratoire devient une méthode publique d’échange d’arguments. La ville se bâtit autour de l’agora et non plus autour de la forteresse du roi ; la citadelle est remplacée par le temple de la cité. L’Exécutif se scinde en fonctions spécialisées : le basileus (roi) voué aux fonctions religieuses, le polémarque chef des armées, l’archontat qui exerce la magistrature élu pour dix ans, puis chaque année.
Dans l’univers de la polis règne la parole (divinisée en Peitho, force de persuasion). Ce n’est plus énoncer des mots rituels mais débattre, ne plus formuler un verbe définitif mais soumettre des arguments rationnels dans un double mouvement de démocratisation et de divulgation. Le savoir n’est plus secret, réservé à une caste, mais répandu par l’écriture et les controverses : les plus anciennes inscriptions en alphabet grec remontent au VIIIe siècle avant. La rédaction des lois (diké) est soustraite à l’autorité du roi pour être publique, objective et annoncée ; il s’agit d’établir une règle commune à tous, pleinement humaine et non plus divine, mais supérieure à tous par sa force rationnelle. La loi reste soumise à discussion et est modifiable par décrets.
Les anciens sacerdoces sont confisqués par la polis qui en fait des cultes officiels dans des temples ouverts et publics, sans plus de salles secrètes réservées à des initiés. Les vieilles idoles perdent leurs mystères et n’ont plus d’autre réalité que leur apparence. La lumière grecque – que mon prof de philo disait être à l’initiative de la clarté philosophique – chassait l’obscurité, l’obscurantisme et les obscurs complots. Les associations purement religieuses fondées sur le secret et dont le but est de faire son salut personnel prennent le relai, mais en marge, indépendamment de l’ordre social. Les philosophes ont alors un rôle ambigu, entre l’élitisme de n’enseigner qu’à quelques disciples choisis et aimés, et les débats publics qui sont la seule façon de se qualifier pour diriger la cité. Apollon ou Dionysos ?
Les citoyens se conçoivent abstraitement comme interchangeables dans un système où la loi est l’équilibre et la norme l’égalité (isonomia). A noter que les esclaves et les métèques sont exclus du statut de citoyen, sauf à le devenir par leurs mérites pour la cité. Le hoplite ne connaît plus le combat singulier et la gloire personnelle (eris) mais la bataille en rang et la discipline dans le groupe (philia). Les grands guerriers nus gaulois n’ont pas connu cet enrôlement collectif, ni la société celtique l’objectivation des règles par l’écriture – ce pourquoi ils n’ont pas survécu à la puissance romaine organisée. L’idéal de comportement grec devient la réserve et la retenue qui effacent les différences de mœurs et de conditions entre les citoyens dans le but de les unir comme une seule famille.
Le cosmos humain s’organise autrement qu’avant. La cité entre en crise en raison de la poussée démographique qui fait rechercher par mer de nouvelles terres, du métal, et qui ouvre vers l’Orient dont le luxe séduit l’aristocratie. Naît alors une opposition entre les propriétaires fonciers qui concentrent la richesse et les paysans périphériques qui s’appauvrissent. L’argent remplace l’honneur, mais il ne comporte aucune limite et pousse à la démesure (hubris). C’est alors que, par contraste, nait l’idéal de juste milieu (sophrosyne), un équilibre social de classe moyenne incarné par le législateur Solon. La justice lui apparaît comme un ordre naturel se réglant de lui-même, dont le désordre n’est dû qu’à l’hubris personnel. L’idéal libéral en est la continuation historique, les vices humains devant être disciplinés et les écarts corrigés par la loi, l’Etat arbitre définissant les règles communes. Les affects (humos) se doivent, en Grèce ancienne, d’être disciplinés par la raison.
L’égalité géométrique de proportions (isotes) conduit à une cité harmonieuse si chacun est à sa place et a le pouvoir que lui confère sa vertu : le mérite est ici moral et pas uniquement intellectuel. L’homme grec est total, incluant volonté, courage et caractère en plus des capacités cérébrales – l’intelligence est la logique mais aussi la ruse (metis). Vers 680 avant notre ère apparaît la monnaie d’Etat, substituant à l’ancienne image affective l’abstraction de la nomisma, un étalon social de valeur pour égaliser les échanges.
Au VIe siècle avant naît un mode de réflexion neuf avec Thalès, Anaximandre, Anaximène : le divin et le monde font partie d’une même nature (physis) ; l’origine et l’ordre du monde ne sont plus la souveraineté d’une puissance magique mais une question explicitement posée, susceptible de quête scientifique et de débat public. Les religions du Livre reviendront sur cette avancée de la pensée. Pour les Grecs, il existe une profonde analogie de structure entre l’espace institutionnel humain et l’espace physique naturel. Platon avait fait graver au fronton de son académie cette maxime : « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». L’univers est connaissable car il est mathématique et l’intelligence peut appréhender sa logique, même si elle reste limitée face à l’incommensurable de l’univers. Et si homo sapiens est homo politicus (zoon politicon en grec), c’est que la raison est d’essence politique : elle n’est pas purement individuelle et ne progresse que par le débat ouvert ; elle ne se soumet en tout cas pas au diktat d’un prétendu divin que ses interprètes autolégitimés captent pour assurer leur pouvoir !
Ces origines grecques nous font mesurer aujourd’hui combien le balancement est éternel entre le fusionnel et le rationnel, l’autorité d’un seul par la bouche duquel parlent les dieux et l’autorité collective construite par l’approbation de la majorité aux règles communes après débat public et transparent. Nous n’en sommes pas sortis : les forces tirent aujourd’hui sur le repli, l’abandon au plus fort, la protection royale ; elles rejettent la curiosité et l’exploration, la discipline et la construction de soi, la participation démocratique. Communauté ou société ? L’éternel combat des Doriens modernes contre l’ancien régime achéen.
Relire ce petit livre d’anthropologie historique est un bonheur pour penser l’essentiel.
Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962, PUF 2013, 156 pages, €10.00
Jean-Pierre Vernant sur ce blog

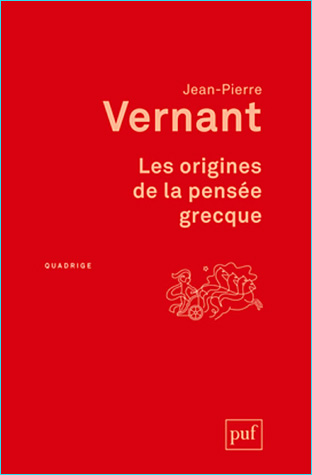

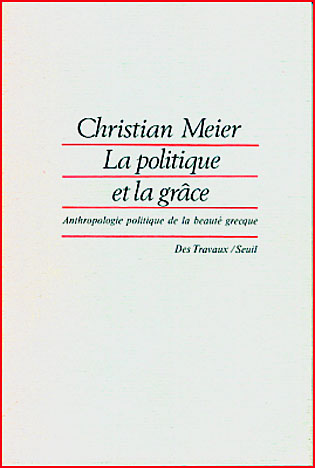
Commentaires récents