Nigel Barley est anthropologue, docteur d’Oxford, et manie l’humour avec la maîtrise native d’un Anglais. Ses précédents livres narraient ses aventures parmi les peuplades de diverses brousses. Il se lance ici dans le récit romancé des avatars d’un pasteur en terre africaine de l’ouest, quelque part sur la côte sud du Nigeria. Le révérend dont il est question a réellement existé et a publié son journal au XIXe siècle. Barley en reprend d’ailleurs quelques pages telles quelles dans ce récit romancé. Le choc des cultures entre le victorien biblique coincé et les nègres nus paillards et rusés vaut son pesant de cauris ! Rien de tel pour se moquer de l’ethnocentrisme sûr de lui et dominateur des Anglais d’Empire que de les confronter à la réalité musclée des hommes. Nigel Barley y excelle.
Le lieu, tout d’abord, est sans limitations précises, indécis entre la terre et la mer, une embouchure de fleuve marécageuse. Toute vie y grouille sans vergogne, bâfrant, copulant et guerroyant pour exister. Les êtres humains du cru ne sont pas en reste, qui se baladent seins et couilles à l’air ou s’ornent d’oripeaux européens tels que chapeau claque ou épaulettes d’amiral sur torse nu. Un ex-esclave est devenu roi par ruse et le fils du roi légitime n’est que duc, rapidement vaincu lorsqu’il se mêle d’intriguer. Les écoliers invités à la toute neuve mission frottent leur nudité sur les bancs et ouvrent de grands yeux devant les images bons points où deux Jean-Baptiste valent un Moïse et dix Moïse un Jésus. Les filles pubères font un stage dans la maison d’engraissement afin de prendre les formes qui les rendront bonnes à marier, tandis que les jeunes hommes chassent l’esclave pour le sacrifier lorsqu’un dignitaire meurt.
Le révérend et sa trop tendre épouse méritante auront fort à faire pour civiliser tout ça ! Ils ne sont pas aidés… L’anthropologue Barley note finement qu’« il existe une règle selon laquelle toutes les institutions publiques évoluent de manière à fonctionner pour le bénéfice exclusif de ceux qui y travaillent sans plus tenir compte du moindre objectif externe » p.87 C’était le cas du consulat anglais en terres nègres. Véritable fonctionnaire, le consul ne veut aucune vague et lorsque les commerçants se plaignent, il leur donne raison ; lorsque le missionnaire se plaint, il a raison ; lorsque Londres exige, il transige. « L’école est l’institution qui permet aux Anglais de prendre conscience, pour le reste de leur existence, de l’arbitraire et de la brutalité capricieuse des autorités » p.88 Le consul voit sa position en termes identiques : il doit faire régner l’ordre en apparaissant le moins possible pour ne pas se mouiller.
L’esclavage est-il interdit par la Couronne ? Qu’à cela ne tienne, les planteurs « louent » les nègres pour cinq années et les exportent vers la Jamaïque – où ils restent. Quant aux Noirs entre eux, l’Angleterre ne peut se mêler d’éradiquer l’esclavage, ce serait une ingérence intolérable dans les affaires intérieures de leurs royaumes. Il existe donc des marchés aux esclaves où « ils sont exposés, nus, comme de la viande à une foire agricole. » Le révérend est atterré. « On proposait un petit garçon pour quinze bracelets de cuivre. J’ai failli l’acheter moi-même car c’était la seule manière, pour lui, de retrouver sa liberté, mais je me rends compte qu’on ne peut se battre seul contre ce mal » p.180.
Sorcellerie, empoisonnement, menaces ; termites, humidité, fièvres ; caprices, usages, veulerie. Rien n’est épargné au révérend. Il perturbe les commerçants en prêchant l’égalité chrétienne entre Blancs et Noirs ; il perturbe l’autorité du consul au nom d’intérêts supérieurs ; il se braque contre les coutumes des rois nègres les mieux établies. Quel empêcheur de bâfrer, de baiser et de massacrer en rond que cet ecclésiastique ! On s’en débarrassera, bien sûr…
Dans un festival d’humour, l’histoire se déploie, tragique et pitoyable, hésitant entre la bigoterie et les mouvements du cœur. Qu’il était donc dur d’être pasteur en pays païen, il y a deux siècles ! Et qu’il est dur d’être occidental aujourd’hui… en Chine, Arabie Saoudite, Libye, Venezuela, Soudan, Corée du nord, Cuba et ainsi de suite !
Nigel Barley, Le dernier voyage du révérend (The Coast), 1990, Petite Bibliothèque Payot 2004, 247 pages, €8.89

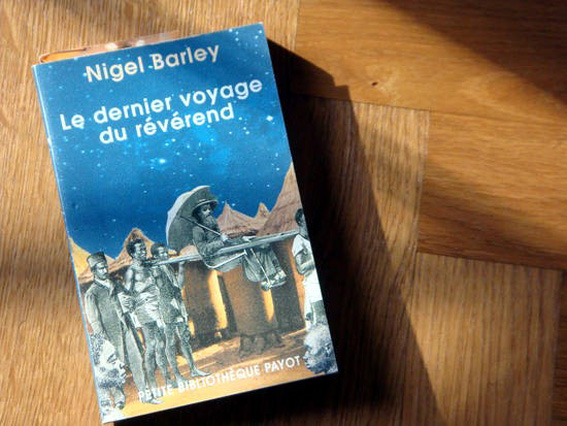






Commentaires récents