Zarathoustra est son prophète et il est voyageur. « Tout en gravissant la montagne, [il] songea en route aux nombreux voyages solitaires qu’il avait accomplis depuis sa jeunesse, et combien de montagnes, de crêtes et de sommets il avait déjà franchis. » Il n’aime ni les plaines, ni rester immobile car la vie va et le monde change ; il faut aller et changer avec lui pour y adapter sa volonté. « On finit par ne plus vivre que ce que l’on a en soi. »
A un certain âge, « les temps sont passés où je pouvais m’en remettre au hasard, et que m’adviendrait-il encore qui ne m’appartienne déjà ? » Tel est ce qu’on appelle le destin, celui que l’on façonne jour après jour, et qui finit par nous ressembler. On n’a que ce que l’on mérite ; un bienfait n’est jamais perdu ; les actes vous rattrapent toujours. Les expressions sont innombrables sur ce constat. On ne devient que ce que l’on est – et tant pis si l’on est peu de chose.
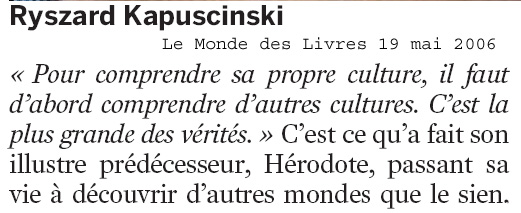
Mais « le sommet et l’abîme sont confondus » car gravir une montagne, réussir une chose, ne suffit pas, il faut redescendre pour trouver la fin de toute terre, l’océan profond. Sisyphe, sans relâche remontait son rocher, que la pente faisait débouler une fois en haut. Zarathoustra, après l’ultime sommet, ne voit que la mer devant lui, l’infini des possibles sur lesquels tracer sa propre route.
« Pour voir beaucoup de choses, il faut détourner les yeux de soi ». Ainsi fait le voyageur qui se dépayse, se décentre et s’acculture – pour mieux se connaître et se retrouver. Le localisme, le narcissisme ou le dogmatisme aveuglent. Rester chez soi immobilise le corps ; être content de soi assèche le cœur ; croire avoir enfin établi ses convictions rigidifie l’esprit. « Celui qui s’est beaucoup ménagé, l’excès de ménagement finit par le rendre malade. Béni soit ce qui rend dur !» Le voyage endurcit car on ne sait jamais de quoi demain sera fait, ni avec qui.

La mer paraît endormie, la fin des terres – Finistère, Land’s End, cap de Bonne Espérance – « mais son haleine est chaude ». Elle est un monstre assoupi, l’univers de toutes les possibilités, l’eau primordiale de laquelle toute vie est sortie en même temps que l’eau dernière, vers laquelle tout revient. Elle est innocente et oubli, premier commencement et fin, éternel retour du même cycle de l’eau, des courants immuables et des marées périodiques. Peut-être est-ce ainsi qu’il faut lire la métaphore de la mer chez Nietzsche, et celle du voyageur – bien que le philosophe préfère les montagnards aux marins – question de climat.
La mer, source car Zarathoustra a « l’amour de toutes choses pourvu qu’elles soient vivantes ! ». Il est l’éternel solitaire et en même temps il a des amis, ce pourquoi il pleure et rit à la fois, soucieux de toutes ses capacités. Il veut tout embrasser – en même temps.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents