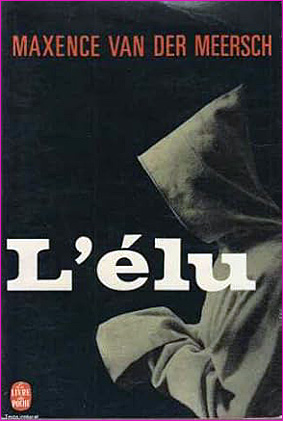
C’est un roman ancien d’un auteur oublié parce que régionaliste, malgré son Prix Goncourt et son entrée à l’Académie française. Pourtant l’auteur, humaniste chrétien, mérite d’être relu tant son époque (les années trente) a nombre de points communs avec la nôtre : le matérialisme envahissant, le productivisme sans but, l’absence d’idéal, la montée des populismes autoritaires…
Le roman campe dans les terres du Nord un directeur de fabrique de dynamite, Siméon Bramberger, ingénieur de la cinquantaine, en prise avec la maladie inexorable de son fils Valère, la tuberculose. Le garçon, marié à Isabelle, se meurt. Son épouse, encore jeune et pleine de désirs, l’assiste, mais prend des libertés avec le contrat d’union indissoluble. Elle voit régulièrement en cachette le jeune Fabre, aide-chimiste ingénieur à l’usine, qui, de casanier, est devenu brusquement nomade à moto. Les traditions les mieux établies se perdent avec cet adultère, toutn comme l’usine a explosé neuf ans auparavant par instabilité de la nitroglycérine.
Comment mieux caractériser l’époque qui se délite, comme le corps avec la maladie, que par ce sursaut de vie rebelle qui saisit Isabelle ? Le père est scandalisé, puis comprend. Il use en effet de son intelligence et accepte le compromis : le couple ira vivre à Nice, au soleil, et sa mère accompagnera Valère pour le soigner. Isabelle aura du temps pour elle. Fabre la rejoint, évidemment, et ils se donnent du bon temps. Las de souffrir, et peut-être parce qu’il a senti la trahison, Valère achète un pistolet (en vente libre à l’époque !) et se suicide.
Sa mère, alors, se laisse mourir de douleur, somatisant en « fausse angine de poitrine » son angoisse. Elle va peu à peu, grâce à l’amitié du croyant Vhuilst, chimiste en chef de l’usine et ami de vingt ans de son mari, passer à la religion. La croyance l’aide à survivre, à espérer un ailleurs où tout serait apaisé, la résurrection. Une sorte de fuite, mais aussi une béquille. C’est ainsi que le pacifisme servait de croyance en un avenir meilleur face aux montées des fascismes…
Lorsqu’elle meurt à son tour, Siméon se retrouve seul, sans but. Il démissionne de son poste de directeur d’usine, il part en voyage, aidé par son ami veuf Vhuilst, qui a connu lui aussi le désespoir à la mort de sa femme. Il assiste à une messe à Paris, visite l’abbaye de Hautecombe, puis celle de la Grande Chartreuse. Il est tenté par la retraite du monde, la vie de fraternité dépouillée des biens matériels, cultiver son jardin et participer aux cérémonies. Il n’a pas la foi mais tend au pari de Pascal : faire comme si et tout suivra.
L’auteur a pris pour exemple de ce roman désespéré sa propre vie. Il a perdu de tuberculose en 1918 sa sœur aînée Sarah, 18 ans. Le ménage de ses parents n’y a pas résisté, sa mère devenant alcoolique et son père, athée convaincu, cherchant à se perdre en menant une vie dissolue. Siméon oppose deux visions : celle de la femme pauvre et malheureuse qui revit en prenant la communion lors de la messe, et la femme très maquillée, séductrice et prête à jouir, qui visite une cellule de la Grande Chartreuse : « Et une étrange pensée qu’il n’eût jamais conçue, qui ne l’eut jamais effleuré, peut être, ailleurs qu’au fond de cet asile purifié par d’innombrables sacrifices, lui traversa l’esprit : l’idée que des êtres tels que cette grande créature tournée toute vers la joie des sens, la conquête et le plaisir, rendait croyable et presque visible la présence et l’emprise d’une occulte puissance destructrice, désorganisatrice, diabolique » p.218 Van der Meersch sera résistant, mais la pensée de Pétain n’est pas loin qui faisait de l’hédonisme la cause des malheurs de la France.
Solitude et désarroi sont dans les années trente le lot du couple, de la famille qui se décompose, de l’impuissance devant la maladie avant les antibiotiques, de la nation qui dépérit et acceptera bientôt sa soumission au plus fort. « C’est parce que j’ai connu moi-même les incertitudes et les doutes de mon héros, Siméon Bramberger, que j’ai écrit L’Élu », dira l’auteur. À quoi bon ? se dit le pessimiste. L’imbécile guerre industrielle de 14, déclenchée pour des questions d’honneur suranné par des politiciens depuis leurs bureaux, a obsédé toute la génération d’après par la peur de la mort et du néant. Sa révolte désespérée a pris deux formes : celle de la révolution communiste ou fasciste, ou la résignation par l’abandon à la foi, seule espérance qu’offrait la tradition.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Maxence van der Meersch, L’élu, 1937, Livre de poche 1969, 254 pages, occasion €5,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Romans de Maxence van der Meersch déjà chroniqués sur ce blog

Commentaires récents