Philippe Delerm est devenu célèbre. Ses livres de peu de pages ont du succès. Il parle peu, de lieux hors du temps, de choses simples, de sensations éternelles. Je n’ai pas lu son œuvre entière mais seulement un volume, Les chemins nous inventent, paru en 1977. Je crains cependant qu’il ne répète à chaque fois le même livre avec des textes neufs.
Celui-ci a un beau titre, des narrations courtes, agrémentées de photographies léchées prises par sa femme : une promesse.
Hélas ! La déception est au tournant de chaque page. Les adjectifs se bousculent, agités comme des drapeaux, peut-être brandis comme des boucliers, en tout cas collés comme autant d’étiquettes pédagogiques sur les mots. Il ne qualifie pas les choses, il les cliche. Les lieux sont communs, dits « inspirés », l’intimité est « chaude », l’autorité « bienveillante », la promesse « effleurée », la sensation « sourde », les domaines « mystérieux » – et ce ne sont que quelques exemples. À croire que l’auteur a puisé dans le fameux dictionnaire du vieux Flaubert, revu et mis à jour, des stéréotypes d’aujourd’hui. Un répertoire de la bêtise qui se croit littéraire. Le langage est si apprêté, ornementé de mots précieux, qu’il me consterne. Tant de tics tintinnabulent : « c’est bon de… », « quel plaisir… », « le plus beau… ». Le ton est pompeux, solennel, comme si l’auteur écrivait pour de futures dictées.
Le pire vient lorsque l’on a achevé l’ouvrage, dans la vue que l’on a de l’ensemble. Ces textes qui prennent prétexte de flânerie recherchent en fait le mythique âge d’or. Fini la recherche du temps perdu, mais vivement le temps qui ne bouge plus. Delerm célèbre le dernier soleil d’automne, les promesses d’un printemps, les rouges et verts contrastés de l’été, la première gorgée de bière. On sent la flemme, le tropisme du bien-être, l’attrait de la rêvasserie, la grande aspiration au repos. Changer, bouger, vivre, quelle hantise ! Peut-être est-ce cela qui plaît aux lecteurs. Le rêve de l’auteur semble celui du temps immobile, de ne rien faire au milieu d’une nature toujours égale, dans les villages immémoriaux et les demeures ancestrales. C’est un bonheur de retraité, de fonctionnaire frileux, pantouflard, agressé par la ville et les bouleversements incessants de la modernité. Le succès fondé sur de telles bases me paraît faux. Il est celui, contingent, d’une époque particulière, celle de « l’horreur économique » de la fin des années 1990, d’une société stressée par le changement, la crainte de la mondialisation, de l’informatisation, la hantise de perdre son savoir-faire, ses repères, son identité.
La nature est pour Delerm un âge d’or de légende. Il s’en enivre, à l’opposé par exemple du Canadien Robert Lalonde qui lit le monde sur le flanc de la truite et à qui le vent et les nuages, le chien et les oiseaux, ou l’adolescent en fleur, parle, remue, hérisse.
Ce livre, « je tremble un peu de voir qu’il nous ressemble », écrit Delerm. Moi aussi. Est-ce cela la France d’aujourd’hui ? Cette nostalgie provinciale ? Cette aspiration au monde d’avant-guerre tout de lenteur paysanne ? Cette jouissance égoïste du jardin, du village et des vieux châteaux ? « On voudrait que les heures penchent vite vers la nuit et fassent naître des envies de bière, de café resserré, blotti dans la chaleur… » Le lecteur attentif notera la banalité du « on », tout comme l’infantilisme des « envies » du « resserré » et du « blotti » : une nostalgie de ventre de mère.
Même les personnages sont fossiles, réduits à leur fonction : papetier, jardinier, artisan, « enfant » sans distinction. Les personnages sont même parfois des statues de pierre, immobiles pour l’éternité : les singes du château de Champs-de-bataille, la Vénus de Bizy, les « moniales évanouies » de l’abbaye, les statuettes de chérubins du cimetière de Ferrières. Il y a bien-sûr « Sylvie », mais elle n’est plus… qu’un souvenir, figé lui aussi.
« On est toujours plus routinier qu’on ne le pense ». Malgré le « on » (qui est con, comme chacun sait), la remarque est juste et fait contraste à ces rares échappées, symptômes d’une vision meilleure. Par exemple : « Les petits joueurs de foot ne ferment pas les yeux de bien-être, comme les adultes amateurs de chaleur. Fascinés par la balle, ils ne la quittent pas du regard » p.94. Ces gamins ne sont pas fatigués mais Delerm l’est ; ils sont la vie, lui le repos. Et c’est dommage car il sait voir.
Philippe Delerm, Les chemins nous inventent, Livre de poche 1999, 170 pages, €6.60

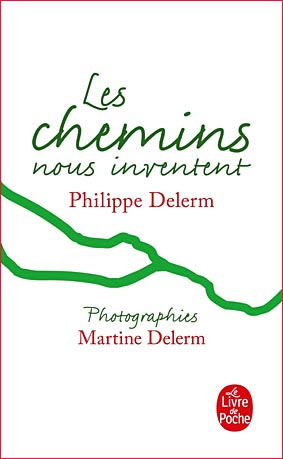
Commentaires récents