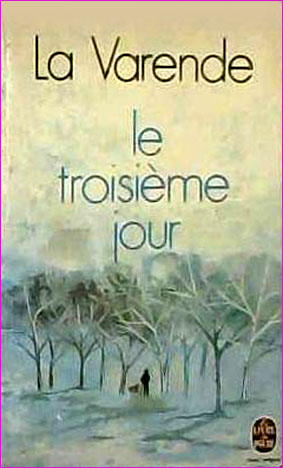
De cet écrivain mort en 1959, on a fait un écrivain « régionaliste », avec l’affectation de mépris à la mode dans les salons littéraires de Saint-Germain-des-Prés. Or il est avant tout un écrivain, un homme qui écrit ses passions et met en scène des personnages bien typés. Certes, il est catho tradi, attaché au roi et anti-moderne, mais est-ce une raison pour bouder le talent ? Le wokisme sévit parmi tous les imbéciles, pas uniquement chez les « racisés ».
Le Troisième jour, au titre énigmatique, met en scène la Normandie, patrie de l’auteur – bien qu’il ait passé son enfance en Bretagne. Il se situe à la fin du XIXe siècle, après Napoléon le Troisième (le Second n’a jamais régné) et durant les premières années de la République elle aussi Troisième. Mais cela importe peu, la campagne reste alors hors du temps. Les gens sont simples, attachés à leur terroir et à leurs forêts. Il s’agit du pays d’Ouche, dont la capitale, Conches-en-Ouche, près d’Évreux, n’est aujourd’hui qu’à une heure et demie de la gare Saint-Lazare. C’est un paysage de champs et de forêts où, à la fin du XIXe siècle était fabriqué du charbon de bois pour alimenter de petites mines de fer.
C’est là que s’épanouit un beau gamin blond nommé Georget, entre sa mère Fanny et son beau-père Aubert, avec le comte déclassé Mantes pour ami. Georget est issu de liaisons compliquées que tout le roman suffira à peine à débrouiller. Mais tout commence par un loup qui suit l’enfant un hiver, alors qu’il n’a que 11 ans. Cela ne démonte pas le petit Normand qui le chasse à coup de boules de neige, sans le prendre pour un gros chien, et le tient en respect avec son bâton. Il criera « Harlou ! » dès qu’il sera à la maison, déclenchant une chasse qui finira par la mort du loup. Comme il l’a traqué avec le comte et le piqueux du marquis voisin, il en aura les pattes. Pour remercier le marquis de La Bare, puisque l’animal a été tué sur ses terres, le garçon ira lui porter le trophée de l’une des pattes monté sur bois par Aubert et orné d’une belle plaque de cuivre indiquant la date.
Le vieux marquis, qui a perdu son fils aîné Manfred à la guerre contre les Prussiens, et son fils cadet Gaston, entré dans les ordres et mort des fièvres en mission chez les Nègres du Sénégal, est touché et ravi par la beauté, la santé et la vivacité de Georget. L’auteur en brosse un portrait lyrique : « Georget, ce petit homme si franc, si luron, lui avait fait passer une heure excellente. Il le revoyait dans sa solidité ; il aurait voulu, de ses deux mains longues, enserrer les mollets ronds, les genoux larges, les jambes de poulain, et caresser cette peau dorée. Le bezot n’était pas très grand pour son âge, mais tellement bien établi, si fortement campé, avec des aplombs si justes ! Bâti en force blonde… » p.130. Il va en été « sa petite chemise à demi ouverte », découvrant sa poitrine, comme le note sa bonne amie Léone, presque 14 ans qui le console de ses malheurs (p.330).
Georget est comme un poisson dans l’eau dans son pays, ami des charbonniers de la forêt, participant aux contrebandes avec les rustiques poneys hurtus acclimatés depuis l’Irlande. Il n’est pas politique mais comme les gens du cru, qui voient la république de loin. Des « anarchistes paysans, épris seulement de force, de liberté paysanne et appartenant à toutes les oppositions quand elles agissaient. Il ne se ralliaient jamais qu’à la révolte » p.198. Ils respectent les anciens nobles, mais comme faisant partie de leur terroir ; il n’en sont pas sujets mais restent « sire de sei », maîtres d’eux-mêmes.
De cette visite découlera tout un enchaînement de circonstances qui feront reconnaître l’enfant par le marquis, par le piqueux, par la marquise. Il s’avérera que le gamin a de qui tenir : il a du sang La Bare en lui, et même pas mal, mais je ne veux pas déflorer l’aventure de la découverte. Le paysage est brossé comme il se doit, d’une langue sensible et sensuelle, les personnages ont du caractère et sont campés pour le montrer, Georget en vigoureux lutin, Fanny en mère solide qui sait ce qu’elle veut, Aubert en beau-père vieilli mais bon et généreux, Mantes en aristocrate déchu et tourmenté, La Bare en pater familias sans plus de famille et soucieux de transmettre ses biens et ses traditions à sa lignée, le piqueux en valet respectueux qui a connu la famille du marquis depuis quarante ans et reconnaît en Georget l’un des leurs.
Un beau roman qui gagne à être relu, réaliste et romantique comme un Normand sait l’être.
Jean de La Varende, Le troisième jour, 1947, Livre de poche 1972, 346 pages, broché occasion €38,80
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents