La quatrième partie du livre bilan sur quarante années de changements en France de Fourquet et Cassely, déjà chroniqué sur ce blog, montre les nouveaux visages des classes sociales, engendré par le nouveau modèle économique désindustrialisé, orienté vers les loisirs et les services. La réorganisation des territoires pour sa résidence, la polarisation des styles de vie, ont un impact sur la structure et sur la nature des emplois.
Surgit une nouvelle constellation populaire des domestiques et soutiers de la consommation. L’ouvrier logistique a remplacé l’ouvrier d’usine. Les routiers, les magasiniers, les manutentionnaires d’entrepôt, constituent ce nouvel ouvrier à la chaîne, Amazon remplaçant Billancourt. Les emplois populaires des sans diplôme baissent en gamme. L’absence de perspectives professionnelles, le turnover, les intérimaires, l’absence de syndicats, conduisent à une conscience de classe nulle. C’est une constellation de services à la personne, de chauffeurs VTC et livreurs, de temps partiel, qui sont farouchement individualistes et récusent l’assistanat. Ils ont conscience d’être des serviteurs mais invisibles et atomisés. L’aide-soignante et l’aide à domicile sont au bas de l’échelle du soin tandis que la hausse du vieillissement et la baisse d’investissement des familles encouragent au contraire les métiers de services à la personne. L’externalisation du nettoyage et du gardiennage par les entreprises fait quitter aux employés l’organisation et les avantages sociaux en faveur de la solitude et de la quasi misère (un SMIC dans une grosse boite avec cantine et comité d’entreprise n’est pas l’équivalent d’un SMIC en autoentreprise).
Les gilets jaunes ont manifesté cette révolte des classes subalternes qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois avec les revenus qu’on leur offre. Aucune conscience de classe, ce fut une jacquerie sans lendemain, mais qui s’est révélée grâce aux réseaux sociaux. Elle montre le bouillonnement de colère qui monte parmi les déboussolés de la nouvelle organisation sociale.
Une catégorie de nouveaux pauvres augmente, celle des chômeurs de longue durée, des cassos (« cas sociaux »), voué à l’ASS, au RMI, à la CMU, aux Restos du cœur et autres soupes populaires. Ceux qui ont un emploi faiblement rémunéré ont du ressentiment contre cette population d’assistés par peur de tomber dans la même trappe. Ils sont en outre un peu jaloux des aides qu’on leur fournit tandis qu’eux-mêmes n’y ont pas droit, bien qu’ils payent de plus en plus de taxes sur leur consommation (carburant, énergie, produits électroniques, etc.). C’est la fuite des quartiers de logements sociaux qui deviennent progressivement des ghettos.
Le cœur de la classe moyenne était le bac+2. Le diplôme est indispensable pour se distinguer de la catégorie populaire, du BTS à bac+5. En 1985,29 % d’une classe d’âge réussissaient le bac, désormais dévalorisé en 2019 lorsque plus de 80 % le réussissent sans grand effort, en raison du laxisme des notations et de la volonté politique d’afficher un ascenseur social qui existe de moins en moins. Le bac+2 permet l’accès au concours de catégorie B dans l’Administration. Le bac professionnel permet le BTS technologique, accès à l’IUT et au bachelor (bac+3). Mais c’est la course aux diplômes, les infirmières étant désormais recrutées à bac plus quatre, comme les enseignants non agrégés, et les concours d’administration de catégorie B sont souvent présentés par des diplômés supérieurs au niveau requis, qui emportent les places. Petits artisans, commerçants indépendants, cadres en reconversion (de 12 à 20 %), franchisés (plus de 2000 réseaux) s’installent dans les zones commerciales de « la France moche » de Télérama – magazine culturel pour bobos.
Profs, infirmières et fonctionnaires ou animateurs des services culturels sont les inspirateurs du changement de cette constellation moyenne. Ils ont été les innovateurs sociaux du style de vie post–68 entre 1970 et 1990. Ils prônaient l’écologie, le libéralisme culturel et des mœurs, les modes de vie alternatifs. Ils laissent désormais la place aux nouveaux métiers : les psys-coachs des thérapies alternatives, les astrologues, les services pour animaux de compagnie, le tatouage, les « facilitateurs humanistes », aux néo–artisans, aux métiers de la culture, aux professionnels du bien-être et aux start-upeurs.

Une marche vers la richesse sur l’échelle sociale. Car la numérisation et l’Internet ont donné naissance à un groupe socioprofessionnel hautement diplômé et doté d’une conscience de soi. Le discours d’Emmanuel Macron en 2017 sur la Start-up Nation (en français de l’Académie) reflète leur image de jeunesse, d’innovation, de cosmopolitisme, d’aisance sociale. Leur écosystème fleurit dans les métropoles et surtout en Île-de-France. 80 000 jeunes sortent par an des écoles d’ingénieurs et de commerce. Ils développent une culture neuve qui devient centrale dans la société, malgré l’hermétisme de leurs nouveaux métiers et la tentation de l’entre soi.
Les vraies grandes fortunes sont en petit nombre en France, dans le luxe, la cosmétique, la finance et le vin. De 1998 à 2000, l’industrie a baissé sauf l’agroalimentaire et le Medef n’a plus un dirigeant issu de l’industrie et des mines mais des services. Désormais l’industrie n’arbitre plus la politique, ce qui a expliqué depuis une vingtaine d’années le maintien des impôts de production élevés dans notre pays, qui a clairement pénalisé la compétitivité par rapport aux pays voisins.
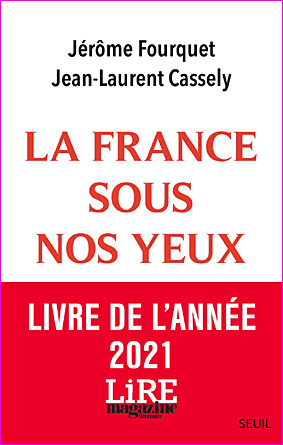
La France tout entière s’appauvrit donc, devant importer de plus en plus pour assouvir des besoins de consommation de plus en plus grands alors que les moyens de chacun se réduisent. C’est la lutte des places pour la lutte des statuts, c’est le sablier qui grandit : amincissement des hanches et obésité des pieds, nettement moins de la tête. La France sous nos yeux perd de sa beauté.
Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux – économie, paysages, nouveaux modes de vie, cartes de Mathieu Garnier et Sylvain Manternach, Seuil 2021, 494 pages, €23.00 e-book Kindle €16.



Commentaires récents