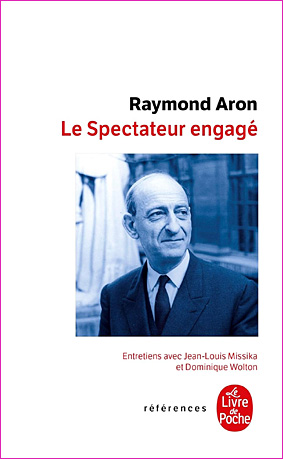
Décédé en octobre 1983 – il y quarante ans – Raymond Aron marque toujours intellectuellement. Né en 1905, il a vécu pleinement le XXe siècle et ses multiples guerres et batailles idéologiques. Interrogé sans concession en 1980 par deux jeunes hommes de gauche marxiste (la grande mode à cette époque-là), un économiste et un sociologue tous deux au début de leur trentaine, le grand intellectuel qui fut à la fois philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste, fait le bilan de sa vie publique.
Juif laïc lorrain, il a toujours été un « spectateur engagé ».
Spectateur car analyste, voué à la raison et à l’étude, mettant à distance la passion, même dans les périodes les plus « urgentes » comme la défaite de 40, le déchirement de l’Algérie ou l’antisémitisme supposé du général de Gaulle.
Engagé car penseur incisif qui ne dépendait de personne, étant universitaire. Il a ferraillé avec Sartre, son condisciple à Normale Sup, par rigueur intellectuelle et autodérision, tandis que le protée de la gauche s’est laissé aller à des errements passionnels parfois iniques.
Raymond Aron a vécu la France des années 30, la montée du nazisme en Allemagne où il a étudié, la guerre et la résistance, la guerre froide, la décolonisation douloureuse, la coexistence pacifique à couteaux tirés, la construction de l’Europe. Les entretiens s’arrêtent, pour Antenne 2, à l’arrivée de la gauche au pouvoir ; Raymond Aron complète avec ce qu’il en pense en postface, mais la situation est trop neuve, il n’en dit rien de probant. Le philosophe, qui a beaucoup étudié le marxisme et en a critiqué la visée messianique, est en complète contradiction avec la religion d’époque, celle des intellos sous la houlette de Sartre et d’Althusser. Il est un hérétique, évidemment catalogué « de droite » alors qu’il est un libéral politique, un partisan des libertés de penser, de s’exprimer, d’aller et venir. Tout ce qu’offrent plus ou moins parfaitement, mais plus que partout ailleurs, les démocraties libérales faces aux régimes totalitaires fascistes ou communistes.
Raymond Aron a eu raison avant les autres – et contre Sartre – sur le stalinisme : Soljenitsyne l’a montré dès l’Archipel du Goulag. Il avait eu raison avant les autres sur le nazisme, qu’il avait vu croître à Berlin même, alors qu’il poursuivait ses études de philosophie et de sociologie en allemand. Il a eu raison avant l’opinion sur l’indépendance inévitable de l’Algérie – 10 millions d’indigènes pour 1 million de colons – et l’impossibilité d’intégrer le territoire à la France, au risque de modifier en profondeur la démographie, la culture et la société (les Algériens d’Algérie sont aujourd’hui 44 millions, sans compter ceux qui vivent en France et ceux qui sont déjà devenus Français).
Sartre était un moraliste, pour lui « tout anticommuniste est un chien » car le moraliste défend sa vérité, qu’il croit absolue, Bien suprême, et ne tolère pas qu’on la conteste. Aron est au contraire un sceptique, un lucide, qui préfère le réel au vrai, l’observation minutieuse de ce qui est à la reconstruction d’une belle histoire qui peut devenir une illusion, voire un mensonge. C’est toute la distance entre Raymond Aron et la gauche marxiste : pour le philosophe, tous les systèmes sociaux sont imparfaits et la politique n’est que le choix entre le préférable et le détestable. Ni Bien ni Mal, mais le bon ou le mauvais.
Tout le contraire d’une vision morale qui « croit » détenir le Bien en soi et veut le faire advenir par tous les moyens, même les plus coercitifs. La Terreur de 1793 a été la matrice de tous les régimes totalitaires, une inquisition des consciences, un tribunal expéditif sans contradictoire, une élimination des opposants sans concession. La morale existe, mais la politique est d’un autre ordre car la politique n’est pas d’appliquer le Bien (car personne ne sait ce qu’il est pour la société) mais d’arbitrer ce qui est le mieux en fonction de la réalité des circonstances. « Perdre » l’Algérie était-il « Bien » ? Non pour les colons et pour l’armée, victorieuse et qui tenait le terrain ; mais Oui pour la France à long terme et pour les rapatriés qui n’auraient pas pu survivre dans une société où la démographie les aurait vite dilués – comme en Afrique du sud.
Raymond Aron a détesté le nazisme, qui l’a fait « Juif » alors qu’il était laïc et intégré, pleinement Français. Mais il n’a pas pour cela détesté la culture allemande « d’où est sortie la bête immonde » selon la vulgate marxiste. Déjà en 14-18 : « Vous savez, nous, dans notre génération, nous avons détesté réellement détesté et méprisé les intellectuels qui avaient condamné la culture allemande à cause de la guerre de 1914-18 contre l’Allemagne. Un de nos griefs les plus violents contre une partie de la génération précédente a été le bourrage de crânes. Selon ce bourrage de crânes, on ne devait plus écouter Wagner parce qu’il avait été allemand, ou, comme on pourrait le dire aujourd’hui, parce qu’il avait été antisémite. Alors la séparation radicale entre la culture allemande d’un côté, et la politique allemande de l’autre, était pour moi évidente. En dépit de la guerre entre 39 et 45, en dépit du national-socialisme, je ne me suis jamais laissé aller à condamner un peuple et une culture à cause des conflits politiques » p.31. Raymond Aron n’aurait pas plus condamné la culture russe à cause de Poutine – ni même la culture américaine à cause de Trump. Ni Céline à cause de ses pamphlets, ni Barrès à cause de son antisémitisme de circonstances.
Il règle son compte à Maurras, tellement à la mode ces temps-ci chez les Zemmouriens en manque d’idées. « Maurras à représenté une théorie positive de la monarchie avec une idéologie de l’ordre français. Je le lisais peu ; il m’ennuyait. Je trouvais qu’il était hexagonal à un degré exagéré. Même à l’époque où je ne connaissais pas encore le grand monde, je trouvais sa philosophie politique strictement française, provençale… Bon ! Je l’ai lu un peu, mais avec une indifférence totale » p.39. Hexagonal, provincial, ennuyeux. C’est cela que propose l’indigence de la droite extrême aujourd’hui. La presse d’extrême-droite dans les années 30, selon Aron, « vivait de la haine, elle nourrissait la haine, elle créait en France un climat de guerre civile permanente » p.76. Quand on n’a pas d’idées, on a des passions : cela revient… « Pour moi, j’ai choisi depuis 35 ans la société dans laquelle il y a dialogue. Ce dialogue doit être autant que possible raisonnable, mais il accepte les passions déchaînées, il accepte l’irrationalité : les sociétés de dialogue sont un pari sur l’humanité. L‘autre régime est fondé sur le refus de la confiance aux gouvernés, sur la prétention d’une minorité d’oligarques, comme on dit, de détenir la vérité définitive pour eux-mêmes et pour l’avenir. Ça, je le déteste » p.309.
Selon Raymond Aron, « Pour penser la politique, il faut être le plus rationnel possible, mais pour en faire il faut inévitablement utiliser les passions des autres hommes. L’activité politique est donc impure et c’est pourquoi je préfère la penser » p.44. A chacun de faire ses choix, dont le premier est celui de la société dans laquelle il veut vivre. « Ou bien on est révolutionnaire, ou bien on ne l’est pas. Si on est révolutionnaire, si on refuse la société dans laquelle on vit, on choisit la violence et l’aventure. À partir de ce choix fondamental, il y a des décisions, et des décisions ponctuelles, par lesquelles l’individu se définit lui-même » p.58. Par exemple le Front populaire, ce mythe de la gauche : « d‘un côté, à coup sûr, cela a été un grand mouvement de réforme sociale et de l’autre cela a été une politique économique absurde dont les conséquences ont été lamentables » p.72. Au bout de six à douze mois, tout était perdu. De même en novembre 1942 lorsque Pétain a « choisi » de ne pas rallier l’Afrique du nord avec la Flotte, il a consciemment (ou sénilement ?) accepté la défaite et la collaboration. Dès lors, « il donnait au contraire une espèce d’investiture aux mouvements les plus détestables » p.92. C’est cela « l’engagement » aronien ; contrairement au sartrien, il ne se contente pas d’être « moral » en soi, mais il agit concrètement en fonction des circonstances. On ne dit pas aux autres ce qu’il faut faire, on le fait soi-même.
Avis pour l’avenir :« La morale du citoyen, c’est de mettre au-dessus de tout la survie, la sécurité de la collectivité. Mais si la morale des Occidentaux est maintenant la morale du plaisir, du bonheur des individus et non pas la vertu des citoyens, alors la survie est en question. S‘il ne reste plus rien du devoir du citoyen, si les Européens n’ont plus le sentiment qu’il faut être capable de se battre pour conserver ces chances de plaisir et de bonheur, alors en effet nous sommes à la fois brillants et décadents » p.304. La lâcheté de la « génération Bataclan » pour ignorer le militantisme islamique ou la menace de Poutine est navrant ; ils préfèrent boire une bière en terrasse que s’engager pour combattre l’intolérance et la menace.
« Avoir des opinions politiques, ce n’est pas à voir une fois pour toute une idéologie, c’est prendre des décisions justes dans des circonstances qui changent » p.185. Sinon, on est simplement croyant d’une « religion », même laïque. « J’ai plutôt parlé de ‘religion séculière’. L’expression s’appliquait partiellement au moins à l’hitlérisme, elle s’appliquait également à l’Union soviétique. Elle concerne une idéologie qui est présentée comme une espèce de vérité religieuse. (…) Il s’agit toujours d’une vérité suprême dont les membres du parti sont les grands prêtres » p.241. L’islamisme aujourd’hui est de ce type, l’écologisme également, avec sa variante Woke, ou ce national socialisme en vogue chez les bobos lepéno-zemmouriens.
Ce pourquoi Raymond Aron se définit comme libéral. « Si je me définis par le refus du parti unique, j’arrive de manière naturelle à la notion de pluralisme, et de la notion de pluralisme à une certaine représentation du libéralisme. Il n’est pas fondé chez moi, à la différence du libéralisme du dix-neuvième siècle, sur des principes abstraits. C’est par l’analyse des sociétés modernes que j’essaie de justifier le libéralisme politique et intellectuel. Montesquieu a déjà justifié le libéralisme par l’analyse sociologique, Alexis de Tocqueville lui aussi et Max Weber aussi. Dans la mesure où je me réclame des trois, à partir de l’étude des sociétés économiques modernes, je vois quels sont les dangers qui résultent de la concentration de tous les pouvoirs dans un parti unique. Je cherche alors les conditions économiques et sociales qui donnent une chance à la survie du pluralisme, c’est-à-dire du libéralisme à la fois politique et intellectuel » p.248.
C’est chez Max Weber qu’Aron a trouvé ce qu’il cherchait intellectuellement : « Un homme qui avait à la fois l’expérience de l’histoire, la compréhension de la politique, la volonté de la vérité, et au point d’arrivée, la décision et l’action. Or, la volonté de voir, de saisir la vérité, la réalité d’un côté et de l’autre côté agir : ce sont, me semble-t-il, les deux impératifs auxquels j’ai essayé d’obéir toute ma vie. Cette dualité des impératifs, je l’ai trouvée chez Max Weber » p.40.
Raymond Aron, Le Spectateur engagé entretiens avec J.L. Missika et D. Wolton, 1981, Livre de poche 2005, 480 pages, €9,20
Raymond Aron sur ce blog


Commentaires récents