La nuit sous la tente est un peu en pente mais plus fraîche que les précédentes, ce qui me permet de mieux dormir. La falaise d’un rose éteint, maculée de traînées blanches et vertes du Roraïma se dresse, dominante, sur la moitié de notre horizon. La forêt grimpe à l’assaut de la roche mais le chemin vers le plateau passe par une faille en diagonale sur la gauche. Nous l’avons aperçue de loin, hier, en dessous d’une forme rocheuse au sommet de la falaise qui a la forme d’une automobile de profil. Ce repère est le point le plus élevé du tepuy, les références hésitent, certaines déclarent 2810 m, d’autres 2772 m. On l’appelle ici Maverick (qui signifie « franc-tireur » ou « non-conformiste », en tout cas « veau non marqué » en anglais), un mot proche du mot indien qui le désigne. Le plateau se dresse 1000 m au-dessus de la gran savana et du camp de base dans lequel nous nous trouvons ce matin.
Sir Arthur Conan Doyle a fait de ce massif le théâtre de son roman de remontée dans le temps, Le monde perdu. Mais les « dinosaures » qu’il imagine préservés là-haut ne sont que de petits lézards d’un pouce de long, appelés oreophrynelia quelchii en latin. On dit qu’il s’est inspiré du récit que firent de leur première exploration les découvreurs anglais Everard Thum et Harry Perkins en 1884, mais un Allemand, le botaniste Richard Schomburg, l’aurait déjà grimpé en 1842. Formé il y a un milliard et huit cent millions d’années, ce massif de roches éruptives du Précambrien, de grès tabulaire et quartz, a été sculpté profondément par le soleil, la pluie et le vent. D’après les spécialistes, ce sont les algues et les champignons qui sont les principaux responsables de l’érosion. Un article d’Uwe George, dans The National Geographic de mai 1989, apprend que « Roraïma » signifierait « chant des cascades » en langage Pémon.
Nous entamons la montée par un sentier étroit qui passe entre les arbres, sous la forêt. La première partie est rude, elle monte très fort. Dans la moiteur de savane, nous coulons vite de transpiration. Mais la première heure est la plus dure parce que la plus pentue, voici qu’à mesure que l’on monte, il fait plus frais. L’ombre de la falaise et l’humidité retenue allègent la température. La roche s’élève verticalement au-dessus de nos têtes et les fait tourner lorsqu’on la regarde d’en bas. Nous nous demandons bien où est le passage, d’ailleurs le sentier redescend. Ce n’est qu’une fausse piste, car il remonte bientôt. Nous croisons des touristes allemands, américains, vénézuéliens, qui redescendent.
Un nuage monte. Il nous cache le soleil et nous engloutit dans une sorte de brume de montagne, presque une pluie. Nous passons sous une sorte de cascade et l’eau qui tombe fait comme s’il pleuvait, mouillant le haut du sac et le tee-shirt. Il fait froid, désormais, d’autant que nous sommes mouillés. Nous grimpons les hautes marches composées des blocs erratiques du chemin, en nous arrêtant de temps à autre « pour attendre les autres » et aussi pour nous reposer. Un petit moineau local, gorge rousse, tête et dos beige rayé de noir comme un chat de gouttière, nous tient compagnie. Il attend sans doute les inévitables miettes que tout randonneur se doit de laisser tomber à chaque pause. L’oiseau n’est pas sauvage et reste à sautiller autour de nous. Le sommet du plateau n’est pas loin. Nous entendons déjà les jeunes Américains, partis avant nous ce matin, qui rient et gueulent en jouant aux cartes à l’arrivée comme de vrais collégiens.
José, Laurent, Arnaud et moi sommes les premiers au sommet. Nous nous installons sur un rocher au débouché du sentier qui monte pour sécher et pour attendre le reste du groupe. Le plateau est creusé, tourmenté, les roches découpées en plaques érodées de lichens, de pluie et de vent. Certaines, taillées par les siècles, présentent des profils de bêtes ou d’humains, c’est très étrange.
L’auteur du National Geographic dit qu’il avait l’impression de « marcher dans une ville bombardée ». C’est assez vrai, la couleur gris sombre de la roche, l’atmosphère fumeuse, le silence de mort, rappellent que ce lieu reste préservé de la vie de la plaine depuis des millions d’années. Quelques dix mille espèces de plantes seraient originales et l’on n’en a pas encore fait le tour.
Des droseras, des bromelias, des heliampheras insectivores, des orchidées… Nous prenons un en-cas quand les autres arrivent, pas si longtemps après nous en fait. Nous goûtons même le bas charnu des feuilles de plantes grasses qui poussent ici. Elles sont fades, vaguement sucrées comme l’herbe au printemps, mais gorgées d’eau. Ce sont des stegolepsis qui se croquent comme les feuilles d’un artichaut. Les Indiens Pémon disent qu’elles sont très nutritives.
Nous poursuivons la route durant une heure sur le plateau, jusqu’à un abri sous roche assez vaste pour contenir les tentes, les porteurs et la cuisine. La végétation est presque alpine malgré orchidées et plantes carnivores qui tentent de piéger les rares insectes qui s’aventurent à si haute altitude. Le climat est terre-neuvas et l’atmosphère brumeuse, quasi-pluvieuse, me rappelle les landes de Norvège. Les porteurs arrivent un à un et, après cette rude montée, ôtent leurs tee-shirts et exhibent avec un plaisir évident leur musculature à la fraîcheur humide du lieu. Adelino et Gabrielo ne s’en privent pas, arrachant cette exclamation au vieux Christian : « tu as vu ces muscles, non d’un chien ! » Une soupe consistante aux lentilles, pâtes et viande nous reconstitue.















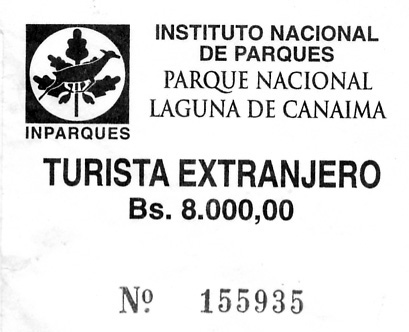
Commentaires récents