Le lendemain au matin, nous prenons à nouveau le bus de la même ligne pour Giens. Il nous débarque au pied du château très en ruines qui permet une vue étendue sur Toulon, Carqueiranne et la baie. Le poète Saint-John Perse, que j’aime bien, y a séjourné et repose au cimetière. Le château a été détruit par ces foutus Anglais pendant le siège de Toulon en 1793. Le dernier Pontevès-Gien meurt en 1848 sans descendance ; il a vendu son marquisat pour tenter de payer ses dettes. La famille avait pour sobriquet « prudence »… que ne l’a-t-il suivi !


L’atmosphère n’est pas encore dure, une légère brume subsiste sur les lointains, qui adoucit le bleu. Nous suivons ensuite le chemin côtier qui passe sur les rochers au-dessus de criques à l’eau azuréenne et aux contours découpés. Flotte dans l’air des senteurs de pin maritime.

Nous pique-niquons sur la plage. Un rocher torturé en forme de grand chef indien trône face à la baie. L’eau est très bleue, méditerranéenne. Un panneau explicatif du sanctuaire Pelagos indique que nous pourrions voir le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin (comme à Versailles), le ziphin (race que je ne connaissais pas), le dauphin de Risso, le cachalot, le globicéphale noir et le rorqual commun.


Un jeune couple est venu manger un sandwich après le travail et le garçon répond au téléphone à l’un de leurs amis, tout fier lui dire où ils sont. Ils repartent travailler dès le pain avalé. Un autre couple arrive à pied par le sentier et s’installe pour pique-niquer aussi. Lui se met torse nu, il est bien découplé et veut bronzer, peut-être est-il militaire. Elle, est sensuelle et lui caresse la poitrine, l’embrasse ; il l’étreint. L’eau est transparente comme les criques bretonnes ou corses. Une frégate et son hélicoptère en manœuvre rallient Toulon, port de guerre. Après le pique-nique, nous ne verrons pas moins de six hélicoptères en vol. Nous déjeunons de salade verte aux tomates, noix de cajou et raisins ainsi que d’un morceau de tomme de chèvre.


L’après-midi, ce ne sont que montées et descentes, la dernière particulièrement rude sur un sentier étroit très caillouteux avec des marches de plus de 20 cm de haut. Nous suivons la piste jusqu’à une place où serait l’une des maisons de Gérard Jugnot, « celle toute en rouge » selon un couple rencontré dans la montée. La redescente sur le village n’est pas la fin. Il faut encore longer le petit port, passer derrière la piscine, monter et descendre plusieurs escaliers avant une longue montée puis un ultime escalier « de 80 marches » me dit la petite M. de 80 ans aux mollets musclés – surtout quand elle vous dépasse lors d’une de ses accélérations affairées dont elle a le secret.

Après l’escalier interminable pour revenir à l’arrêt du bus de la ligne 67, nous faisons une razzia au supermarché Spar afin d’acheter de l’eau fraîche que nous descendons illico. Le bus est un Heuliez hybride tout neuf. Cinq ados montent, dont trois arabes. Le leader blond sud est le plus fringant, 16 ans, maillot moulant une taille svelte et grosse chaîne d’or au cou.
Nous avons marché dans les 14 km ce jour mais ce n’est pas le nombre de kilomètres qui comptent, plutôt la dénivelée. Les bagages sont à faire pour demain huit heures car nous quittons l’hôtel.
Au dîner, terrine provençale au figatelli (un peu écœurante), de nouveau des encornets mais à la puttanesca (la putain en italien – sauce piquante comme la fille avec ail et piment, amis sentant l’anchois et les câpres du sexe tarifé). Une faisselle en dessert.



































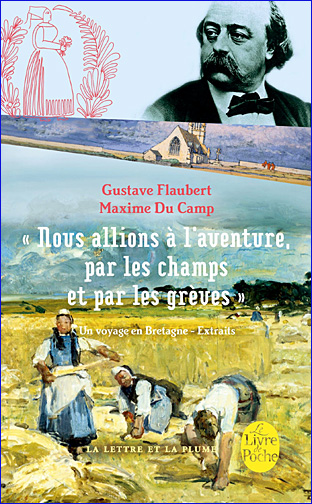




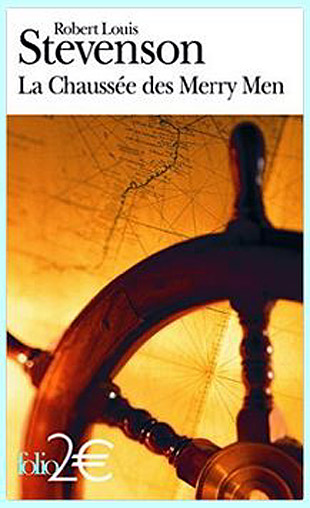


































































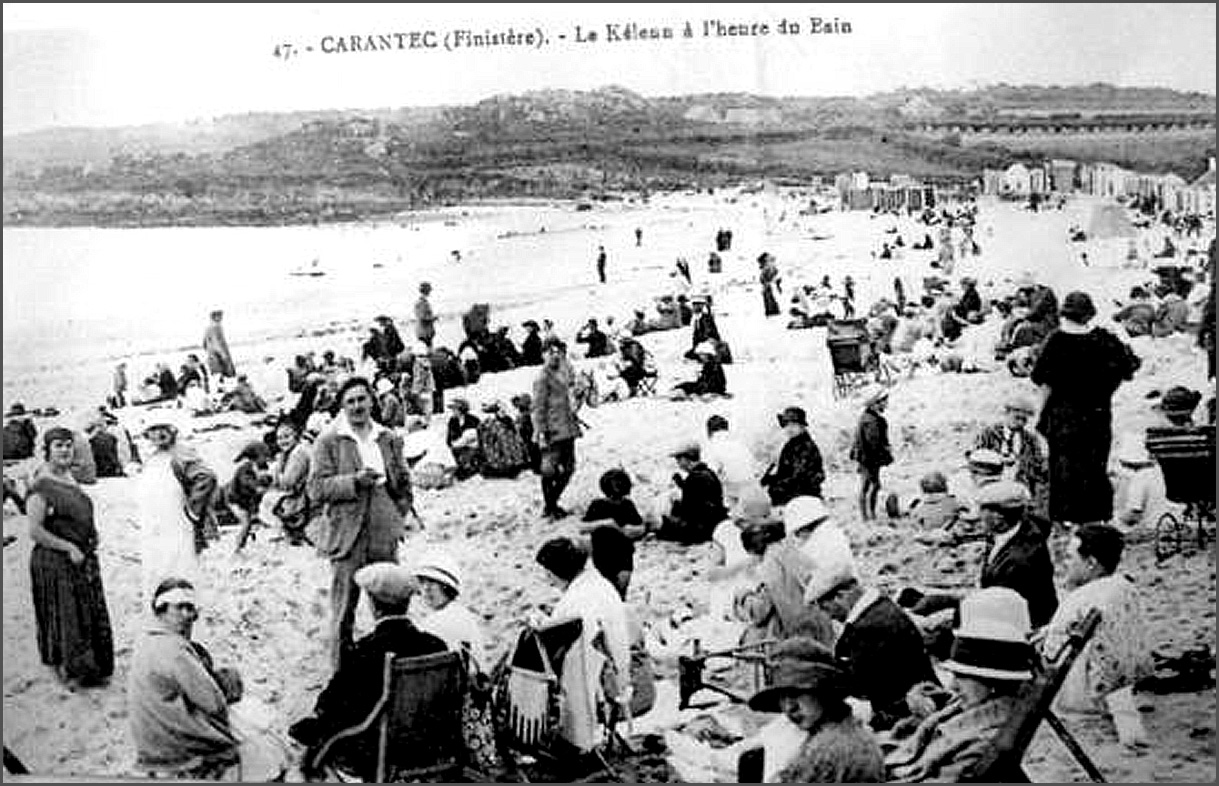

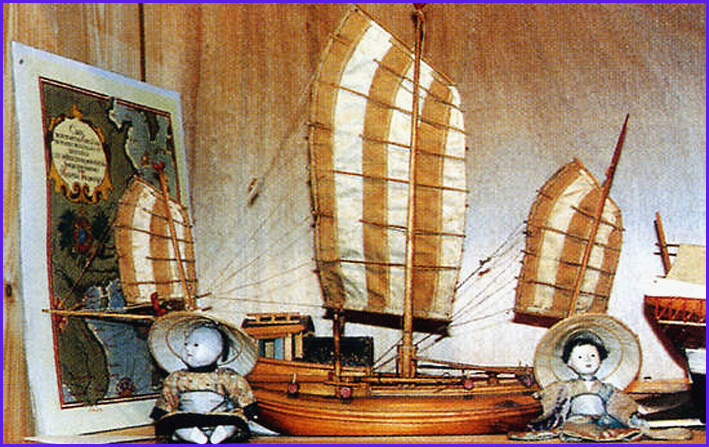
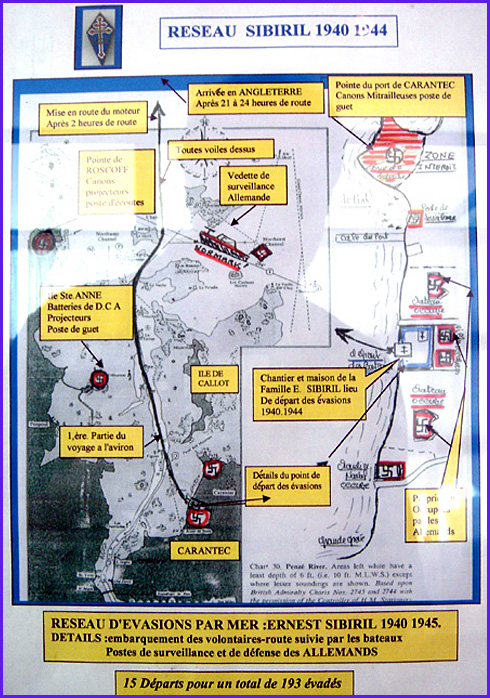
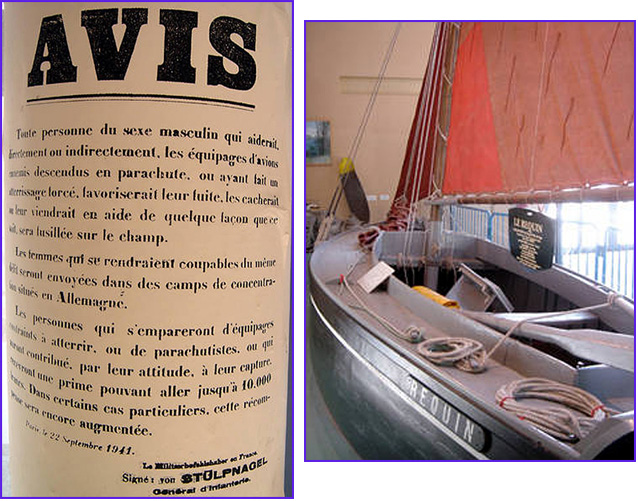
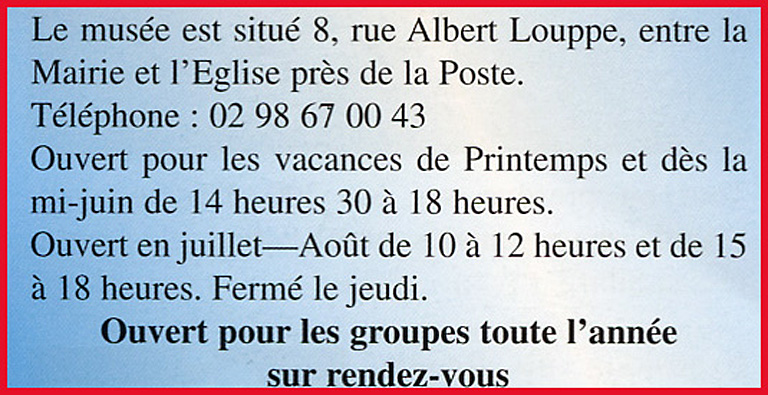



Commentaires récents