Le 14-Juillet, comme chaque année rituellement, les Français ont fêté « la liberté ». Ils ont pris la Bastille, forteresse où l’on enfermait tous ceux qui avaient déplu au bon plaisir du Prince. La nuit du 4 août ont été abolis les privilèges… L’Ancien Régime est mort, les citoyens adultes se veulent désormais responsables, liés par un Contrat social où chacun débat dans les cafés, les cercles et la presse, élit ses représentants et son Exécutif. Encore faut-il être apte à la liberté !
Dans une lettre à sa maîtresse du moment Louise Colet (15 mai 1852), Flaubert s’élève contre ce mythe. « Cette manie du rabaissement dont je parle est profondément française, pays de l’égalité et de l’anti-liberté. Car on déteste la liberté dans notre chère patrie. L’idéal de l’État, selon les socialistes, n’est-il pas une espèce de vaste monstre absorbant en lui toute action individuelle, toute personnalité, toute pensée, et qui dirigera tout, fera tout ? Une tyrannie sacerdotale est au fond de ces cœurs étroits : « Il faut tout régler, tout refaire, tout reconstituer sur d’autres bases », etc. (…) Qu’est-ce donc que l’égalité si ce n’est pas la négation de toute liberté, de toute supériorité et de la Nature elle-même ? L’égalité, c’est l’esclavage. Voilà pourquoi j’aime l’art. C’est là que, au moins, tout est liberté dans ce monde des fictions. » p.90
Flaubert en précurseur d’Orwell, qui l’eût cru ? Il faut dire qu’il avait à la mémoire l’exemple de la dictature jacobine de Robespierre où la raison a dérapé dans la toute-puissance. Lorsque l’on est unique représentant du peuple souverain, détenteur de la volonté générale, qui ou quoi pourrait vous empêcher de faire table rase des « vieilleries » et de reconstruire la société avec un « homme nouveau » ? Les Russes, les Chinois, les Cambodgiens, sont allés plus loin et plus longtemps dans le siècle qui suivit : triste exemple qu’avait donné la France « des libertés » !
Cette Raison impérieuse est peu raisonnable au fond, peu adulte, peu responsable. Elle est la nostalgie de l’unité sociale qui disparut à la Révolution, celle que fédérait puissamment la religion en établissant les trois Ordres – immuables. Après elle, l’idéologie doit remplacer la foi et l’État (le parti) doit avoir le militantisme de l’Église pour mobiliser les citoyens. La raison est aliénée à ce mythe d’une communauté « organique ». Ce n’est pas cela, l’usage adulte de la raison.
Flaubert lui oppose donc le monde de l’art où l’« égalité » règne puisque chacun peut se vouloir artiste, sculpter la pierre, peindre la toile, composer de la musique ou écrire des livres. La création est libre, mais la « liberté » d’œuvrer n’aboutit pas à l’égalité des œuvres. « Une chose qui prouve, selon moi, que l’art est complètement oublié, c’est la quantité d’artistes qui pullulent » p.91. On peut dire la même chose de nos jours…
Nul dictateur ne peut imposer son goût ou un « art officiel » (sauf jadis en URSS et aujourd’hui toujours dans la France des FIAC pour l’art contemporain). Les Français détestent la liberté parce qu’il faut montrer leur talent ; il leur faut travailler et se mesurer. Ils ont cette peur bourgeoise du qu’en dira-t-on, d’être montrés du doigt, d’être évalués publiquement. D’où l’incantation à l’égalité, censée réduire tout le monde au même dénominateur commun. On appelle ça de nos jours les « fiertés ». Tout le monde il est beau, tout le monde il est légitime, tout le monde il a « droit »…
Les Français n’admirent pas, ils jalousent. Le succès des bons les hérisse et ceux qui réussissent les font baver d’envie. D’où le groupisme en castes fermées où l’on s’isole des autres pour jouir entre soi de la fortune ou du statut : pas de jaloux si l’état est caché. Avec ses semblables, le corporatisme et le renvoi d’ascenseur sont de règle.
On le mesure de nos jours par les signatures au bas des « pétitions ». Ce n’est pas la qualité des œuvres qui fait l’« artiste » contemporain, mais la reconnaissance de la petite coterie à laquelle il appartient. Aux États-Unis, c’est « le marché » – déjà plus large. Flaubert, lui, se mesure aux Classiques et ne veut être reconnu que par la postérité. « Je me suis repassé un tas de douceurs avec ma plume. Je me suis donné des femmes, de l’argent, des voyages » p.91.
Encore faut-il le pouvoir. Peut-être est-ce pour cela que tant d’« artistes » se font histrions médiatiques ? Ils ont au moins l’illusion de compter, dans le zapping éphémère.
Gustave Flaubert, Correspondance 1851-1858, tome 2, édition Jean Bruneau, La Pléiade, 1980, 1542 pages, €61.00

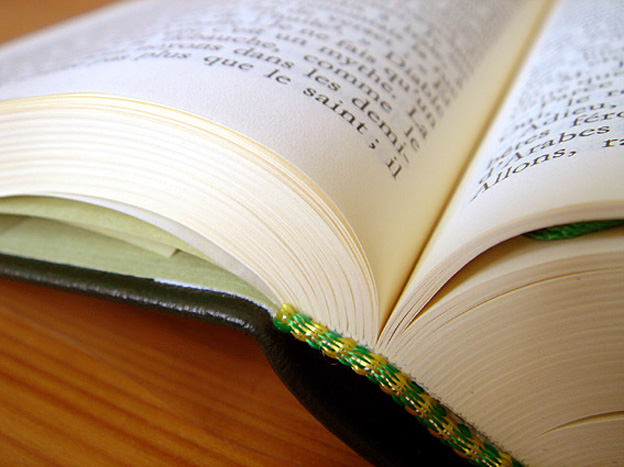
Commentaires récents