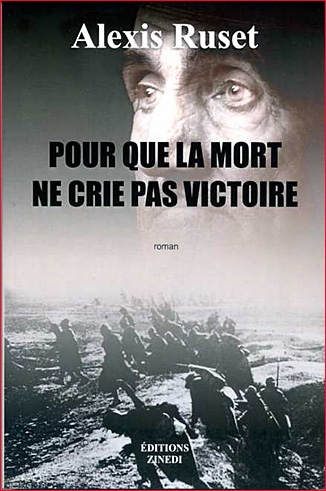 En souvenir de la boucherie de 14 et des badernes qui menaient au combat jusqu’à la dernière heure, en souvenir de ceux de l’arrière – pas les meilleurs – une réédition de cette note sur le roman d’Alexis Ruset que j’avais bien aimé à sa parution en 2017.
En souvenir de la boucherie de 14 et des badernes qui menaient au combat jusqu’à la dernière heure, en souvenir de ceux de l’arrière – pas les meilleurs – une réédition de cette note sur le roman d’Alexis Ruset que j’avais bien aimé à sa parution en 2017.
Ce roman paysan d’une belle langue, écrit et composé par un agrégé de lettres qui fut haut-fonctionnaire, se passe entre 1913 et 1919. Il a pour cadre ce monde enfui des villages agricoles des Vosges lorraines, la vie terre à terre parmi les bêtes, les superstitions et les rancœurs remâchées des ignorants. Car le monde d’hier était celui de la tradition, des habitudes, de la norme.
Non, ce n’était pas « mieux » avant ; ce n’était ni pire, ni meilleur qu’aujourd’hui et que demain, simplement différent. Un nabot venu de l’Alsace allemande est à la fois le diable et le bon dieu, il est très laid, difforme, bas sur pattes, abandonné à la naissance ; il chevauche un bouc puant aux yeux jaunes et parle un sabir à peine compréhensible pour le patois typé des gens d’ici. Mais il guérit les maladies que les docteurs ne savent pas et soigne les animaux comme s’il les comprenait. Il n’a pas de nom et on l’appelle « le petit homme ». Sa simple présence est une insulte pour tous : pour les pochards qui lui envient sa tempérance, pour les ignares qui lui envient son savoir, pour le vétérinaire qui voit sa clientèle se détourner, pour le curé qui soupçonne Belzébuth… Ne l’a-t-on pas vu un soir enfiler son bouc et ce dernier bêler de contentement ? C’est du moins ce qu’on dit, Untel ayant un copain qui en a vu un autre disant le tenir d’Unetelle.
Seuls Joseph, patriarche lorrain droit comme un chêne et respecté de tous, et son fils Octave, forgeron aux muscles développés qui défie quiconque à la boxe sans aimer se battre, protègent le petit homme. Jusqu’à ce que la guerre arrive, celle de 14 qui durera quatre ans, la guerre la plus bête, déclenchée par des imbéciles pour des motifs idiots, et qui va saigner la France et l’Europe pour des générations, datant sûrement son déclin. Tous sont mobilisés, sauf les malingres, les maladifs et les bancroches. Ceux-là mêmes qui trouvent plus valorisant d’exciter la haine contre le bouc émissaire tout trouvé de leur déficience : celui qui n’est pas de chez nous, celui qui parle barbare, celui au savoir qu’on ne comprend pas – donc diabolique.
Octave part à la guerre, comme les meilleurs, et les fluctuations du front dans les premiers mois permettent aux Allemands d’investir le village. La veulerie des faibles se déploie alors à plein et le petit homme, qui a eu le malheur d’être charitable à un sergent français blessé, est trahi par l’instituteur et le vétérinaire, aidés d’un soûlard invétéré. Tiré du grabat en chemise un matin par une escouade allemande guidée par l’ivrogne, le petit homme est amené sous un chêne où il est pendu, son bouc abattu. Joseph, qui venait s’interposer, est tué. Et toute la population venue en badaud lyncher lâchement l’anormal porte désormais le poids du péché.
Octave, bien qu’à la guerre, ne songe qu’à ne pas laisser le forfait impuni. Il distillera son œuvre, de permission en permission et la mort, avide, accomplira cette expiation. Mais elle ne doit pas crier victoire. Même la guerre la plus con ne doit pas éradiquer la vie. Celle-ci doit renaître, obstinée, malgré les malheurs. Le monde n’est ni bien, ni mal, il est mêlé. Et pour qu’il continue, la vie doit être privilégiée. L’inclination, l’amitié, l’amour, sont là pour cela. Octave ne reviendra pas mais il aura un autre but que la simple vengeance ; il aura aimé une femme et laissé un journal du front ; il s’est fait un ami et l’offrira à sa sœur pour mari. Le rance et la rancœur seront balayés par la victoire. Celle des armes et celle des cœurs.
« Si je veux que justice soit faite, c’est d’abord pour que la mort ne crie pas victoire. Elle m’a tout pris, mon père et le goût de vivre. Elle a fait du berceau de mon enfance le cercueil de mes espérances et de moi un homme vieux en poignardant dans le dos ma jeunesse à coups de lâchetés, de crimes et de trahisons. Et ça ne lui suffit pas » p.148. C’est à chacun de la combattre pour faire reculer l’obscurité du néant qu’approchent dangereusement la peur, la superstition et l’ignorance. Le goût de vivre, les liens amoureux et la raison peuvent aider à remonter la pente facile de l’abandon aux forces de mort.
Entre Genevoix et Flaubert, Alexis Ruset use d’un riche vocabulaire pour nommer précisément les choses, il parsème ses dialogues d’expressions de patois, il nous fait vivre l’époque et les personnages en cet anniversaire séculaire de la pire guerre européenne qui fut jamais. Tout cela pour nous enseigner combien la vie importe, et que le positif des gens peut surmonter la pente facile mais mortelle d’accuser, de haïr et de tuer.
Alexis Ruset, Pour que la mort ne crie pas victoire, 2017, éditions Zinedi, 215 pages, €20.00
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents