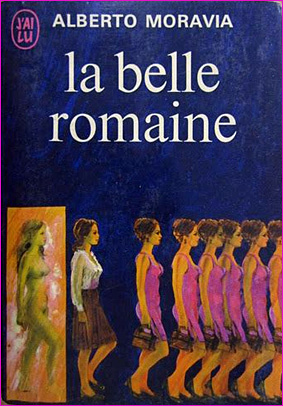
Ce gros roman a lancé la notoriété de l’auteur italien après-guerre. Né en 1907, Alberto Moravia, souvent cité pour un prix Nobel qu’il n‘obtiendra jamais (ce prix est délivré pour des raisons politiques, pas pour le talent littéraire), analyse sans complaisance les personnages velléitaires de sa société. Les Italiens ont en effet adulé le fascisme, avant de se précipiter dans les bras du communisme, puis dans ceux du consumérisme et de la mafia. Avec autant d’enthousiasme et de stupidité.
L’élite bourgeoise, catholique, puritaine et fasciste n’a rien empêché, a laissé faire, abandonné les gens à n’importe quel parti. C’est le cas d’Adriana (traduit par Adrienne en français, à une époque, les années cinquante, où l’on francisait encore tout). Elle a 16 ans au début du livre et, nue, se trouve belle. Encouragée par sa mère, elle va se montrer pour arriver. D’abord comme modèle chez les peintres, mais ils ont peu d’argent ; ensuite chez les « gens biens », ceux qui en ont, mais qui ne vont surtout pas épouser. Baiser, oui, marier, non. Or le mariage est l’idéal de vie d’une jeune fille romaine en ces années-là. Le roman se situe au moment de la guerre fasciste contre l’Éthiopie en 1935-36, une allusion y est faite un moment.
Adriana, née pauvre et sans père, mort à la guerre, est élevée par une très petite bourgeoise aigrie et envieuse qui coud des chemises pour vivre. Elle fait bosser sa fille pour mettre de l’huile d’olive dans ses pâtes. Mais quoi de mieux que de profiter de ce que la nature vous donne pour gagner de l’argent ? Car l’argent est tout, il donne la santé, le confort, le pouvoir. Une mère ne peut rêver mieux pour sa fille. Donc la sortir, la présenter, pour que les hommes l’envisagent, la désirent, finissent par l’épouser. La naïve gamine de 16 ans ne rêve que petite maison et famille autour de la table, sous la lampe, comme elle l’a vu dans son quartier excentré de Rome.
Ce n’est pas ce qui va advenir. Les peintres sont respectueux de son corps, la dessinant avec amour, mais sans la toucher, comme on contemple un bel objet. Or Adriana ressent déjà les émois de la chair, elle veut plus que les regards sur elle, elle désire être prise, pénétrée, fusionner avec un mâle. C’est assez cru, mais naturel. Elle avise alors le jeune Gino, qui conduit une belle auto. Ce n’est pas la sienne, bien qu’il veuille un moment le faire croire ; il n’est que chauffeur d’une famille riche, gardien de la villa en l’absence des maîtres. Adriana l’aime comme il est, pour sa jeunesse, sa fougue sexuelle, le plaisir qu’il lui donne, et une certaine tendresse qu’il ressent. Il promet de l’épouser dans six mois.
Mais bien sûr, pas question de mariage. La promesse est repoussée d’échéance en échéance, comme la dette de la France. C’est que Gino cache qu’il est déjà marié en province, et père d’une petite file. C’est ce qu’Astarite, ponte de la police politique devenu éperdument désireux de se faire la belle romaine, lui apprend, un jour qu’elle va le voir. Dès lors, le fantasme de vie normale d’Adriana s’écroule. Avec sa pauvreté, elle ne sera jamais épouse fidèle ni mère de famille respectable. Sa mère l’avait prévenue : on épouse riche, ou jamais. Elle choisit donc jamais. Dès le quart du roman, elle se rend compte : « je suis une putain ! » Cri du ventre plus que du cœur : elle enchaîne en effet les passes, avec les hommes qui lui sont présentés par sa copine Gisela, ou carrément dans la rue. Un ou deux par jour, qui la paient. Elle les emmène chez elle où sa mère ne dit rien, bien contente d’avoir eu raison et de palper l’argent pour enfin engraisser et paresser.
Ce qui est intéressant chez Adriana est qu’elle n’a aucun scrupule, ni aucun remord. Elle jouit de son corps comme un jeune animal, et prend son plaisir où il se trouve, avec naturel. Elle aurait préféré le jeune Gino, mais les autres la contentent, même s’ils lui répugnent parfois. C’est que le sexe a des exigences plus fortes que le cœur et que, bien-sûr, la raison. Les ouvrières romaines sont-elle obligées de se faire putes pour s’élever au-dessus de leur condition ? Sans vendre son corps, songe Adriana, « il nous faudrait recommencer, maman et moi, notre vie d’autrefois, avare, inconfortable, pleine de convoitises refoulées » p.257. La société protège les riches, pas les pauvres.
Il y aura Jacinthy le commercial, puis l’étudiant de 19 ans coincé, Astarite le policier fasciste, et encore un moment Gino : il la chausse tellement bien de son pied. Mais c’est finalement Gino qui va la perdre sans le vouloir. Il l’a emmené pour frimer à la villa de ses patrons ; ils y ont fait l’amour plusieurs fois dans sa chambre de domestique. Mais Adriana a désiré le faire dans le grand lit de la bourgeoise absente, avant de prendre un bain dans sa baignoire. Gino a cédé, et Adriana s’est emparée d’un poudrier en or orné d’un gros rubis poussoir – comme ça, pas par goût du luxe, mais par capacité à le faire. Gino est suspect d’avoir mal gardé la maison ; il va donc faire accuser une bonne à sa place, qui ne l’aime pas et le prend de haut, en volant une réserve de dollars qu’il va cacher dans sa valise ; elle est emprisonnée et battue. Gino l’apprend à Adriana pour lui montrer les conséquences de son acte irréfléchi.
Mais ce qu’il ne dit pas tout de suite, c’est qu’il n’a pas rendu le poudrier qu’Adriana lui donne immédiatement, pour faire libérer la fille. Au contraire, il cherche à le vendre à son profit ; il s’est accoquiné avec un malfrat qui peut devenir très violent s’il est contrarié… Et qui a tué un orfèvre qui lui proposait une somme ridicule de l’objet, ce qui a fait scandale dans la presse. Adriana se trouve forcée de coucher avec lui, avant d’aller coucher à nouveau avec Astarite pour faire libérer la bonne accusée à tort. Cela via un prêtre à qui elle avoue en confession toute l’affaire pour lui confier le poudrier à rendre par la police. Lequel lui ordonne de dénoncer le tueur de l’orfèvre.
Que peut-on contre le destin ? Comment arrêter un engrenage une fois qu’il s’est mis en marche ? Adriana la naïve, désormais plus de 20 ans, n’aura pas la vie qu’elle s’est rêvée. « C’est ainsi qu’après quelques heures d’angoisse je renonçais à lutter contre ce qui paraissait mon destin et l’embrassais même avec plus d’amour, comme on étreint un ennemi qu’on ne peut abattre. Et je me sentis délivrée. D’aucuns vont penser qu’il est bien commode d’accepter un sort ignoble, mais fructueux, au lieu de le refuser. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi la tristesse et la rage habitent si souvent l’âme de ceux qui veulent vivre selon certains préceptes et se conformer à certains idéaux, tandis que ceux qui acceptent leur vie, qui est avant tout nullité, obscurité, faiblesse, sont si fréquemment insouciants et gais. Dans ces cas-là, du reste, chacun obéit non pas à des préceptes, mais à son tempérament qui prend l’aspect du destin. Le mien, comme je l’ai dit, c’était d’être à tout prix joyeuse, douce et tranquille, et je l’acceptais » p.266.
Elle sera trahie, mise enceinte ; bref, la chute. Quant aux hommes, durant la période fasciste et dans le désordre après-guerre, ils restent les mêmes : séducteurs, menteurs, dominateurs. N’ayant qu’un objectif court terme en vue : assouvir leur désir.
Un film a été tiré du roman en 1954, avec Gina Lollobrigida en Adriana, disponible seulement en italien sur DVD.
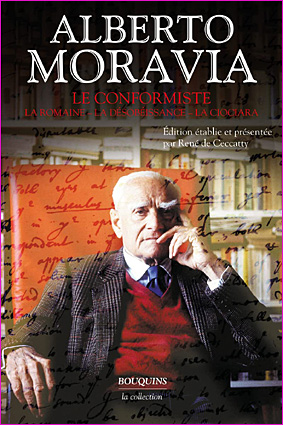
Alberto Moravia, La belle romaine (La Romana), 1947, J’ai lu 1971, 503 pages, occasion édition reliée €15,60
Alberto Moravia, Le Conformiste – La Romaine – La Désobéissance – La Ciociara, collection Bouquins 2023, 1152 pages, €32,00
Les romans d’Alberto Moravia déjà chroniqués sur ce blog
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents