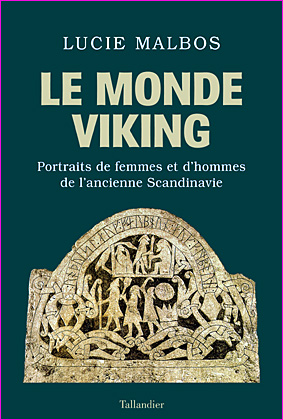
Le viking est devenu un mythe. L’archéologie contemporaine s’efforce de remettre de la vérité dans les images mentales diffusées depuis le XIXe siècle romantique et nationaliste qui n’en avait que faire. Images reprises, adaptées à notre époque, par la bande dessinée Thorgal (remarquable) et la série Vikings.
Les sources pour ce faire sont multiples. Ce sont les textes, issus des écrits monastiques (donc partiaux), ou écrits après le XIIe siècle (donc après) ; mais aussi les vestiges découverts en fouilles : le bateau d’Oseberg, la pierre runique de Jelling, la forteresse de Trelleborg, la tombe de Birka, les trous de poteaux de la halle de Borg, les restes du site de Brattahlid au Groenland ou celui de l’anse aux Meadows sur Terre-Neuve.
Tout d’abord, le terme « viking » n’est pas ethnique, ce pourquoi il s’écrit sans majuscule : tous les hommes du Nord ne sont pas vikings – et tous les vikings ne sont pas Scandinaves ; le viking est celui qui va, qui explore, marchande ou pille, un raider. On ne naît pas viking, on le devient. De même, tous les bateaux de bois vikings ne sont pas des « drakkars », mot inventé au XIXe en raison des dragons qui ornaient parfois la proue ; ce sont des knerrir (singulier knörr) de transport ou des langskip pour la guerre ou le raid. Les casques vikings ne comportaient pas de cornes, gênantes au combat ou dans la forêt et les guerriers ne buvaient pas « dans les crânes » de leurs ennemis vaincus mais dans « l’os de la tête » qui signifie la corne à boire chez les poètes nordiques.
Les vikings ne font pas partie des invasions barbares ethniques, venus de l’est en chariots avec femmes, enfants et bétail ; ils sont peu nombreux et s’assimilent très vite à la population lorsqu’ils acquièrent des terres, perdant leur langue et leur religion païenne – comme en Normandie ou dans l’est de l’Angleterre. S’ils aiment la guerre, ils préfèrent la terre. Lorsqu’ils occupent le pays, comme en Islande, dans les îles Orcades, Shetland et Féroé, ou au Groenland ou à Terre-Neuve, ils sont des colons sur des terres vierges. Ils vivent en communautés d’hommes libres ; chacun est maître sur ses terres, bondi, et se regroupe pour voter au thing (parlement) ou fait allégeance à un puissant, un jarl. Les femmes ne sont pas égales aux hommes en ce sens qu’elles ne commandent pas à la guerre ou en politique, mais elles ont un rôle très important dans la maisonnée comme maîtresse des clés, dans l’élevage des enfants et la transmission des normes de comportement, et de gestion des biens durant la minorité de leurs fils en cas de veuvage. Elles ne sont probablement pas guerrières mais souvent marchandes. La tombe de Birka, qui comportait des armes et des poids de balance a été, lors de sa découverte au XIXe, attribuée à « un guerrier », mais les analyses ADN en 2017 ont montré qu’il s’agissait d’une femme… sans aucun traumatisme des os, donc n’ayant jamais combattu. Le dépôt d’armes montrait probablement son rang social et l’appartenance à son clan familial plus que sa fonction. Pareil pour une tombe de jeune garçon de 9 ans et celle d’une fillette de 5 ans.
C’est le mérite de ce livre, produit du confinement Covid par une maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université de Poitiers, de nous montrer concrètement, au travers du portrait de quatorze personnes durant les trois âges des années 800 à 1066, comment vivaient les vikings.
Du côté des hommes : Godfred, roi des Danois, a tenu tête à Charlemagne ; le rapace Hàsteinn a été chargé par les écrits des clercs d’église comme « le pire des païens » ; Ottar a commercé à travers toutes les mers nordiques ; Harald l’Ebouriffé est devenu « à la Belle chevelure » ; Rolf, chef viking qui attaquait Paris, est devenu Robert, prince chrétien et comte de Normandie ; Harald à la Dent bleue a converti son peuple au christianisme ; Eric le Rouge (parce que roux) a colonisé l’Islande, puis le Groenland, et ses fils ont exploré l’Amérique du nord de Terre-Neuve à l’embouchure du Saint-Laurent et jusqu’à Boston (le Vinland, terre de la vigne) ; Olof III annonce la fin des temps vikings et fonde le royaume chrétien de Suède face aux Danois ; Toki le forgeron qui fit ériger nombre de pierres runiques en souvenir des hommes glorieux à ses yeux était un esclave fortuné.
Du côté des femmes : les défuntes du bateau d’Oseberg étaient peut-être reines, prêtresses ou prophétesses avant l’an mil ; Frideburg et Catla de chrétiennes riches et pieuses en terres païennes à Birka ; la fillette de 5 ans de famille riche enterrée à Birka venait d’ailleurs ; la marchande guerrière de la tombe Bj 581 de Birka était entre « grande femme et fluidité des genres » ; Estrid la matriarche sept fois mère au moins, voyageuse et bâtisseuse, veuve riche et indépendante était gardienne de la mémoire chrétienne de la famille après l’an mil.
26 pages de notes, 10 pages de bibliographie, 5 pages de lexique, 8 pages d’index : il s’agit d’un livre scientifique, mais écrit d’une plume alerte qui raconte bien et laisse poindre parfois l’émotion face aux tombes d’enfants ou au sort des jeunes lors des raids ou des colonisations. « Seigneurs de la guerre, seigneurs de la terre, seigneurs de la mer, seigneurs du feu, les anciens Scandinaves pouvaient être tout cela ; pas forcément à la fois, pas nécessairement de façon exclusive ni toute une vie durant. La diversité des profils, jamais figés, était infinie… » p.283. Le viking en tant qu’archétype est l’homme libre vivant en communauté, l’explorateur qui féconde des terres nouvelles, le guerrier qui n’hésite pas à affirmer son existence. L’auteur note « leur incroyable curiosité et leur formidable esprit d’aventure, les incitant sans cesse à repousser les frontières du monde connu ; sans oublier leur capacité d’adaptation hors pair » p.285. Dans un monde édifié par l’Église sur les ruines de l’empire romain tombé sous les coups des invasions venues de l’est, et qui se refermait en petits royaumes étroits, frileux et menacés, les vikings ont apporté un grand souffle d’air frais. Ils ont fait un temps de la Baltique et de la mer du Nord le centre du monde commercial devant la Méditerranée, depuis le pillage du monastère de Lidinsfarne dans le nord de l’Angleterre en 793 à la mort au combat du roi norvégien Harald le Sévère en 1066 à la bataille de Stamford Bridge en Angleterre et à la conquête par Guillaume le Conquérant venu de Normandie la même année.
Un bel ouvrage au cahier central de photos couleurs, auquel on peut adjoindre le numéro spécial 98 des Collections de L’Histoire, Les vikings, une histoire mondiale, hors série janvier-mars 2023, en kiosques (€9,90).
Lucie Malbos, Le monde viking – portraits de femmes et d’hommes de l’ancienne Scandinavie, 2022, Tallandier, 350 pages, €21,90 e-book Kindle €14,99
Les vikings sur ce blog












Commentaires récents