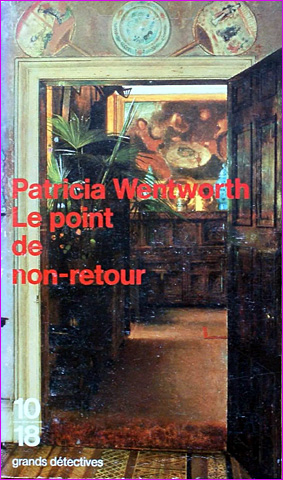
Fille de général britannique de l’armée des Indes et épouse de deux colonels, Dora Amy Elles Dillon Turnbull a écrit sous le pseudonyme de Patricia Wentworth de nombreux romans policiers avant son décès à 82 ans en 1961. Nous sommes toujours dans l’Angleterre post-victorienne, pas encore contemporaine, où les rôles sociaux sont figés et où la tasse de thé résume la vie sociale des femmes.
Crime et romance sont les ingrédients principaux des œuvres Wentworth. L’opus ici chroniqué n’y manque pas. Rosamond est une jeune fille sous la coupe de sa tante, l’impérieuse et glaciale Lydia Crewe, à qui elle sert de dame de compagnie dans son manoir antique, fierté de la famille depuis plusieurs siècles. Sa jeune sœur Jenny, 12 ans, a réchappé d’un accident deux ans auparavant et reste à la maison, à se rééduquer mais surtout à dévorer des romans à l’eau de rose et à s’essayer à l’écriture. Elle a envoyé une lettre avec quelques œuvres à un éditeur londonien, lequel vient frapper un soir à la porte du manoir. Non qu’il veuille déjà la publier, c’est trop tôt et son style imite plus qu’innove, mais ses observations sont intéressantes et à développer. Et le début de ce roman dit « policier » consiste à toute une série de conseils aux jeunes écrivains, pas mauvais d’ailleurs.
Mais Craig Leister, jeune homme vigoureux et viril, outre qu’il a un vieil oncle à visiter dans le coin, a surtout été attiré par la photo jointe à l’envoi de Jenny : celle de sa sœur Rosamond. Il en est tombé amoureux. Début de la romance, qui se conclura in extremis à la fin, pressée par les circonstances. La vieille Crewe, imbue de dynastie, est à moitié folle, mais cela ne se voit pas encore. En tout cas, sa sénilité prend des proportions autoritaires et implacables. Les femmes de charge surprises dans son salon sont sévèrement tancées, et leur curiosité bien punie. Hautaine avec tout le monde, Lydia Crewe l’est constamment en public avec Henry, son ancien amour de jeunesse disparu durant vingt ans après avoir été accusé (à tort ?) d’avoir volé un bijou. Sauf que ce n’est pas si simple…
La campagne recèle un important centre militaire d’études sur les avions et les services de contre-espionnage sont très sensibles à tout ce qui survient de particulier dans le coin. C’est d’abord la disparition sans laisser de traces de Maggie Bell, de qui on a reçu deux cartes postales disant qu’elle était partie. Puis, tout récemment, Miss Holiday, qui avait ramassé une lettre adressée à Lydia Crewe qui traînait par terre. Les cancans vont bon train dans le village, tout se sait, répandu comme une traînée de poudre. Si les morts se succèdent, n’est-ce pas parce qu’on voudrait supprimer des témoins ? Cacher un secret ?
L’inspecteur Frank Abbott, beau jeune homme blond bien mis, est chargé par son commissaire de Scotland Yard d’enquêter discrètement sur le terrain. Mais quoi de plus discret que d’engager une vieille dame adepte du tricot pour sa nièce et de tasses de thé bien fort, pour faire parler les rombières ? Car, en ce début des années 1950 en Angleterre, les femmes ont toujours des réticences à parler aux hommes, qu’elles ont peu fréquentés passé l’âge de 7 ans, et encore moins à la police. Miss Maud Silver, bien connue de Scotland Yard, est donc mise à contribution pour tirer les vers du nez de ces ménagères cancanières. On soupçonne un réseau d’espionnage derrière les disparitions, et de mystérieux bouts de papier écrit en cyrilliques sont retrouvés dans les poches du jeune dessinateur industriel Nicholas, neveu d’Henry Cunningam. Miss Silver a justement une amie d’enfance qu’elle n’a pas vue depuis des années et qui l’a invitée à venir passer quelques jours. Ces oncles, parents, cousins, amis, toujours disponibles près des lieux du crime chez Wentworth sont assez convenus, mais bien pratiques pour l’intrigue.
Celle-ci est longue, tortueuse, illustrant la noirceur de certaines âmes humaines et la veulerie d’autres. Jenny se fait dorloter par sa sœur, comme Henry par la sienne, mais sa tante Lydia Crewe l’a vue marcher et sortir de nuit de la maison et décide de l’envoyer illico à l’école pour qu’elle ait une éducation normale. Lucy Cunningam, entendant le téléphone sonner une nuit dans le hall à 3 h du matin, a failli se fracasser la tête dans l’escalier parce qu’une corde huilée y était tendue. Il n’y avait que deux autres personnes dans la maison fermée à clé : son frère Henry, qui passe son temps à collecter des insectes, chenilles et araignées, pour les envoyer à ses correspondants en Belgique, et Nicholas, le dessinateur d’études au centre militaire qui sort le soir et rentre toujours très tard. Qui a voulu la tuer ? Et pourquoi ? Elle qui ne fait de mal à personne et aide au manoir. Mais justement…
Tout à fait dans le style un peu vieillot de l’autrice, plus romanesque que la Miss Marple de sa consœur Agatha Christie, citant le poète Tennyson mais moins fouillée sur la psychologie. Intéressant pour l’intrigue, bien ficelée, mais aussi sur l’état de la société britannique dix ans après la guerre, encore figée dans ses coutumes et ses statuts sociaux archaïques.
Patricia Wentworth, Le point de non-retour (Vanishing Point), 1955, 10-18 1993, 260 pages, occasion €12,06,e-book Kindle €9,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans policiers de Patricia Wentworth déjà chroniqués sur ce blog



Commentaires récents