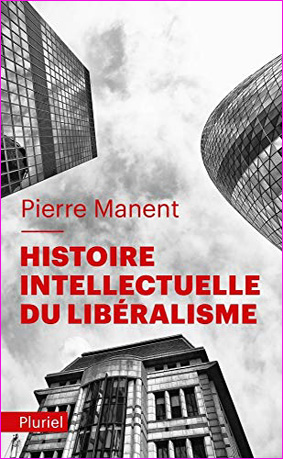 L’auteur, disciple de Raymond Aron, a dirigé la revue Commentaires. Pierre Manent est aussi l’auteur d’un livre sur Tocqueville. C’est dire s’il a étudié et réfléchi sur ce libéralisme venu des Lumières, désormais synonyme (à tort) d’économie capitaliste et devenu, dans les bouches polémiques, un gros mot. Son Histoire remet les choses à leur place : politique d’abord, économie ensuite.
L’auteur, disciple de Raymond Aron, a dirigé la revue Commentaires. Pierre Manent est aussi l’auteur d’un livre sur Tocqueville. C’est dire s’il a étudié et réfléchi sur ce libéralisme venu des Lumières, désormais synonyme (à tort) d’économie capitaliste et devenu, dans les bouches polémiques, un gros mot. Son Histoire remet les choses à leur place : politique d’abord, économie ensuite.
Si l’empire médiéval est une forme politique qui a sa correspondance dans l’universalité de la nature, la cité italienne qui émerge à la même époque vise à la maîtrise de ses conditions d’existence par l’association humaine. Ces doux modèles issus de l’antiquité ont laissé place à l’Eglise. Elle a pris en charge, au haut moyen-âge, les fonctions sociales et politiques par carence des autorités civiles à la suite des invasions barbares. Puis la monarchie nationale a réglé un temps la contradiction entre le devoir moral des clercs sur les actions humaines et l’indépendance du corps politique face au pouvoir de Rome.
La redécouverte d’Aristote à la Renaissance, en textes non filtrés par les moines, permet au monde laïc de penser par lui-même, hors des catégories du dogme chrétien. Il se libère de la présomption de dévoiler la Vérité unique des choses pour les expérimenter par lui-même. Enfin, les guerres de religion ont montré l’exigence d’un Etat neutre qui garantisse la liberté dans les règles.
Machiavel est le premier des libéraux. Le Prince saura prendre appui sur le peuple contre les Grands, afin de fonder un ordre stable.
Pour Hobbes, l’état de nature est la peur. L’initiative politique vise à assurer la sécurité et la paix. Hobbes réfléchit sur la guerre civile anglaise qui décapita Charles 1er bien avant que les Français ne raccourcissent leur débonnaire Louis XVI. Le fondement de la souveraineté est l’individu et son souci premier est d’éviter la mort. Société civile et Etat se rejoignent dans la représentation. La passion humaine fondamentale est le pouvoir. Pour se réunir en société, les hommes doivent construire un pouvoir au-dessus de chacun, incomparable, qui surplombe les égaux. C’est Léviathan : hors la loi, tout est libre, « le droit prend la place du bien » p.63.
Locke décrit l’indépendance morale absolue de l’individu et sa relation d’hostilité envers tous les autres. Il distingue deux types d’hommes : les aristocrates, qui préfèrent le prestige et le pouvoir à la sécurité – et les bourgeois, qui préfèrent la sécurité avant tout. Le droit de propriété est antérieur à l’institution de la société car il ne dépend pas du consentement d’autrui mais du travail personnel, seul rapport naturel de l’homme à la nature. L’invention de la monnaie répond au désir de l’individu de rendre incorruptibles les biens qu’il a produit (qu’ils ne pourrissent pas). Elle suppose en même temps les échanges, donc le contrat. Le libéralisme tend alors naturellement à l’économie, dont l’Etat doit garantir la liberté par des règles.
Montesquieu est libéral non seulement dans ses principes mais aussi dans son humeur. Il part de l’expérience politique anglaise, l’opposition du pouvoir et de la liberté, de la société civile et de l’Etat. Le désir de pouvoir naît des institutions, le pouvoir conféré rend avide de pouvoir encore plus grand. Il faut donc séparer les pouvoirs institutionnels afin qu’ils se contrebalancent. Dans un régime fondé sur la représentation, c’est le Législatif qui est tenté d’abuser de son pouvoir. Il faut donc l’équilibrer par un Exécutif consistant. Le pouvoir des citoyens doit servir leurs intérêts et ne pas trop peser sur la société. La liberté naît de la combinaison entre impuissance de chaque citoyen et impuissance du pouvoir tout seul. Le compromis est souverain. D’où les deux idées modernes : « l’idée de représentation, et celle de séparation des pouvoirs » p.139.
Pour Rousseau, le crédit (la confiance envers le pouvoir) est fixé par l’opinion, autorité sans lieu ni organe. L’inégalité, mesurée par la richesse, ne naît pas du pouvoir mais de l’opinion – car se comparer est le malheur des hommes modernes. Reprocher au pouvoir les inégalités est une façon d’évacuer sur un bouc émissaire sa propre impuissance à s’élever dans la société ou, tout simplement, son incapacité à organiser son bonheur avec ce qu’on a. L’homme de la nature est heureux et bon parce qu’il est un ; la société corrompt l’homme en le divisant par l’envie, issue de la comparaison et de l’évaluation sociale. Être heureux, dira plus tard un économiste, c’est gagner tout juste un peu plus que son beau-frère. Pourtant, objectons à Rousseau que l’homme tout seul n’est qu’une bête sauvage. La société le civilise – faut-il considérer cela comme une « oppression » ? Oui, disaient les soixantuitards (et Rousseau lui-même, ce paranoïaque) ; non, répond le citoyen adulte et responsable : éduquer, c’est émanciper la personne et assouplir le vivre-ensemble. Pour Rousseau, il faut placer l’intérêt public en contradiction avec tous les intérêts privés, ainsi l’égalité sera radicalement imposée à tous et l’envie disparaîtra. Mais qui définira l’intérêt « général » ? Uns infime minorité de représentants partisans ? Ceux qui gueulent le plus fort ? Une étroite oligarchie ? Une caste de prêtres-savants, autoproclamés guides du Peuple ou « avant-garde » du processus historique ? La perpétuelle votation par assemblées, comités ou Internet ?
Benjamin Constant voit dans l’égalité le but ultime de l’histoire humaine. Le mouvement social est histoire mais le pouvoir ne peut faire n’importe quoi car il rencontre les limites de la nature. Le principe de la souveraineté du peuple fonctionne en négatif : aucun individu n’a le droit de soumettre tous les citoyens à sa volonté particulière. Tout pouvoir légitime est nécessairement délégué par la majorité des citoyens. Les institutions ne peuvent que refléter l’état social déterminé par l’histoire au présent : imposer Sparte au XVIIIe siècle, comme le voulait Saint-Just, est un échec qui aboutit à la Terreur.
Guizot estime que le pouvoir représentatif doit chercher dans la société les moyens de gouverner, « employer la force qui existe ». L’autorité de l’histoire ne fait qu’une avec celle de la nature. Le seul souverain est le consentement du peuple. Tout acte politique est contraint de le chercher préalablement pour établir le droit.
Tocqueville montre que l’égalité est un processus dont le terme est indéfini : l’égalité croissante des conditions. Car la nature crée sans cesse des inégalités et la seule relation d’égalité valable est le contrat, donc un ordre politique humain dans l’histoire. A mesure que chaque homme se sent plus semblable aux autres, il devient plus sensible à leurs souffrances car elles pourraient être les siennes. Mais l’abaissement des différences atténue aussi les liens et le citoyen égalitaire devient de plus en plus… indifférent à ce qui n’est pas lui et ceux qui entourent son confort. La démocratie dissout la société. Deux comportements opposés apparaissent : 1/ le goût de la concurrence pour surmonter l’égalité par son talent ; 2/ le refus de la concurrence qui conduit à confier tous les pouvoirs à l’administration d’Etat pour être sûr qu’ils ne seront pas exercés par le voisin. Voilà les deux tendances issues des révolutions des années 1780 : l’américaine et la française… La démocratie, dit encore Tocqueville, rabaisse l’échange intellectuel car, si tous sont égaux, le goût de croire un autre que soi-même décroît. La confiance en la similitude conduit plutôt à avoir confiance dans le grand nombre. La tyrannie des sondages, de la pensée unique, du politiquement correct, du “lu sur Internet”, ne sont pas loin ! La démocratie devient un despotisme doux. Si le pouvoir en place prend la précaution d’éviter toute mesure brutale et d’enrober de démagogie toute décision au fond violente, les citoyens resteront particulièrement dociles. Ce que jouent les écolos d’aujourd’hui avec le chantage à l’Apocalypse du climat ou l’angoisse permanente pour la santé… mais ce que ne réussissent pas les technocrates socialistes, républicains ou macroniens, dont la démagogie est maladroite et trop enrobée pour être avalée sans soupçons.
Il est intéressant de se replonger dans l’histoire des idées pour comprendre notre société d’aujourd’hui. D’étudier surtout le libéralisme, ce mot tordu par les démagogues.
Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, 1987, Fayard Pluriel 2012, 252 pages, €9.00
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents