Jünger poursuit sa réflexion sur les événements qui surviennent dans son existence. Il a passé 70 ans et ces pages sont un carnet de vieillesse. Il ne sait pas encore qu’il dépassera les 100 ans et que la vieillesse est donc toute relative. Il évoque les insectes, les plantes, les rêves qu’il fait, les amis qu’il rencontre, les voyages qu’il accomplit. Et toujours, trente ans plus tard, la blessure qui jamais ne se refermera, le fils aîné disparu, Ernstel, comme une branche coupée.
Il faut lire Jünger avec une flore à proximité pour saisir le sel de ses remarques sur les plantes. De même pour les insectes. Ces bestioles m’intéressent peu, comme les rêves de l’auteur qui restent hors de mon domaine et dont la description, toujours très personnelle, toujours absurde, m’agace un brin. Cela vient moins des images elles-mêmes, d’un surréalisme systématique, que du sens caché que s’obstine à chercher Jünger sans jamais mener sa réflexion jusqu’au bout, comme s’il en avait peur. Le flou lui convient, il se complaît dans cette atmosphère de mystère auto-entretenu. De là mon agacement. C’est la vieille tentation romantique allemande de considérer chaque chose comme un reflet d’un autre monde, comme dépositaire d’un sens caché. L’Initié est alors celui qui a reçu le don du regard. Il n’est pas le savant qui promène sa pauvre lumière dans les recoins obscurs, mais le détenteur de la grâce, une sorte de poète qui « voit » sans avoir besoin d’aiguiser son regard. Quel orgueil ! Cela est furieusement protestant, naïvement adolescent aussi. Jünger, malgré son âge, n’avance pas en sagesse. Il ne voit pas la faiblesse de cette approche, cette conviction d’être en quelque sorte élu. Il est trop envahi de culture germanique, trop naïvement sérieux pour s’en rendre compte. Que le lucane soit un arcane heurte notre vieux bon sens latin.
Ce « positivisme » est sans doute un trait de caractère propre à la culture française, comme le note justement l’auteur à propos de la traduction de ses œuvres : « le Français tend au ‘de deux choses l’une’, et l’Allemand au ‘les deux choses à la fois’. C’est ainsi que le texte gagne en clarté et qu’il perd peut-être en profondeur » II p.527. Je m’interroge sur cette « profondeur », bien proche me semble-t-il de l’obscurité. Ne s’agit-il pas d’une angoisse « profonde » ? Ne préfère-t-on pas laisser dans le flou ce que l’on a peur de découvrir, signe d’une identité peu sûre d’elle-même ? D’où la fascination, peut-être, pour les insectes blindés qui croissent et multiplient sans état d’âme. Programmés, ils n’ont pas le fardeau de leur culture à vivre, ni celui de leur histoire à accomplir. Quel exemple fascinant pour un Allemand qui se recrée sans cesse depuis un siècle ! Une Europe enfin unie pourra-t-elle un jour rassurer ce peuple pris entre le nord et le sud, l’est immense et l’ouest impérieux ?
Au fil des jours, beaucoup d’observations donnent à penser – ce pourquoi on lit Jünger et pourquoi je préfère son journal à ses essais. Il est plus particulièrement apprécié en France où, malgré Montaigne, le superficiel semble avoir gagné presque tous les contemporains.
Je note cependant dans Soixante-dix s’efface le style de plus en plus allusif, le dédain de préciser la pensée, les grands rapprochements d’idées sans en tirer leçon. Il semble qu’avec l’âge qui s’avance, la paresse envahisse le style au rythme où se perd la vitalité. Le style, justement, semble se pétrifier. L’âme se cherche sous les fleurs, la terre et le rocher. Grande est la nostalgie de l’Ordre, de ce qui perdure et ne change pas. Fascinant est cet amour du classement, de la mise en nom des insectes ou des plantes, et des humains aussi, en parallèle, avec leurs modèles historiques.
Jünger se révèle profondément conservateur. Il est un paysan de l’ordre ancien, antérieur aux Lumières. Il observe l’histoire comme le cycle des saisons, les individus comme les archétypes véhiculés par les ballades et les légendes. Il cherche à percevoir le destin dans les cartes, les nombres, l’ésotérisme. Le présent le déçoit, il le préfère hermétique. Ce pourquoi il aime « le vieux Boutefeu (Nietzsche), plutôt voyant que philosophe » II 571. Est-ce pour l’excitation intellectuelle ? Car Nietzsche n’a pas ce conservatisme viscéral de la pensée, il hait la « lourdeur » allemande, sa satisfaction de vache à l’étable, son classement sans fin du monde établi. Il rêve d’un homme qui se surmonte, acteur de son histoire, qui bâtisse sa morale sans ressasser le vieux livre millénaire lui enjoignant d’obéir sans penser. Il préfère qui construit une éthique avec ce qu’il vit et comprend, pareil à ces Vikings qu’aimait aussi Jünger : « Notre prédilection de jeunesse et leur monde moral – au sens du « moral » bien entendu. Ma passion avait gagné Ernstel ; la saga de Gisli–le–Proscrit et de son dernier combat sur la falaise, était le récit qu’il préférait » 28 juillet 1968.
Mais Jünger est las de se battre. En témoigne cette réflexion du 25 mai 1971 : « L’aspect féminin de la nature est conçu comme immortel, le masculin, en revanche, comme éternellement changeant et ne subsistant qu’en vertu d’un rajeunissement perpétuel, qui suppose une mort perpétuelle ». Ce pourquoi beaucoup d’hommes sont plus sensibles aux petits garçons qu’aux petites filles – sauf exception, comme l’auteur le 24 avril 1978 : « Des petites filles chevauchaient les canons – tableau fantastique ». Sensuel aussi, le vieil austère ne le dit pas.
Car « un journal intime a de l’importance presque comme la prière, qu’il remplace d’ailleurs en partie », 20 mars 1980.
Ernst Jünger, Soixante-dix s’efface, Gallimard 1984, 553 pages, tome I €28.40, tome II €50.52, tome III €29.40, tome IV €35.50, tome V €19.80
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

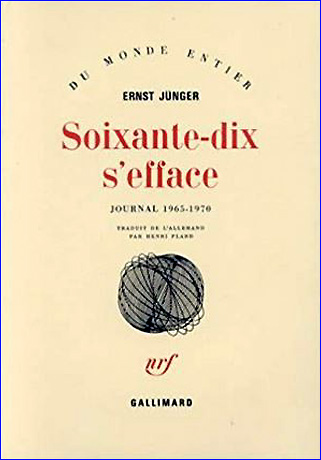
Commentaires récents