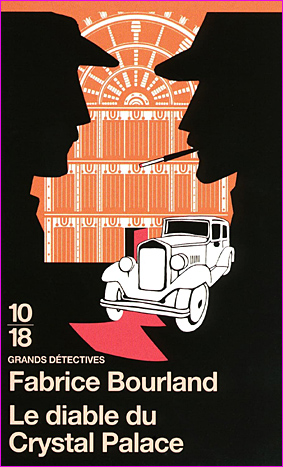
Un roman policier historique qui se passe à Londres en 1936, à la veille du grand incendie du Crystal Palace, ce grand hall d’exposition de 563 m de long en fonte et verre plat, construit pour l’Exposition universelle de 1851. L’intrigue commence par la visite d’une jeune femme chlorotique, Anne Grey, qui vient solliciter un duo de détectives pour retrouver son fiancé Frédéric, disparu depuis plusieurs jours. Ce duo est celui d’Andrew Singleton et de James Trelawney, garçons célibataires dans la trentaine, qui vivent en colocation chez une logeuse qui s’occupe du ménage et des repas. L’auteur s’est manifestement inspiré de Sherlock Holmes et de son compère Watson pour camper un Singleton cérébral et nul aux armes, flanqué d’un Trelawney athlétique et coureur de jupons. Mais les deux compères sont plus légers que les créatures de sir Arthur Conan Doyle.
Il n’empêche. L’exercice d’admiration de Bourland envers Conan Doyle ne s’arrête pas là. Il reprend en effet Le monde perdu, cette expédition de 1912 sur le haut plateau du Roraïma au Venezuela, où les savants découvrent des créatures préhistoriques conservées dans leur jus jusqu’à nos jours. Qu’à cela ne tienne, il faut que cela se passe à Londres en 1936. En effet, ledit Frédéric a été atterré, selon sa fiancée, par la lecture d’un entrefilet de journal sur la rencontre brutale d’un taxi avec un fauve qu’il croit échappé d’un zoo. Maigre indice, mais à creuser.
Le pigiste retrouvé, un Tintin en culotte de golf de 18 ans, a bien rencontré le chauffeur de taxi dans le bar où il a ses habitudes. Il a heurté l’animal, tombé du pont au-dessus, a vérifié qu’il était bien mort, et est allé téléphoner à la police. A son retour, la bête avait disparu, et une camionnette Morris Crowley a démarré en trombe. Il n’en sait pas plus. Non, il n’a pas rêvé, non il n’était pas saoul. Les détectives vont le voir, il confirme. Dès lors, énigme : sa description précise correspond à un tigre à dents de sabre, espèce disparue depuis 20 000 ans. Consulté, le Pr Rufus Winwood, zoologue du Museum d’histoire naturelle, avoue collecter des preuves d’animaux censés avoir disparu, mais attestés ici ou là sur la planète, à commencer par le « monstre » du Loch Ness. Mais c’est une impasse.
Jusqu’à ce qu’un autre article fasse état d’un « grand singe » aperçu dans Londres, près des voies de chemin de fer de la Southern Railway, qui relie le Crystal Palace à London Bridge. Il faut y aller voir. Trelawney doit écourter un rendez-vous galant dans un restau chic pour retrouver Singleton, aventuré dans les ruelles mal famées de l’East End. Un grognement, c’est la bête. Nue et velue, elle attaque. Trelawney, malgré sa force, est étranglé… jusqu’à ce que Singleton, tétanisé, trouve l’énergie enfin de tirer une balle avec le pistolet de son ami, tombé à terre. La bête est morte, vite l’emporter, la montrer au professeur.
Lequel déclare, enthousiaste, qu’il s’agit d’un Pithécanthrope Erectus (aujourd’hui on dit Homo Erectus), découvert par Eugène Dubois à Java en 1894. Mais en plein Londres, en plein XXe siècle ! En enquêtant au domicile de Frédéric, toujours pas reparu, un fragment de page de revue brûlé fait émerger alors une théorie farfelue et fantastique, mais bien dans l’imaginaire fin XIXe, celui de Jules Verne et d’Arthur Conan Doyle : la régression possible des êtres vivants à leur forme archaïque…
Singleton et Trelawney ne vont pas retrouver Frédéric, ni d’autres disparus, pas plus que le chat de la maison. Mais il vont mettre au jour le mécanisme d’une implacable vengeance qui utilise la science marginale pour un but dévoyé : la vengeance. Jusqu’à l’apparition du diable ! Un ptérodactyle d’il y a 150 millions d’années, haut d’1m50, au bec pointu muni de 90 dents, aux ailes membraneuses et aux griffes acérées – tout à fait la description des paranoïaques chrétiens médiévaux, reprise dans les films d’horreur yankees.
Il y a de l’action, un déroulement progressif de l’enquête, un thème original. Les personnages sont un peu falots, surtout si l’on a lu les aventures de Sherlock Holmes, mais avec une intrigue tirant plus sur le fantastique. Un bon roman de détective.
Fabrice Bourland, Le diable du Crystal Palace, 2010, 10-18 Grands détectives, 276 pages, €4,67, e-book Kindle €11,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

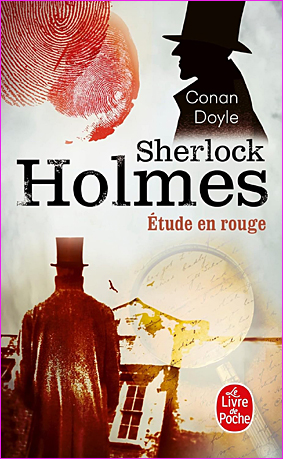










Commentaires récents