Une réflexion s’éclaire sur la durée. En publiant un recueil de ses articles parus depuis vingt ans dans la revue Le débat, Marcel Gauchet éclaire les transformations de la société politique d’un jour nouveau. Il montre la cohérence en mouvement.
Dans les sociétés traditionnelles, les structures venaient de la religion. L’homme y refusait sa propre puissance de créateur par crainte révérencieuse des lois sacrées. La légitimité venait du dehors, du passé, de l’au-delà. La religion panthéiste des sauvages est totale, le magique est partout et au quotidien. Nos grandes religions monothéistes sont moins prenantes, Dieu est tellement hors du monde qu’il laisse une certaine autonomie aux personnes. Le Christ établit même une religion intérieure, un face à face personnel. Le christianisme permet historiquement de sortir du pouvoir totalitaire des religions, de leur magie, de leur répétition, de leur ordre transcendant qui évacue le sujet.
La rupture moderne est l’histoire. La société se produit elle-même en se projetant dans le futur, un futur construit pas à pas à l’aide des acteurs. Sa réalisation la plus forte est l’État-nation.
L’une de ses dérives est le totalitarisme, alliance de la forme vide du religieux et de la forme pleine du laïcisme. Dieu est mort et il ne se passe rien. La société se prend elle-même pour Dieu en déifiant l’Etat ou la nation.
L’autre dérive, mais inévitable, est celle de la société actuelle. Elle sacralise tant les droits des individus qu’elle sape la puissance collective. Elle laisse faire l’outil, l’économie, alors que la raison de l’économie n’est pas dans l’économie mais relève d’une orientation culturelle. Une société qui se produit elle-même transforme la nature et produit son propre univers matériel. Mais ce n’est pas l’individu qui peut le réguler. Sans l’État, pas d’individu mais l’anarchie des rapports de force arbitraire. Le règne singulier de l’individu suppose l’empire général de l’État. Un équilibre est atteint avec « la démocratie libérale [qui] advient grâce à la combinaison synthétique de ces trois éléments, le politique, le droit, et le social–historique » p.335.
Les trois vagues de la modernité sont ainsi successives :
La première va de 1500 à 1650 en Europe. Les Etats–nations sont des relais à l’indépendance vis-à-vis des dieux. L’individu abstrait se dégage théoriquement, à l’intérieur d’une société d’Ancien régime où n’existent que hiérarchie, dépendance et corps constitués.
La seconde étape voit l’émergence de la société civile avec ses franchises, ses droits subjectifs, son contrat social. L’individu concret, juridique, se dégage peu à peu des Etats–nation, munis de libertés formelles.
La troisième étape fait entrer l’historicité. Les sociétés deviennent « libérales ». L’étape d’accélération la plus récente date des années 1970 où apparaît « l’individu détaché en société », appartenant et indépendant à la fois. Car la tradition est intenable, le progrès insaisissable et la révolution improbable.
Quel sera le prochain mouvement de la société ?
Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, 2002, Gallimard Tel, €12.90 e-book Kindle €8.99

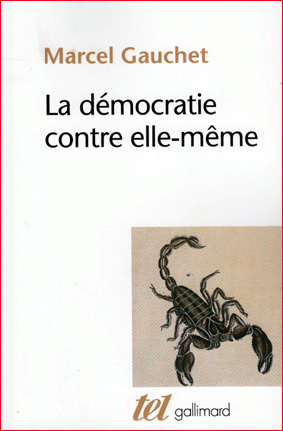
Commentaires récents