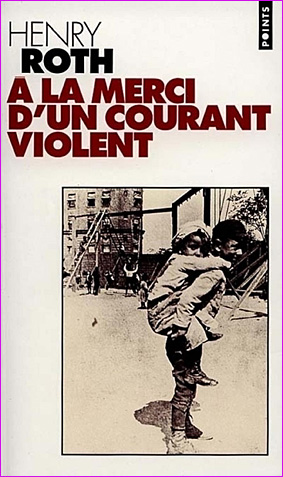
Henry Roth (à ne pas confondre avec Philip Roth) est né juif en 1906 en Galicie, dans l’ancienne-Autriche-Hongrie. Décédé en 1995 à 89 ans, il livre un an avant sa mort ses ultimes souvenirs, reconstitués soixante-dix ans après : A la merci d’un courant violent. Le courant est la religion juive orthodoxe, qui l’a handicapé dès l’enfance et névrosé pour toute sa vie. Le premier tome est Une étoile brille sur le Parc du Mont Morris – ce volume chroniqué ici. Il y évoque la période de ses 8 à 14 ans à New York.
Il a émigré avec ses parents à l’âge de 3 ans, en 1909, cinq ans avant la guerre de 14 qui allait entraîner un bouleversement de l’Europe et l’entrée en guerre des États-Unis. Le jeune Henry, qui est incarné par Ira dans ses souvenirs publiés, est un gamin dans la misère, comme la plupart des nouveaux immigrants. Il habite un quartier pauvre de New York et joue dans la rue avec des gamins aussi dépenaillés que lui, des Irlandais et des Italiens. Jusqu’à ce que ses parents décident d’emménager dans le quartier juif, pour se rapprocher de la famille de sa mère, des grands-parents, une tante, quatre cousins-cousines. Le gamin qui allait jusqu’alors à l’école religieuse juive (Heder) et récitait par cœur la Torah, en enfant sage, se prend d’une répugnance progressive pour tout ce fatras de superstitions et de langages – le yiddish, le hongrois, la langue du Talmud. Il veut devenir comme les autres, un bon Américain.
Son père, irascible et brouillon, incapable d’un travail suivi sans s’engueuler avec ses patrons ou partenaires, le bat brutalement. Seule sa mère le protège, « mère juive » dans sa caricature de conservatrice des traditions et d’amour enveloppant. Ira ne s’est battu qu’une fois avec un petit Irlandais blond qui le traitait de youpin ; ils sont devenus copains. Mais il est lâche et préfère la facilité ; quand il rentre de l’école tabassé, sa mère lui dit d’esquiver, de s’en tirer par un bon mot – c’est plus efficace qu’un bon coup. Ado, il se fait un ami goy catholique et l’admire, car il est à l’aise en toutes circonstances, sans traîner oripeaux et casseroles de la judéité.
A 13 ans et demi, il poursuit l’école dans la section commerciale (sténo, compta et espagnol) tout en travaillant à mi-temps dans un magasin d’alimentation de luxe qui livre à domicile. Il a fait sa bar mitsva, il est désormais considéré comme un membre de la communauté, son père ne lève plus la main sur lui. Ira décrit son entourage, ses copains, ses collègues, sa famille – le retour de l’oncle Moe, requis par le service militaire au grand dam de sa mère juive qui se lamente et ne mange plus. Qu’a donc un Juif à faire avec les batailles des Goys ? Mais Moïse, abrégé en Moe, qui se fait appeler Morris à l’armée pour faire moins juif, était serveur dans le civil et il est affecté à l’intendance. Il organise la bouffe du régiment, les commandes, les prix, les menus, les rations. Il s’en tire sans dommage.
L’obsession d’Ira est le sexe, dès un âge très tendre (Henri Roth, Philippe Roth, Epstein, Strauss-Kahn, on se demande s’il y a là une constante). Malgré quelques invites à se frotter de la part d’un copain sur un toit, d’un marginal qui l’emmène au parc, d’un prof qui cherche à le branler, il n’est pas séduit. Il reluque plutôt les jambes des petites filles dès 9 ans, se caresse aux cuisses de sa mère à 11 ans ; elle a voulu dormir avec lui pour se rassurer lors d’un voyage du père. Il avoue incidemment « niquer » (ainsi écrit-il) à 16 ans tous les jours sa sœur de 14 ans « dès que la clé a tourné dans la porte » au départ des parents. Pour le reste, il élude la petite sœur ; il n’en parle pas. Ses souvenirs sont sélectifs, marqués par ses rapports tourmentés avec sa famille et avec la tradition juive orthodoxe.
Henry Roth finira par épouser à 33 ans la fille d’un pasteur baptiste (surtout pas juive !) avec laquelle il aura deux enfants. Ce n’est que dans son ultime vieillesse qu’il consent à avouer les turpitudes de sa prime adolescence complexée.
Un livre de mémoire reconstruite qui permet de découvrir la vie bariolée des immigrants à New York dans les années 1910. Un style de conteur, bardé de mots yiddish. C’est parfois captivant, mais je n’aime pas les coupures de dialogue avec son ordinateur des années 1980 qu’il appelle Ecclesia. Des incidences en général insipides qui coupent le récit, même si l’objectif est probablement de rendre relatif ce qui est raconté. Le lecteur pourra sans dommage les sauter (sans jeu de mot) à chaque fois.
Avec un arbre généalogique des deux côtés de la famille et un lexique de 7 pages de yiddish.
Henry Roth, A la merci d‘un courant violent (Mercy of a Rude Stream – A Star Shines Over Mount Morris Park), 1994, Points Seuil 1997, 397 pages, €2,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

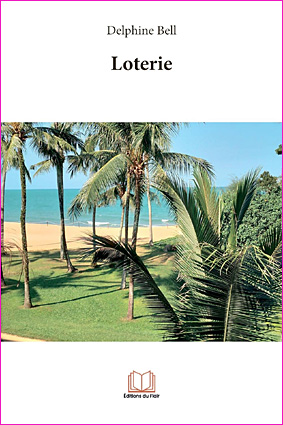
Commentaires récents