Le roi, c’est une métaphore. Celle du tout-puissant dont tous les désirs sont réalisés. On peut être « roi » en étant dieu adoré de la multitude, chef d’un royaume entouré de courtisans, patron reconnu et puissant, pater familias respecté et craint de tous, enfant-roi unique et désiré que l’on satisfait à satiété… Mais être « roi » finit par ennuyer. Quand tous les désirs sont satisfaits aussitôt que formulés, quel intérêt a la vie ?
« Il est bon d’avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route toute unie », dit Alain. Le désir est un aiguillon, et pas seulement sexuel. Désirer, c’est imaginer – ce qui est bien plus beau et plus gratifiant que posséder. D’où le post coïtum, animal triste que signalent les médecins antiques et les études modernes, ou la dépression post-partum que constatent les accoucheurs. « Lorsque l’on a les biens réels , on croit que tout est dit, et l’on s’assied au lieu de courir. Il y a deux richesses : celle qui laisse assis ennuie ; celle qui plaît est celle qui veut des projets encore et des travaux ». La puissance qui plaît est celle en action, car comment prouver sa puissance si l’on reste assis, content de soi ?
C’est ainsi que Poutine a tenté le sort, après un timide essai en Géorgie, un coup de force en Crimée, et une agression caractérisée en Ukraine. Lui se voulait puissant (ce qu’il n’est pas), il a voulu le prouver (et il s’est fait contrer par les plus petits que lui qu’il considérait comme des vassaux). De même le Bouffon yankee : signer une rafale de décrets, en dépit du droit et en piétinant amis et alliés, est pour lui une preuve de sa puissance (mais gare au retour de bâton). « Toutes les fois qu’il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette le sang et ravive le feu », écrit Alain. Si la presse d’opposition ne criait pas au scandale à chaque énoncé de Trump, il ne serait pas poussé sans cesse à la surenchère. C’est la faute des Démocrates américains, et avec eux de toute « la gauche » européenne, de dire « chiche » à tous ceux qui testent leur puissance. Les ignorer vaudrait mieux, en réaffirmant tranquillement ce à quoi on croit. Poutine, Trump, sont des égocentrés qui ne songent qu’au fric. Le Veau d’or est leur seul dieu, l’idéologie conservatrice, anti-Lumières, leur prétexte à conserver l’état des choses – donc leur pouvoir. Et seuls les niais voient le doigt au lieu de la lune.

Mais « qui voudrait jouer aux cartes sans risquer jamais de perdre ? » s’interroge Alain. Et de poursuivre en affirmant que les courtisans ont appris à perdre pour que le roi ne se mette pas en colère. Or on ne peut pas toujours gagner : le « deal », si cher au clown capitulard yankee, n’est qu’une façon d’écraser le faible et de se coucher devant le plus fort – en affirmant qu’on l’a expressément voulu. C’est « pour la paix », pour éviter la « Troisième guerre mondiale », et autres excuses de chapon dont la vanité ne supporterait pas un échec. Quand un Zelensky oppose carrément un « niet ! » aux exigences de Trump, le roi est nu, devant toute la télé. Il a beau éructer « vous êtes viré », on n’est pas dans un jeu : la géopolitique, ce sont des gens, des peuples, des pays. Pas un divertissement pour bateleur qui s’ennuie. Deal et royauté sont deux concepts antagonistes : le roi veut son désir absolu, le deal exige la négociation, donc des concessions réciproques. Le premier est autocrate, le second prépare à la démocratie. Mais le bateleur vaniteux n’a que faire de la démocratie, il veut l’adulation pure et simple.
Les petits rois sont éternels, égoïstes, narcissiques, centrés sur eux-même. Même trop bien servis, trop flattés, leurs désirs prévenus, ils ne sont pas satisfaits. « Eh bien, ces petits Jupiter voulaient malgré tout lancer la foudre ; ils inventaient des obstacles ; ils se forgeaient des désirs capricieux, changeaient comme un soleil de janvier, voulaient à tout prix vouloir, et tombaient de l’ennui dans l’extravagance. » C’est ainsi que raisonnait Alain en janvier 1908, mais l’on croirait qu’il parle d’aujourd’hui, de Trump le trompeur, le gros bébé exigeant, le bouffon yankee. Comme quoi les travers humains ne changent jamais.
Alain, Propos tome 1, Gallimard Pléiade 1956, 1370 pages, €70,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

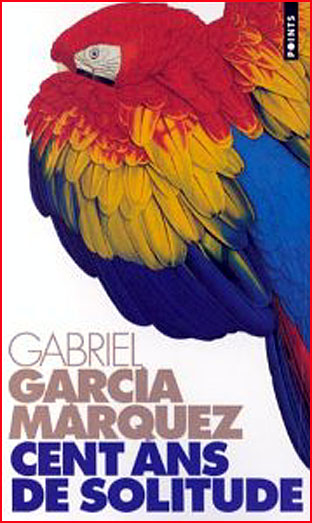
Commentaires récents