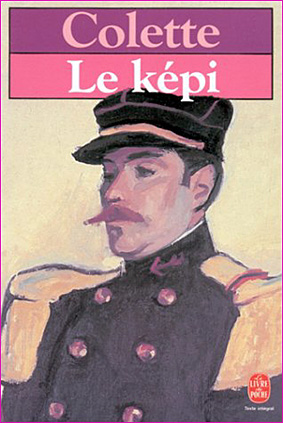
Ce sont quatre nouvelles sur « l’amour » décliné sous toutes ses formes, dont la première, Le képi, est la plus longue. Colette les a écrites ou remaniées sous l’Occupation pour s’occuper et pour « la croûte », et pré-publiées dans Candide en 1941 et 42. Quant à la publication en livre, elle fut « autorisée » par la « membresse » du Syndicat des éditeurs sous Pétain par une certaine… Marguerite Duras, qui s’appelait encore à l’époque Donnadieu. L’égérie de la gauche morale des années 80 et 90 fut bel et bien collabo (je n’ai jamais aimé Marguerite Duras et son hypocrisie de petite-bourgeoise).
Les textes de Colette sont toujours entremêlés de souvenirs mais la romancière tient à égarer les comparaisons et à cacher les personnages réels sous ceux de la fiction. Tous les écrivains ont agi ainsi, et c’est heureux. Inutile donc de chercher qui se cache derrière la femme mûre qui se trouve un jeune amant mais ne sait pas le garder, le vieux Monsieur qui s’égrillarde sur une nymphette, la veuve qui empoisonne la vie de son mari et de ses héritiers, ou la catherinette dépassée qui révèle enfin son amour pour son ami d’enfance trop emprunté.
Le Képi est l’histoire d’un ratage. Marco, la femme mûre, divorcée et solitaire, ne sait pas s’habiller, se croit finie. La narratrice de 25 ans en pleine fleur la prend sous son aile, la tutorise pour le maquillage et les vêtements, et l’encourage, avec un sien ami fort cynique, à répondre à une annonce d’un lieutenant de 25 ans qui cherche une « correspondante » (et plus si affinités). La femme qui pourrait être sa mère tombe amoureuse du jeune homme. C’est son premier amour véritable, une passion. Mais si elle peut masquer les apparences sous les apprêts, se croire le modèle idéal qu’elle rêve d’être, elle reste de son âge, c’est-à-dire flétrie déjà. Après l’un des multiples assauts amoureux du garçon, lorsque, nue, elle coiffe le képi de son amant, la déchéance se révèle avec le ridicule. Si un bibi peut mettre en valeur une tête, un képi de mâle tout droit et net, met en valeur la vérité de ce qui loge en-dessous. Fatale erreur, comme on dit dans l’informatique. L’illusion se dissipe d’un coup et l’amante égarée se voit peu à peu éloignée, jusqu’à la rupture – inévitable.
Le Tendron est l’histoire d’un autre ratage, mais inversé. C’est cette fois-ci un barbon qui s’éprend sensuellement d’une jeunette. Il a 49 ans, elle 15 à peine ; lui vient de la ville et se promène en costume, elle est paysanne dans le Doubs et va en corsage sans rien dessous. La maturité tombe amoureux de la jeunesse, ce qui est un classique de la nature, une dernière flamme de l’énergie vitale. « Auprès des créatures féminines très jeunes, je trouvais de la brusquerie sincère, un intérêt presque toujours affecté, la beauté en esquisse, le caractère en projets. Elles avaient 17, 18 ans, un peu plus, un peu moins, pendant que j’avançais, moi, vers la trentaine, et qu’à leur côté je croyais avoir le même âge qu’elles. A leur côté… Je peux dire plus véridiquement dans leurs bras. Qu’est-ce qu’il y a, dans une jeune fille, d’achevé, de prêt à servir, d’enthousiaste, sinon sa sensualité ? (…) Il faut avoir connu un certain nombre de jeunes filles pour savoir que, comparés aux femmes faites, la plupart d’entre elles sont des championnes du risque, des inspirées de l’espèce, et que dans des conjonctures dangereuses rien n’égale leur sérénité » p.356 Pléiade. Il ne se passera rien de décisif entre eux, aucune défloration (le pétainisme aurait censuré), mais seulement la sensualité du corsage ouvert, des caresses et des baisers. Tout cela dans le secret bien gardé des buissons – jusqu’à ce qu’une pluie violente un soir oblige les amoureux à se réfugier dans la maison, où la mère les découvre enlacés. Elle savait que cela devait arriver mais regrette moins la virginité (d’ailleurs conservée) de sa fille que l’écart des âges : cela ne se fait pas, un point c’est tout. Et le vieux barbon repart avec la queue entre les jambes tandis que la nymphette, émoustillée, l’a déjà oublié. La mère et la fille se révèlent deux femelles complices face aux mâles.
Dans La Cire verte, réalité et fiction se mêlent, un souvenir d’enfance de Colette et l’histoire imaginaire de la receveuse des postes qui a épousé un propriétaire. La Madame s’est employée à empoisonner son vieux mari et à faire disparaître son testament. Mais lorsque les héritiers le contestent devant notaire, elle prend peur et perd les pédales. Elle rédige elle-même un faux, d’une écriture qui n’est pas celle de son mari, et croit l’authentifier par des cachets de cire verte, dont elle a volé le pain sur la table de Colette tout juste adolescente, qui collectionnait la papeterie. Tout se révèle, la veuve avoue, l’absence d’amour dans le mariage et la basse avarice.
Armande est une grande jeune fille bourgeoise de province en passe de passer la limite de péremption avec ses 28 ans. Elle est amoureuse depuis l’enfance d’un jeune homme devenu médecin, Max, et qui est revenu dans la petite ville pour voir sa sœur, mariée au pharmacien, et prendre des médicaments pour son cabinet. Il revoit Armande, l’épouserait bien, mais n’a ni le temps de jouer au romantique, ni l’audace de se déclarer par les étapes nécessaires (conversations, billets doux, baiser, se revoir, etc.). Juste avant son départ définitif, il rend à contrecœur une visite de courtoisie à son ancienne camarade – et c’est là que le destin lui donne un coup de pouce. Le lustre du salon se détache et lui choit sur la tête, faisant s’évanouir le garçon et saigner son oreille. Armande alors se révèle, l’appelle dans son émoi « mon chéri », s’empresse à la compresse, appelle au secours, en bref le « sauve ». Même si, la bouche ouverte, elle est « laide », l’amour lave tout, l’émoi des sens submerge toute raison.
Une belle chute pour ce recueil.
Colette, Le képi (nouvelles), 1943, Livre de poche 1987, 158 pages, €4,79, e-book Kindle €4,99
Colette, Œuvres tome 4 (1940-54), Bibliothèque de la Pléiade 2001, 1589 pages, €76,00
Les œuvres de Colette déjà chroniquées sur ce blog

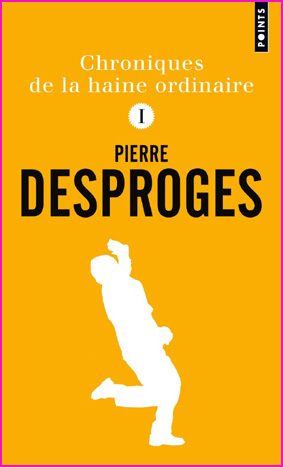
Commentaires récents