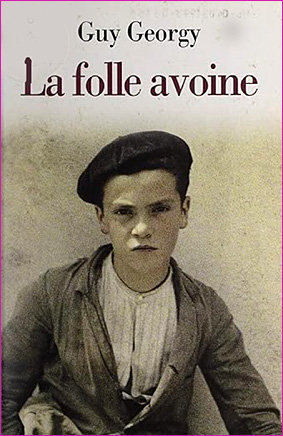
Guy Georgy est mort il y a tout juste vingt ans, il avait 84 ans. Dans ce livre de souvenirs d’enfance, il raconte comment il est devenu ambassadeur de France dans divers pays de 1959 à 1984 (Congo, Bolivie, Bénin, Libye de Khadafi, Iran de Khomeiny, Algérie), en passant en 1939 par la difficile École nationale de la France d’Outremer – un avatar de l’ENA qui n’existait pas encore.
Le petit Guy est orphelin très tôt, d’un père inconnu et d’une mère morte de la tuberculose à Paris, qui l’avait confié à sa grand-mère. Celle-ci l’a élevé à la ferme, une masure d’une seule pièce avec une cave aux brebis et un grenier à foin très bas, dans un hameau près de La Roque-Gageac en Dordogne. Le gamin vivait en sabots, vêtu de hardes rapiécées, mais il a été heureux. Sa grand-mère, avant son AVC lorsqu’il avait 12 ans, lui racontait les dictons du terroir, le diable et ses suppôts, les loups-garous, les sorciers. Elle était moqueuse et affublait les gens de sobriquets. Elle était chrétienne mais pas bigote, gardant de la païennerie campagnarde de région loin de tout. Lui apprenait de tout, à garder les oies et les brebis, à faire les foins et émonder la vigne.
Guy a été confié au curé dès six ans pour être enfant de chœur, mais c’est surtout son jeune instituteur IIIe République qui l’a poussé aux études, observant sa curiosité et sa vive intelligence. Guy Georgy, sorti de rien, est un parfait exemple de la méritocratie républicaine, à l’égal de Pompidou ou de Camus entre autres. Cette méritocratie est aujourd’hui en panne parce que la République ne croit plus en elle-même, saisie de doutes sur l’éducation des enfants (le pédagogisme), de culpabilité post-coloniale (le woke) et de métissage culturel accéléré (un tiers de la croissance démographique en France est désormais le fait d’enfants d’immigrés).
L’instituteur – celui qui fonde la connaissance – ne prétendait pas au titre ronflant de « professeur » des écoles – celui qui se croit spécialiste d’un savoir. Il avait pour tâche d’administrer la classe et d’intéresser les élèves aux curiosités de la culture : lire, écrire, compter, connaître. Il était plus concret qu’intello, créant par exemple au mur une affiche de mots croisés sur les dates historiques avec, à la rencontre des lignes et des colonnes figurant une date, le nom à retenir (ex. 15 en ligne et 15 en colonne = Marignan). Ou encore en instituant une correspondance hebdomadaire entre les élèves de deux écoles primaires appariés, leur faisant raconter le livre qu’ils étudiaient en cours – ce qui les incitait à lire, leur faisait comprendre en expliquant, les obligeait à écrire et à se faire comprendre correctement. Tout ce que les profs d’aujourd’hui ont délaissé : la lecture, la grammaire, l’orthographe, l’expression.
L’enfant s’éveille à la lecture et celle-ci compense, une fois au collège (obtenu grâce au concours des bourses), la relative solitude d’avoir quitté son terroir et ses copains des bois et des champs. Lire individualise, loin du collectif et de ses pressions. Le lecteur s’identifie aux personnages et vit avec eux des aventures. La multiplicité de ces expériences incite à penser par soi-même, à évaluer les situations, à découvrir des personnalités bien loin de celles qui vous entourent. A l’inverse, l’image et l’émotion omniprésentes sur les réseaux sociaux, où les textes sont remplacés par des émoticons, des onomatopées, voire des injures, désindividualisent. Ils resocialisent en bandes organisées d’entre-soi inconnus, conduisant à des comportements de foule sans plus aucune raison.
Au collège de Sarlat, la vie collective n’est pas facile, faute d’argent pour se payer le cinéma ou le petit train du retour le week-end, et le foot en sabots n’est pas fameux… Mais le jeune Guy est adaptable et convivial, il s’y fait et aime l’étude. Dès sa troisième accomplie, il est même sollicité pour donner des cours particuliers durant les vacances aux enfants d’une famille bourgeoise qui le paye bien. Une fois ses deux bacs et poche, il prépare le concours difficile de l’École nationale de la France d’Outremer, et sa mémoire affinée par les années scolaires lui permet de réussir. Il avait rêvé de l’Oubangui-Chari et d’exotisme depuis qu’il avait lu à 12 ans un mauvais roman d’aventures pour adultes.
Un beau livre de réussite sociale à donner en exemple à ceux qui se plaignent toujours d’être « victimes » – de bâtardise, de discriminations sociales, de matières trop « difficiles », de moyens, de profs pas assez exigeants… En bref : qui rejettent sur les autres, la société, le machisme, l’histoire coloniale leurs propres insuffisances et leur paresse.
Guy Georgy, La folle avoine, J’ai lu 1993, 317 pages, occasion €1,17, e-book Kindle €7,99

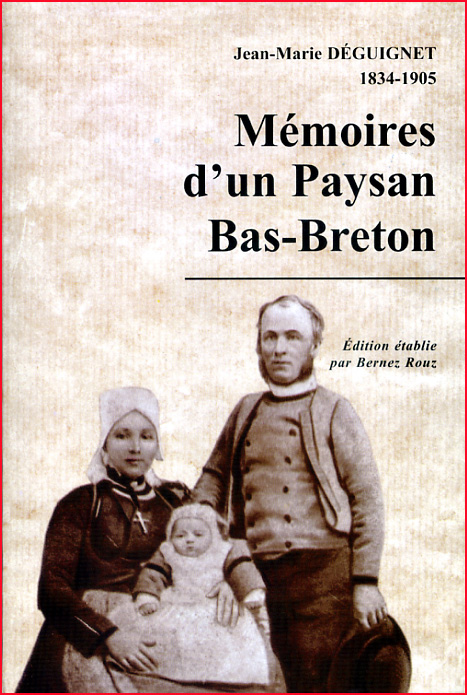
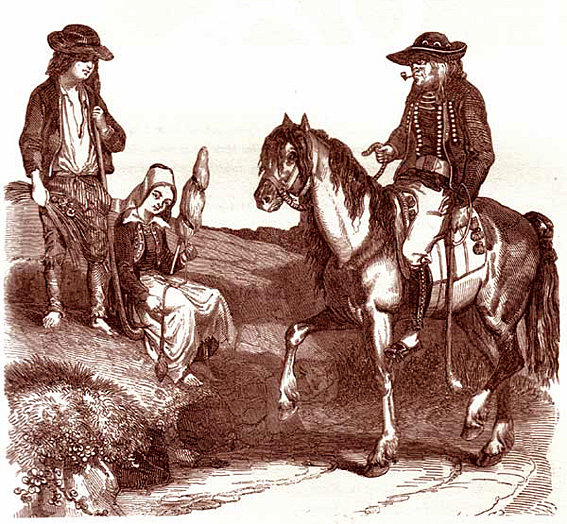
Commentaires récents