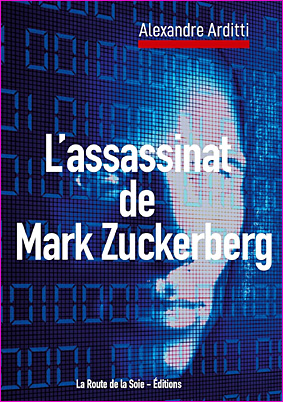
Témoin d’époque, l’auteur frappe un grand coup. Le confinement Covid l’a fait réfléchir sur la société comme elle va dans un premier roman, La conversation, sur les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place, sur la technique qui étend son emprise sur l’humain. Les responsables ? Les patrons des GAFAM (Google, Apple, Amazon et Microsoft) et autres BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), ces multinationales technologiques et de réseau.
Dès la page 13, Mark Elliot Zuckerberg, l’un des fondateurs de Facebook et désormais propriétaire aussi d’Instagram, de WhatsApp, Messenger et Threads, est exécuté d’une balle dans la tête. Facebook, nommé au départ Facemash, autrement dit « fesses-book » qui permettait de noter les appréciations sur les étudiants et étudiantes les plus sexy à la fac, est devenu un réseau social mondial et rentable renommé Meta Platforms. Zuckerberg n’en possède que 13 % des parts mais en contrôle 60 %, le reste étant coté en bourse et partiellement aux mains d’investisseurs institutionnels.
Il envisage de développer la blockchain pour la monnaie, l’épargne et les paiements, les lunettes connectées qui filment à votre insu, le Metavers qui est un univers parallèle, et l’IA pour capter et faire fructifier les données des utilisateurs. Autrement dit, Mark Elliot Zuckerberg est « le » prédateur du futur, le Big Brother d’Orwell dans 1984. Le fait qu’il soit juif, capitaliste et américain n’est pas mentionné par l’auteur, bien que cela participe du « Complot » mondial dont les défiants sont habituellement férus.

A la page 18, d’autres crimes sont évoqués sur les patrons d’Amazon, d’Apple, de Microsoft, et même de l’ex-président Trump, de même que sur Merkel, Sandrine Rousseau (après tortures, l’auteur se venge-t-il symboliquement ?), et divers attentats contre d’anciens dirigeants comme Sarkozy ou Hollande. Au total, près d’une centaine.
Le meurtrier de Zuckerberg est arrêté assez vite à Paris, dans le palace où il se prélasse, son forfait accompli. Le commissaire Gerbier, usé et fatigué après des décennies de crimes et d’enquêtes dans une société qui pourrit par la tête, est chargé comme meilleur professionnel du 36, de l’interroger. Il a en face de lui un homme de son âge, qui avoue appartenir à un réseau terroriste pour éradiquer l’emprise technologique sur les humains : Table rase.
Il y a peu d’action mais beaucoup de conversation. La soirée puis la nuit passent à deviser afin de savoir pourquoi on a tué, et qui est impliqué. Le pourquoi devient limpide : c’est une critique en règle de l’ultra-modernité : les réseaux qui abêtissent, la moraline du woke qui censure et inhibe, l’IA qui formate peu à peu et réduit l’intelligence humaine. La société hyperconnectée est nocive : il est bon d‘être réactionnaire envers elle !
Premier argument du terroriste : le complot serait général, pour mieux dominer les populations, intellos compris (souvent très moutonniers) : « Vous savez, la meilleure façon de contrôler la pensée d’une population est simplement qu’elle n’en ait pas. Noyer sa réflexion et son attention dans un flot continu d’informations stupides – ou commerciales , ce qui revient à peu près au même – est un excellent moyen d’y parvenir. Limiter l’esprit humain est aujourd’hui devenu un véritable programme politique. Plus le peuple sera ignorant et occupé à des futilités, plus il sera facilement contrôlable » p.53. Sauf que l’on pourrait objecter que les États-Unis ou la France ne sont ni la Russie, ni la Chine, ni l’Iran et que le « contrôle social total » reste un fantasme de défiant complotiste. Nul n’est obligé de suivre les errements des réseaux, des chaînes d’info et de la violence radicale.
Second argument : c’est le capitalisme qui est en cause : « Une société dont l’économie ne survit qu’en générant des besoins artificiels, avec pour objectif d’écouler des produits dont la plupart sont inutiles voire nocifs pour la population comme pour la planète, ne me paraît pas digne de survie à long terme » p.57. Mais quel est le « long terme » ? Pour Michel Onfray comme pour quelques autres, le « capitalisme » est né dès le néolithique ou même dès la première société humaine qui produit et stocke pour échanger… D’autre par, le « capitalisme » est un outil économique, une technique d’efficacité diablement efficace : même la Chine « communiste » s’y est convertie avec la réussite qu’on lui connaît, au contraire de l’archaïque mentalité russe, dont l’économie et la prospérité stagnent.
Troisième argument, anthropologique, vers le Soushomme, l’abêtissement général dans le futile, le tendance et l’autocensure pour ne pas offenser : « Passer d’un mode de vie résolument ancré dans le réel à des relations essentiellement virtuelles et souvent, ne nous voilons pas la face, purement mercantiles, est forcément contre-nature. Les réseaux sociaux incarnent ainsi la caricature la plus vide de sens de notre époque. (…) La mise en scène de toutes choses relève aujourd’hui d’un phénomène de cirque, servi par la consommation instantanée et ininterrompue d’informations sans aucun intérêt. A ce stade, ce n’est plus un appauvrissement, c’est une désertification intellectuelle et une raréfaction glaçante des relations sociales… » p.77. Nietzsche appelait à la volonté pour aller vers une sur-humanité ; la technologie, comme Heidegger le disait, ramène plutôt l’humain vers la sous-humanité de bête à l’étable qui regarde passer les trains.
Quatrième argument, l’effritement des relations sociales sous les coups de la victimisation, du buzz et du woke et la remise en cause de la démocratie sous les coups de force des gueulants : « Désormais, pour exister, au moins médiatiquement parlant, il faut absolument revendiquer quelque chose, protester. S’en prendre à quelqu’un, faire valoir ses traumatismes, bref être une victime, peu importe de qui ou de quoi. Dis-moi ce que tu revendiques, je te dirai qui tu es ! (…) Mon propos est de dénoncer une atmosphère délétère qui déteint sur tous les pans de la société, et entrave sérieusement la liberté d’expression en suscitant des phénomènes d’autocensure particulièrement inquiétants. Un travers en grande partie dû à l’amplification médiatique du moindre fait divers et de la moindre déclaration sortie de son contexte par les chaînes d’information continue, et bien sûr par les réseaux sociaux. (…) Les fondamentaux démocratiques de la société sont désormais pris en otage par quelques tristes sires qui les dévoient de manière éhontée pour leur usage personnel, et surtout pour se faire de la publicité à moindre frais » 103. On pense à la Springora et à la Kathya de Brinon – entre autres. Mais doit-on les croire sans esprit critique ? Leur force médiatique tient surtout à la lâcheté de ceux qui sont complaisants avec leurs fantasmes et leurs approximations.
Habilement, sous forme d’un interrogatoire policier, l’auteur reprend les critiques les plus usuelles sur les méfaits de la technique et le mauvais usage des outils, comme sur l’abandon de ceux qui sont chargés de transmettre : les parents, les profs, l’administration, les intellos, les journalistes, la justice, les politiques. Ils ne sauvegardent pas l’humanité en laissant advenir par inertie « un transhumanisme sauvage » p.142.
En cause l’éducation et la famille, dont l’auteur ne parle guère. Je pense pour ma part que l’habitude viendra d’user mieux de ces choses, qui sont aujourd’hui beaucoup des gadgets à la mode dont on peut se passer (ainsi Facebook ou Instagram), ou qui font peur aux ignorants qui ne savent pas s’en servir. Je l’ai vécu avec le téléphone mobile : l’anarchie et l’impolitesse des débuts a laissé place à des usages plus soucieux des autres. Quant aux réseaux, les cons resteront toujours les cons, quels que soient les outils de communication, et il faut soit les dézinguer à boulets rouges s’ils vous attaquent, soit les ignorer superbement. Le chien aboie, la caravane passe.
Ce roman policier un peu bavard, aux dialogues, parfois réduits à un échange de courtes interjections comme au ping-pong, pose la question cruciale de notre temps : que voulons-nous devenir ? Il se lit bien et n’échappe pas à un double coup de théâtre final fort satisfaisant. Clin d’œil, l’auteur est lui-même sur Facebook.
Alexandre Arditti, L’assassinat de Mark Zuckerberg, 2024, éditions La route de la soie, 146 pages, €17,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)


Commentaires récents