Henry de Montherlant est un auteur injustement oublié, disparu en 1972. Il se voulait artiste libre, dans une époque matérialiste où seul l’engagement partisan comptait. L’honneur, remis à l’honneur par la Résistance, s’est vite dilué dans les malversations politicardes de la République Quatrième. Montherlant avait honte de la France, comme beaucoup, et son tort aux yeux des envieux est de l’avoir dit avec talent. Notamment dans une pièce, ‘Le Maître de Santiago’.
La neige recouvre Avila de sa pureté, de sa blancheur immaculée. Nous sommes en 1519 au cœur des montagnes de Vieille Castille. Ce n’est que dans le silence et le recueillement ralenti de l’hiver que germent les graines et mûrissent les choses. La mante de l’ordre de Santiago a la couleur de la neige comme une chape qui incite au regard intérieur, au feu sous la glace. La pureté est ce fantasme de perfection qui habite les corps vils : l’absolu contre l’éphémère, l’éthéré contre la pourriture, la probité et la lumière contre les mensonges et les illusions de l’apparence. La pureté du chevalier refuse la corruption de la chair et de l’âme, la compromission avec le siècle et les intérêts. Quand les chevaliers de l’Ordre demandent à don Alvaro de partir avec eux aux Indes (les Amériques), où il gagnera une dot pour sa fille, il refuse net. On lui fait croire alors que le roi le veut.
Don Alvaro a combattu pour le Christ roi et pour l’Espagne. La vieillesse approchant, il n’a ni la même vigueur ni la même foi. Il s’enkyste dans son Ordre, dédaigne le monde où le péril s’éloigne, où la foi se compromet, où la patrie catholique se dilue. Il n’aspire plus qu’au Salut, à faire une « belle mort », une fin qui proclame sa foi en Christ et son attachement féodal à l’Ordre. Il est la statue du Commandeur de cette pureté-là.
Sa fille Marianna est un reflet de lui-même mais qui va plus loin, plus audacieusement, elle le dépasse par le sacrifice de sa vie entière et surtout de sa jeunesse précieuse qui ne reviendra pas. Elle dénonce en effet la supercherie : le roi ne veut rien, elle renonce de fait à se marier. Don Alvaro a vécu avant de se retirer du monde, pas Marianna. Son père « l’élève » comme un père spirituel plutôt que charnel, l’aspire vers les hauteurs. Mais la fille dépasse le père parce qu’elle est pure, sans aucune des taches du monde qui constellent l’âme d’Alvaro. Sa jeunesse la rend fanatique en tout, donc au renoncement puisque c’est de cela qu’il s’agit. Ce qui est chez le père dégoût du médiocre par comparaison, fatigue du compromis inhérent à l’existence mêlée aux autres, en bref refus – est chez la fille adhésion première, innocence du sacrifice, en bref volonté. Le père fuit dans l’idéal, la fille agit d’un premier mouvement ; lui se réfugie, elle déborde ; lui est repli, égoïste pour l’image qu’il se fait de lui-même ; elle est générosité, amour pour les autres, à commencer par ses plus proches. La grâce peut-elle s’acquérir ? Est-elle un don ? Que valent les Grands Principes de la Morale face aux mouvements spontanément sains d’une âme ?
Don Alvaro représente l’idéal chrétien qui refuse l’ici-bas pour se modeler sur l’au-delà, l’humain appelé au surhumain, le naturel dédaigné pour le surnaturel. Or l’absolu n’est pas de ce monde, l’éternel ne peut composer avec le temps, les humains ne sont pas Dieu. Le Commandeur est la figure du tragique, le roc qui tente de figer le Devoir dans l’existence. Non sans le narcissisme d’admirer sa propre intransigeance et d’y lire sa vertu dans le regard des autres. Est-ce vraiment cela, être chrétien ? Montherlant en doute, dans sa préface à la pièce, mais il est partagé. « Les valeurs nobles, à la fin, sont toujours vaincues. » Lucidité mais pas cynisme : est-ce parce que le combat est sans espoir qu’il ne faut point le tenir ? Est-ce parce les valeurs sont écrasées qu’il faut se ranger du côté du plus fort, de qui gagne – de l’ignoble ?
Don Bernal représente le réalisme, l’opposé de Don Alvaro. Il est le relatif contre l’absolu, l’impur contre le pur, mais aussi l’humain contre la prétention au divin. Nous sommes faits des ombres de la terre, pas de la lumière des dieux. Notre monde est relatif et tout bien a son mal, revers collé à lui comme le yin au yang. Choisir l’Idée contre le Réel, c’est ne vivre qu’à moitié, ne voir que partiellement le monde, n’exister que bancal. Don Bernal s’attache au monde et aux êtres tels qu’ils sont. Il révère la pureté, mais comme idéal inaccessible en ce monde. Il ne dédaigne pas de vivre. Cet homme pleinement humain, pétri de contradictions, ne peut exister que dans leur alternance, thème libéral cher à Montherlant.
La pièce met donc en scène la contradiction flagrante de toute foi (même laïque), ici du christianisme dans sa version rigide catholique, figurée par l’Ordre monastique espagnol. Y a-t-il plus grande rigueur morale que dans un ordre espagnol du 16ème siècle ? Plus grande exigence de pureté que dans ce pays composé de Maures et de Juifs que la couronne de Castille n’a cessé de vouloir convertir à la Vraie Foi via cet Ordre de Santiago qui veut reconquérir et protéger le tombeau de saint Jacques ? D’où le soupçon sans cesse présent d’hérésie, d’idées étrangères à la vérité apostolique, de compromissions avec le siècle bigarré et cosmopolite tel qu’il est.
Montherlant est lui-même à la fois dans Alvaro et dans Bernal, il est son propre enfant dans Marianna, il est de son époque coincée entre grands principes issus de la Résistance au totalitarisme – et les compromissions du siècle de la République Quatrième. Par ces personnages divers, il incarne ses contradictions propres, humaines trop humaines : son aspiration à la pureté de la discipline, mais sa aussi méfiance envers l’orgueil égoïste de qui se croit plus moral que les autres ; son attirance pour la bigarrure des êtres, mais son doute sur leur bonté intrinsèque ; sa lucidité sur le monde, mais son désir de beauté et de grandeur. Il s’interroge sur la grâce, acquise par ses mérites ou accordée par don de Dieu. L’eau d’Avila coule sur le père sous forme de neige blanche comme le manteau de l’Ordre dont il s’est recouvert, froide comme la morale et comme les pierres du monastère ; l’eau d’Avila tirée du puits coule dans la gorge de la fille comme une boisson régénératrice, elle est source, elle donne la vie, elle est parfaite et transparente comme l’Esprit. Où est le Vrai ?
L’absolu est figé puisqu’il est parfait. L’homme qui se croit pur se couvre d’une armure qui le contraint. Ce n’est plus lui mais le Devoir, la Morale, l’Ordre qui agit par sa tête et ses membres. Il est rigide, froid, impérieux. Il n’a plus rien d’humain. Sans doute est-il déjà mort à cette terre tout en subsistant encore par la grâce de Dieu qui le donne en exemple. Est-ce ainsi qu’il faut vivre ? Cette mort à la terre, réclamée par l’idéal catholique, est-ce la vie ? Le but tout entier d’une existence est-elle de se figer en impératif moral pour obéir dès ici-bas à cet au-delà promis (mais qui n’est que pari), craint (mais qui n’est que fumée) et repoussé au trop tard de la vie évanouie ? Est-ce ainsi qu’il faut comprendre ce « Viva la muerte » de la Phalange espagnole : comme un aboutissement de siècles de catholicisme intègre ? Ou ces camps nazis et soviétiques, au nom de l’homme nouveau, racialement pur ou sociologiquement rééduqué ? Ou encore ces damnés de l’islam, qui confondent Sheitan avec Allah en égorgeant leurs frères, en massacrant femmes et enfants non croyants ?
L’exemple de Marianna, qui vit la grâce de l’intérieur est d’autre sorte. Elle est vivante et a soif d’absolu. Va-t-elle au compromis avec les autres et avec le siècle ? Vivra-t-elle une vie admirable ? Le catholicisme peut vivre, mais de lui-même, pas par la contrainte morale. Il est source et jeunesse, pas armure ni père fouettard. Ce pourquoi Marianna est peut-être plus chrétienne qu’Alvaro.
Écrite en 1947, la pièce renouvelle dans l’actualité cet éternel conflit moral. L’Espagne mise en scène sous l’occupation des Maures, c’est la France occupée par les Nazis – et la France de l’avenir dite par le prénom de sa fille, Marianna – Marianne. La Reconquista des chevaliers est la résistance qui s’élève des gens sains du peuple. Le pays une fois libéré, la corruption renaît, le pouvoir pour avoir l’argent et non plus l’argent pour avoir le pouvoir. Les tirades sur les colonies qui corrompent disent, via le passé espagnol, combien les affaires d’Algérie et du Maroc corrompent la France de ces années-là. Tout comme l’Irak a corrompu l’Amérique de Bush et nos palinodies sur l’islamisme corrompent notre idéal républicain.
Au débat de la patrie à l’occupant, des intérêts à la morale, se superpose dans ‘Le Maître de Santiago’ un conflit parent-enfant, morale ou grâce, voire homme et femme. Selon les préjugés d’époque l’homme, à l’intelligence architecte, rechercherait l’élévation spirituelle tandis que la femme, à l’intelligence intuitive, serait plus artiste et terre à terre. Montherlant, on le voit, ne choisit pas, toujours du côté de la jeunesse mais avec le regard de l’âge mûr.
Questions d’époque, questions de toutes époques. Celles de la nôtre aussi.
Henry de Montherlant, Le Maître de Santiago, 1947, Folio 1972, 156 pages, €1.48
DVD Le maître de Santiago, pièce de théâtre (Comédie française) avec Michel Etcheverry, Ludmila Mikaël, Jacques Eyser, 2012, éditions Montparnasse, €17.00
Henry de Montherlant, Théâtre, Gallimard Pléiade 1955, 1472 pages, €49.50
Montherlant sur ce blog (citations et chroniques)

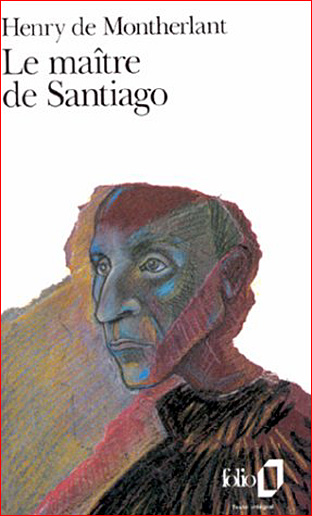
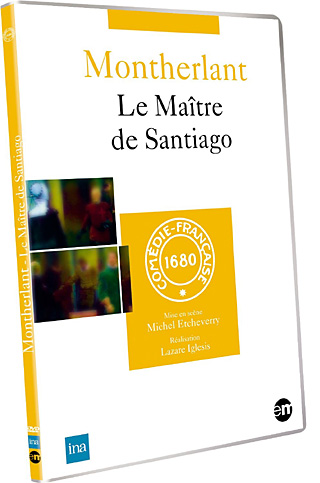
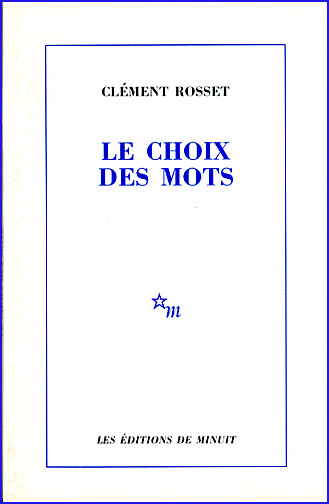
Commentaires récents