Dans la quatrième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche, qui a fait la démonstration de sa pensée tout au long, résume ce qu’il veut dire. A la suite de « la Cène » du chapitre précédent qui a réuni les disciples, il évoque « l’homme* supérieur » en vingt points.

- Tout d’abord, ne pas se présenter sur la place publique, car la populace ne comprend pas qu’un homme* prône le supérieur. Chacun veut être égal, comme « Dieu » l’a voulu.
- Or « Dieu est mort » et l’homme* peut enfin songer à être autre chose qu’un sujet figé, réduit à Son image et forcé d’obéir à ses Commandements sous peine de feu éternel. C’est l’époque du « grand midi », où l’homme* devient son propre maître.
- Surmonter l’humain est le grand œuvre. Il ne s’agit surtout pas de « conserver l’homme* » mais de le rendre meilleur et plus grand. Il faut « mépriser » l’homme* tel qu’il est, « petite gens » résigné, modeste, prudent.
- Il faut le courage du solitaire, du « cœur », pour accomplir le Surhomme*.
- Pour cela, accepter d’être « méchant », car c’est faire violence aux petites gens que de remettre en cause leur paresse et leurs habitudes. « Il faut que l’homme* devienne meilleur et plus méchant ». Ce n’est pas vice, ni sadisme, mais secouer pour élever, comme le font les éducateurs.
- Pas de gourou pour les hésitants et les faibles en énergie : il faut l’épreuve pour grandir. Peu de disciples, la voie n’est pas celle du grand nombre, ni pour un résultat immédiat. Il s’agit de préparer l’avenir. « Mon esprit et mon désir vont au petit nombre, aux choses longues et lointaines ».
- La sagesse prophétique de Zarathoustra n’est pas lumière, mais foudre ; elle doit aveugler d’évidence comme le trait d’Apollon, pas convaincre lentement comme la raison.
- « Ne veuillez rien qui soit au-dessus de vos forces : il y a une mauvaise fausseté chez ceux qui veulent au-dessus de leurs forces ». Ainsi ceux qui idéalisent le héros – sans jamais pouvoir en devenir un. Cela donne des comédiens, des faux, des hypocrites – des politiciens.
- Soyez méfiants « et tenez secrètes vos raisons » car l’aujourd’hui appartient à la populace, qui « ne sait ce qui est grand, ni ce qui est petit, ni ce qui est droit ou honnête. » Ce sont des « gestes » que veut la populace, pas des arguments, car la foule ne raisonne pas, elle résonne en rythme et en imitation, tous les politiciens le savent, qui braillent devant elle. « Ce que la populace a appris à croire sans raisons, qui pourrait le renverser auprès d’elle par des raisons ? » Car la raison n’est pas tout, n’est-ce pas ? Et les savants, qui en font métier, « ont des yeux froids et secs », « ils sont stériles » car « l’absence de fièvre est bien loin d’être de la connaissance ! » Qu’en est-il en effet des désirs (mis sous le tapis) et des passions (rejetées comme ineptes) ? C’est ainsi que la raison peut délirer : on l’a vu dans la finance comme dans la gestion de l’hôpital ou des entreprises. Le rationnel n’est pas le réel, même si le réel est rationnel. Le réel doit être compris par les instincts, les passions et la, raison, les trois de concert comme le dit Kahneman.
- L’homme* supérieur qui veut monter plus haut doit se servir de ses propres forces, pas s’asseoir « sur le dos et sur le chef d’autrui ».
- Ce que vous créez est pour vous et pas « pour votre prochain ». Ainsi « une femme n’est enceinte que de son propre enfant ». On ne crée pas « pour », ni « à cause de », mais par énergie vitale, par « amour ». « Votre œuvre, votre volonté, c’est là votre « prochain ». »
- Aucune création n’est pure, voyez l’enfantement ; elle rend malade, fait souffrir. Il faut en être conscient.
- « Ne soyez pas vertueux au-delà de vos forces ! Et n’exigez de vous-mêmes rien qui soit invraisemblable. Marchez sur les traces où déjà la vertu de vos pères a marché ». Nul n’est seul, mais dans une lignée. « Et là où furent les vices de vos pères, vous ne devez pas chercher la sainteté. » Quant à la solitude, elle « grandit ce que chacun y apporte, même la bête intérieure. (…) Y a-t-il eu jusqu’à présent sur la terre quelque chose de plus impur qu’un saint du désert ? Autour de pareils êtres le diable n’était pas seul à être déchaîné – il y avait aussi le cochon. » Bouddha n’a pas dit autre chose, lorsqu’il a renoncé à rester renonçant et a décider d’enseigner la Voie à des disciples choisis.
- Cette voie n’est pas facile et chacun sera « timide, honteux, maladroit », mais que vous importe ? Il faut « jouer et narguer » car « ne sommes-nous pas toujours assis à une grande table de moquerie et de jeu » ?
- Réussir n’est pas donné car « plus une chose est rare dans son genre, plus est rare sa réussite ». Mais tout reste possible, gardez courage. Riez de vous-mêmes. « Et en vérité, combien de choses ont déjà réussi ! » Ces petites choses « bonnes et parfaites » encouragent et réjouissent.
- Car le rire n’est pas « le plus grand péché », comme dit le Christ qui voue au malheur ceux qui rient ici bas, mais au contraire la voie vers l’amour, la grandeur, la tolérance. « Tout grand amour ne veut pas l’amour : il veut davantage ».
- La rigidité, le sérieux, l’obsession, ne font pas un tempérament tourné vers le mieux. « Je ne suis point devenu une statue, et je ne me tiens pas encore là, rigide, engourdi, pétrifié telle une colonne ; j’aime la course rapide. » Il faut les pieds légers du danseur.
- Votre exemple à imiter selon vous-mêmes : « Zarathoustra le devin, Zarathoustra le rieur, ni impatient, ni absolu, quelqu’un qui aime les bonds et les écarts ». Car tout ce qui est bon ne survient que brusquement, après des détours.
- Soyez légers ! Des pieds, du cœur, de la tête. « Mieux que cela : sachez aussi vous tenir sur la tête ! » Autrement dit renverser la raison quand elle est trop raisonnante, trop sèche, portée au délire rationaliste, et l’irriguer d’instincts et de passions, comme on renverse un sablier. Marx a renversé la dialectique de Hegel, il faut aussi renverser la dialectique de Marx devenue opium des intellectuels, et d’autres, car nulle idole ne saurait rester statufiée. « Mieux vaut danser lourdement que marcher comme un boiteux ».
- « Loué soit cet esprit de tempête, sauvage, bon et libre, qui danse sur les marécages et les tristesses comme sur les prairies ». « J’ai canonisé le rire ; hommes* supérieurs, apprenez donc à rire ! » Rire, ce n’est pas se moquer (ironie) mais aimer (humour), c’est déborder d’énergie pour englober ce qui va et ce qui ne va pas pour dépasser le tout.
Nietzsche se veut comme Bouddha, fondateur non pas d’une religion mais d’une Voie individuelle de salut. Le bouddhisme conduit à se dissoudre dans le grand Tout, dans cet état appelé nirvana, tandis que Nietzsche ne croit pas à cette dissolution, qu’il appelle nihilisme. Lui veut un chemin vers le supérieur, vers la Surhumanité, vers l’avenir de l’espèce. Ce pourquoi sa voie est réservée à une élite de courageux aux désirs jeunes, aux passions légères, à la raison pratique, qui savent danser dans les épreuves et rire des difficultés. Cette élite est celle des « hommes* supérieurs » ; elle n’est pas encore Surhomme* – qui n’est que d’avenir.
* Il va de soi que le mot « homme » s’adresse aux divers sexes, et pas seulement au mâle blanc dominateur, etc. L’ignorance ambiante si satisfaite d’elle-même exige hélas une telle précision.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

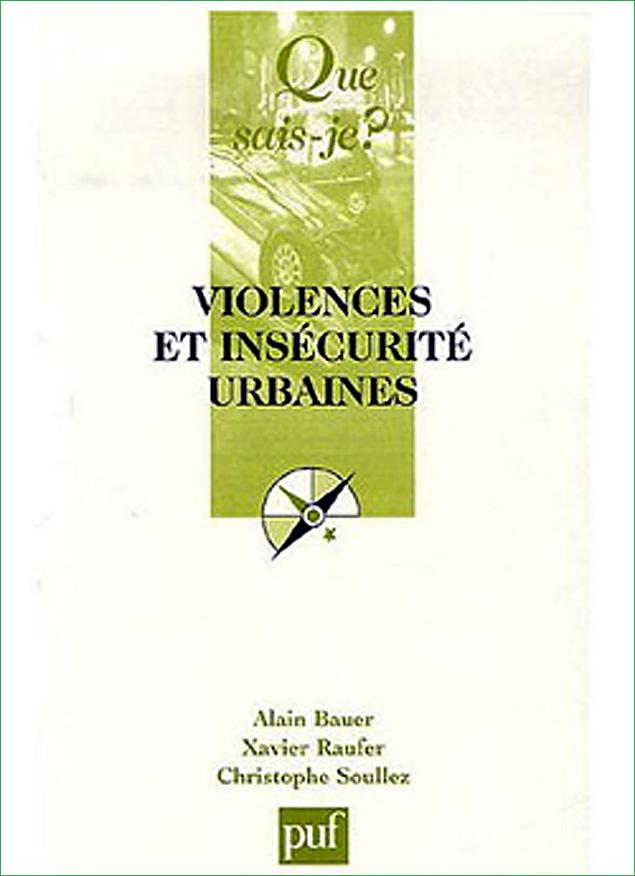
Commentaires récents