
Cinq nouvelles dont le décor est l’Italie et le thème l’amour. Avec toutes ses variations, ses permutations, ses désillusions.
Le thé sous les cyprès invite Alma, vieille fille auprès de son papa octogénaire expert en art, à rencontrer Jennifer, la fille d’une amie de son père, et son fiancé Sandro. Un bel Italien dont elle a connu le père, au point de presque se fiancer avec lui. Et puis… la vie l’a reprise et elle est restée vierge. Devant le jeune homme, resplendissant de jeunesse sous sa chemise blanche fluide, elle en a une pointe de regret. Il ressemble tant à son géniteur, Alma songe qu’il pourrait aussi être son fils. Rien de cela n’a eu lieu. Malgré tout, il faut imaginer Alma heureuse, comme Sisyphe.
Pierre et sa femme Yvette visitent enfin Venise, la quarantaine venue et l’aisance enfin conquise. La ville aurait pu être leur voyage de noce, mais ils n’avaient pas d’argent. Ils ont emmené les enfants, deux échalas contestataires de la période 68, cheveux longs, chemise à fleur et dénonciation de l’impérialisme américain et bourgeois sous le moindre prétexte. Pour les jeunes, le garçon en fac de philo et la fille en terminale, Venise est surfaite, même si l’on trouve à acheter – pas cher – des fringues et des bijoux à la mode. Ils critiquent la société de consommation, les gens, les restaurants, les touristes, eux qui ne sont encore que fils et fille à papa. Lequel, bourgeois promu, s’est fait tout seul dans un commerce de vins à Paris dont le fils aîné, 19 ans, a honte devant ses copains hippies du XVIe. Les jeunes en 68 ne sont pas exempts de contradictions, et l’auteur se plaît à s’en moquer gentiment. Ils seront les néo-bourgeois des années socialistes, sous Mitterrand, et leur « rébellion » n’aura duré que le temps de leur excès d’hormones. Mais les parents en souffrent, leur amour filial en est blessé. Au point que le cœur de Pierre entre en crise.
Un jeune Américain, études terminées, fait un grand tour en Europe. James Hoggarty IV est beau, riche, éduqué, issu d’une famille de Pionniers qui a réussi à bâtir une fortune. Il est snob et n’aime rien que se faire valoir, ni personne que lui-même. Ses aventures sentimentales ne sont que superficielles, comme les Yankees savent le vivre, « amis » sans se mouiller, prédateurs sexuels sans s’engager. Cela ne va pas sans crises de dépressions profondes, mais passagères, comme si l’inconscient savait le vide de sa vie. « Ces jeunes gars de la haute, bourrés de fric, qui ont l’air de posséder le monde. – Ils finissent par être possédés ». Ado prolongé jusqu’à la quarantaine, vieux beau qui se force à rajeunir par gymnastique, esthétique et cosmétiques après, vieillard précoce des noces qu’ils font. Ils cherchent l’amour sans jamais le trouver car ils ne s’investissent jamais dans l’autre mais préfèrent l’adulation de miroirs. L’âge venant, les aventures deviendront de plus en plus intéressées. L’amour de soi n’est pas l’amour.
Aldo, le macho italien marié, deux grands enfants, des petits-enfants, vit sa crise de la cinquantaine à Capri avec une jeunette pleine de vie. Il s’accroche bec et ongles à sa jeunesse, sans accepter le temps qui passe ni les siens à accompagner. Il est jaloux des beaux mâles de la marina, jeunes, trapus, athlétiques, tel ce batelier en seul jean qui rame pour eux vers la grotte azurée, puis se baigne nu dans l’eau transparente pour les reflets qu’il donne à ses muscles. Au retour, il ne peut donc s’empêcher de sermonner Sylvana en nuisette transparente, jusqu’à la crise inévitable : elle le quitte. Amour impossible, qui ne tient que par la chair, sans envisager l’âme. Tout comme ces jeunes gars du Midi, dont il voit un spécimen avec un vieil industriel de sa connaissance : « tout leur est bon. Tantôt pour les sous, tantôt pour le plaisir, et de préférence pour les deux ensemble. Rien ne les arrête. » Aldo aussi ne voit de Sylvana que son corps à admirer, à étreindre, pas sa personne. « Elle rayonnait le bonheur de vivre ; il savait que c’était cette vertu, en elle, son infatigable vitalité, qui le subjuguait. Peut-être valait-il la peine de souffrir un peu, si la souffrance était compensée par le bonheur de voir vivre près de soi une créature si revigorante, et de vivre dans la capiteuse irradiation de sa jeunesse. »

L’éphèbe de Subiaco est une statue sans tête de jeune garçon au bord de la puberté, découverte dans une villa de Néron à Subiaco, exposée au Musée national des Thermes à Rome. C’est aussi un jeune homme de 21 ans originaire de Subiaco, Luigino, qui vient la voir à sa descente du train, et que rencontre Minna, allemande de 38 ans habitant Rome, où elle donne des cours de langue. L’éphèbe orphelin, placé à 12 ans comme valet de ferme, est à peine dégrossi par le service militaire et elle se prend pour lui d’une affection quasi maternelle. Elle l’habille, le finance, l’éduque, en fait son amant mais s’efface vite devant ses maîtresses que sa jeunesse attire. Dont Rosemary, une jeune Américaine qui l’épuise, exigeant le coït plusieurs fois par jour et par nuit. Elle lui a promis de l’épouser, mais il ne tiendra pas sur la durée ; ce qu’elle veut, cette puritaine émancipée par les années soixante, est un gros vit qui la fasse jouir, pas un mari avec qui faire sa vie. Minna le pressent et, lorsqu’elle la rencontre à un cocktail d’Ursula, une amie peintre, elle le sait. L’amour n’est pas le sexe, la jeunesse ne le sait pas assez. L’amour est l’attachement, auquel le sexe contribue en ses jeunes années, mais qui se construit sur la durée. Il est plus proche de son amitié pour Ursula, à qui elle veut acheter une œuvre, que de l’obsession sexuelle intéressée de Rosemary.
L’éphèbe de Subiaco a donné un film, Chère Louise, avec Jeanne Moreau, réalisé par Philippe de Broca et sorti en 1972 (pas de DVD référencé).
Jean-Louis Curtis, Le thé sous les cyprès (nouvelles), 1969, J’ai lu 1972, 307 pages, occasion €5,84
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les livres de Jean-Louis Curtis déjà chroniqués sur ce blog


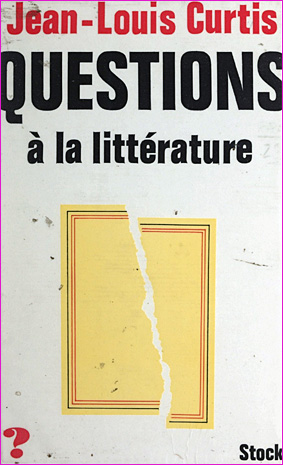
Commentaires récents