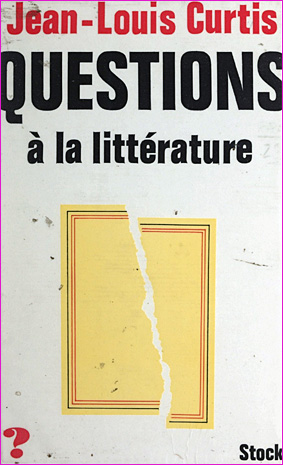
Une réflexion juste après Mai 68 sur « la littérature » en cinq points : Pourquoi écrit-on ? (vaste programme), Refus de la littérature et littératures du refus, L’écrivain en accusation, Du côté des cathares (ou puristes), enfin Entre deux galaxies.
Écrire, pourquoi ? Pour rien – par envie, désir, source. L’auteur a commencé dès l’âge de 5 ans à raconter des histoires à ses petits copains, puis à 8 ans à en écrire, à 12 ans à lire accaparé par « une sorte d’érotisme littéraire » p.21, à 15 ans à tenter le roman. Rien d’abouti avant l’âge adulte, mais le pli était pris. Plutôt timide, le caractère trouvait là son expression. L’esprit réfléchissait comme un miroir depuis toujours, comme tout le monde, mais en avait conscience (ce qui n’est pas donné semble-t-il à tout le monde). Réfléchir, c’est se dédoubler en acteur et en spectateur, « en même temps » comme dirait l’autre. François Hollande est passé maître dans la façon célèbre qu’il a de faire et de commenter ce qu’il fait dans le même mouvement. De Gaulle, au moins, se laissait un temps d’attente, de mûrissement, tout comme Mitterrand. Mais cet état d’esprit fait l’écrivain, permet d’être observateur en plus d’acteur, d’user de son imagination pour agir sans agir. Pourquoi écrire ? Parce que « l’écriture est une fin en soi » p.20. « Le besoin d’écrire, rien de plus naturel que la littérature » p.25.
L’idéal communiste, si prégnant durant toutes les années soixante, rendait l’écriture coupable. C’était être « bourgeois » que d’écrire comme les écrivains bourgeois pour des lecteurs bourgeois. Bourgeois, donc limité, entre-soi, dominant. D’où le refus de la littérature chez certains. Flaubert a annihilé le sujet bourgeois dans ses œuvres, ou du moins l’a-t-il tenté. Ce pourquoi il écrivait et réécrivait dans les affres, éradiquant sans pitié tout ce qui était subjectif au profit de la neutralité du style. Seul le choix des mots, seule la musique de la phrase, étaient encore justifiés dans l’œuvre. Un élitisme. Comme Mallarmé, qui voulait réserver la poésie à quelques-uns en écrivant hermétique. Quant à Rimbaud, il a laissé toute poésie pour ne plus rien dire. Radical. Les surréalistes s’engouffreront dans l’anti-intellectualisme en tordant l’écriture jusqu’à la rendre automatique, onirique, un « ça » qui éjacule à la chaîne – ce que l’IA aujourd’hui (« intelligence » artificielle, dit-on) reproduit très bien. Une impasse.
L’écrivain est alors accusé parce qu’il ne s’engage pas. Ah, l’Engagement ! Julius Benda dénonce en 1927 La trahison des clercs (toujours réédité) qui, face à la montée des fascismes divers, du communisme et du nazisme, ne disent rien, réfugiés dans leur tour d’ivoire de l’imaginaire. Pas faux. André Breton voulait renverser les bourgeois et subvertir les mots pour en faire une révolution mentale, « la souveraineté de la pensée » p.69 – d’où son adhésion au Parti communiste, puis son exclusion pour déviation petite-bourgeoise. Risible. Or les années 20 voient une floraison de la liberté, « tout éclate à la fois : sensations neuves (le jazz, le sport, la vitesse), les art,s la décoration la morale. Femmes et adolescents commencent la longue marche de leur émancipation. La littérature est joyeusement individualiste esthétisante sans remords » p.71. C’étaient les années d’éveil de l’auteur, né en 1917, mais un chant du cygne. Soudain, tout s’abîme dans le krach de Wall Street, le national-fascisme, la guerre éclair de 40, la Défaite, l’Occupation, l’Épuration. « Le paysage littéraire est soudain envahi par les divisions blindées existentialistes de marque allemande (Heidegger…) quoique au service des Alliés. Tout cède à leur avance ; c’est la débandade. La tourelle d’un char se soulève et l’on voit émerger le général en chef : Sartre. En un clin d’œil il inaugure les Temps modernes » p.72. Imagé. C’est la guerre pour la Révolution, l’Engagement exigé, l’embrigadement aux côtés des prolos. « Tout anti-communiste est un chien », dira l’agitateur excité. Confort moral impossible, il faut défendre une Cause. La seule juste était la communiste évidemment.
Vu sa faillite en actes, c’est aujourd’hui l’écologiste qui devient le Juste, mais avec autant de hargne, de système et de bêtise. On suit, on ne réfléchit pas ; on s’engage, sans souci des conséquences, parfois socialement inacceptables. Tout anti-écologiste est un chien – mais les chiens mordent, l’oubliez-vous ? Sous gilets jaunes ou cagoules noires, tournant en rond ou cassant tout, trublions trotskistes ou ados attardés à l’Assemblée, ils suscitent la Réaction. Le Cancel n’est pas nouveau, déjà la presse bien-pensante (dont Le Monde a été le chantre d’époque en époque, de mode en mode, jusqu’à nos jours!), faisait silence sur ceux qui ne lui plaisaient pas. « J’appelle cela de l’hypocrisie, et d’un genre particulièrement sordide ; mais l’hypocrisie, la tartufferie est passée du domaine des mœurs à celui de la politique ; et le sectarisme cafard est une des plaies de notre temps » p.84.
Les écrivains qui s’étaient retirés de l’Engagement pour simplement écrire, sont appelé par l’auteur des « cathares ». Ils condamnent le roman, genre impur, au profit d’une « histoire naturelle » (Zola), d’un « fond commun psychique indifférencié » (Nathalie Sarraute), du seul « monologue intérieur » (Joyce), voire les tentatives d’écrire tout ce qui se passe dans l’instant, sans point ni virgule, sans intérêt non plus. Une abstraction qui ne renvoie qu’à elle-même. « Claude Mauriac nomme ‘alittérature’ cette littérature d’où les significations sont expulsées ; et ce n’est peut être pas un hasard si, au moment où l’on parle ‘d’alittérature’ on parle aussi de l’éventualité de formes littéraires qui serait programmées sur ordinateur et qui n’exigeraient plus la participation d’un écrivain, puisque le programme serait mis au point par une équipe de techniciens du langage » p.102. La peur de l’IA n’est pas nouvelle, déjà en 1972 Jean-Louis Curtis l’évoquait…
Sommes-nous donc entre deux galaxies ? « Nous ne voyons plus, nous n’entendons plus tout à fait de la même façon qu’il y a 30 ans, nous ne lisons plus de la même façon qu’autrefois » p.115. Et pire encore de nos jours. Désormais il y a les séries pour les histoires, le cinéma pour l’émotion, la chanson pour la poésie. Le livre, l’écrit – en bref la littérature – redevient peu à peu élitiste, ne plaisant plus qu’à quelques-uns. « Si l’image s’adresse d’abord aux yeux ou aux oreilles et à travers eux à la sensibilité et à l’intelligence, c’est d’abord à l’intelligence que s’adresse l’écriture, et ensuite à l’imagination visuelle et auditive et à la sensibilité. Les voies d’accès sont différentes et ce qui est atteint, irradié, vivifié est également différent » p.119. L’intelligence se perd, puisqu’elle devient « artificielle », encourageant la paresse de penser ; l’image fait foule, encourageant le grégaire, le conformisme, le comme-tout-le-monde, si cher aux solitudes exacerbées par l’égoïsme social.
Somme toute, une belle réflexion sur la littérature et l’écriture, qui reste d’actualité malgré le demi-siècle qui a passé.
Jean-Louis Curtis, Questions à la littérature, 1973, J’ai lu 1975, 123 pages, e-book Kindle €6,49














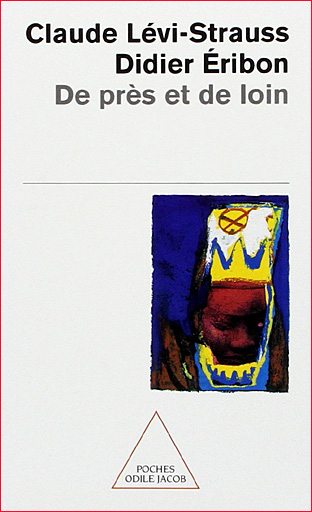






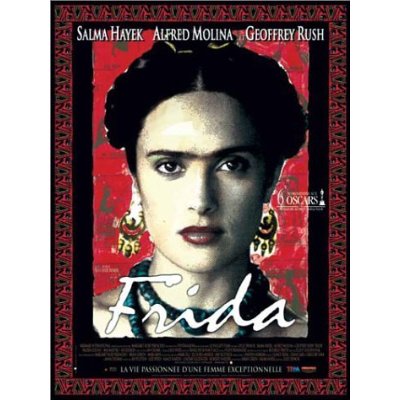
Commentaires récents