Les années 1970 retrouvaient « le terroir » avec le gauchisme antisystème, les chèvres au Larzac et les « communautés » pré-écologiques. Les historiens se sont donc penchés sur le passé pour voir comment on en était arrivé à tout centraliser à Paris, à laisser dominer une classe de nantis un brin snob et à créer de toutes pièces la fameuse « gastronomie française ».
Car la cuisine existait avant les bourgeois ; elle était surtout la tradition des femmes qui utilisaient les composants autour de la ferme dans un pays à plus de 80% rural. Seuls les aristocrates s’amusaient avec la nourriture, copiant les préciosités romaines et payant à prix d’or des chefs pour leur prestige. Quand advient avec la révolution le règne des bourgeois, tout change. Le plaisir des oisifs disparaît au profit de la frime sociale, de la dépense ostentatoire et de l’imposition sociale du « goût ».
Pour cela, Paris était incontournable même si la cuisine lyonnaise existait richement, comme le rappelle l’auteur. Mais la gastronomie française dont la réputation se répand dans le monde est née au temps des nationalismes et de l’industrialisation. Les aristocrates sont cosmopolites, pas les bourgeois. La cuisine à la française est un art, pas la gastronomie parisienne. Elle est une industrie de la bouche destinée aux hommes de pouvoir et descendant du haut vers le bas, par degrés, dans toutes les classes sociales, y compris les plus pauvres qui recyclent les restes.
Les grands restaurants à la mode étaient chers et goûteux : Le Café anglais, Véry, le Grand Véfour… Des dynasties familiales géraient et adaptaient cuisine et décor pour maintenir l’attrait. Le luxe était de fournir tout un service d’une centaine de plats, organisé selon une savante stratégie dont l’auteur nous livre une clé par un plan de table au chapitre Le repas. Le dîner (nom de notre actuel déjeuner) était un spectacle et il s’agissait d’éblouir les invités par l’abondance et la présentation des mets. Deux grosses pièces trônaient à chaque bout de la table, tandis qu’alternaient les relevés et les entrées que les convives devaient se passer, suscitant une série d’échanges conviviaux dans un silence relatif. On ne se lâchait qu’une fois la desserte effectuée, et les « desserts » (sucrés et salés) permettaient la conversation.
Jean-Paul Aron analyse les bons endroits dans leur évolution tout au long du siècle, les mets servis et leur mythologie (homard délaissé, huîtres chéries), comment s’ordonne la cérémonie du repas, avant de mettre en contraste la gastronomie avec la simple nourriture (administrative dans les réfectoires des hôpitaux, des prisons, des collèges et des casernes ; de récupération dans les restaurants à 40 sous, à 17 sous, à 4 sous ; jusqu’à la misère de la mendicité et des bouillons de charité) – et d’étudier l’imaginaire gastronomique (mythe, spectacle, drame, fête).
Si seulement 17% des Parisiens décédés avaient les moyens de payer les 15 sous nécessaires à leur enterrement, cela signifie que les gastronomes étaient très peu nombreux et que la quête de subsistance emportait presque tous. Les inégalités étaient fortes et criantes dans cette période d’industrialisation et de progressive administration ponctuée de révolutions (1789, 1800, 1815, 1830, 1848, 1871). Le mythe submerge donc le réel et révèle que la gastronomie ne vient pas du terroir mais du pouvoir ; elle ne naît pas du produit mais de sa mise en scène ; elle ne surgit pas d’en bas mais d’en haut, de cette minuscule frange qui a les moyens et qui désire le montrer.
Jean-Paul Aron écrit simplement mais il procède à des énumérations, certes « scientifiques », mais que l’on peut sauter rapidement pour garder le fil de la lecture. Aucune recette mais des listes de plats et des menus, parsèment les chapitres. De nombreuses citations des gourmets et écrivains du temps précisent certains points.
Le lecteur notera ce fait remarquable que le service « à la française », qui mettait tous les plats sur la table sauf les desserts (servis après la desserte), a été remplacé par le service « à la russe », organisé par succession des entrées, plat, desserts, le tempo étant donné par le maître de maison. Il notera aussi que « la maitresse » de maison n’a pas son mot à dire avant le XXe siècle et que les femmes sont considérées comme quasi indésirables pour apprécier la gastronomie : le désir de bonne chère exige d’éviter les désirs de la chair.
Quiconque s’intéresse à la cuisine et à son évolution, ou à la sociologie des Français, lira utilement ce petit livre érudit et gourmand, réédité quarante ans après sa parution pour le bonheur de la culture.
Jean-Paul Aron, Le mangeur du XIXe siècle – Une folie bourgeoise : la nourriture, 1973, Belles-Lettres 2013, 352 pages, €14.50 e-book Kindle €10.99
Histoire de la gastronomie française à comparer avec La cuisine italienne, histoire d’une culture
Rubrique gastronomie sur ce blog




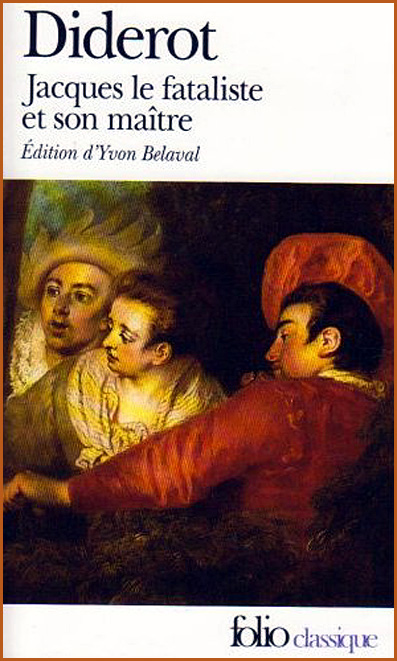

Commentaires récents