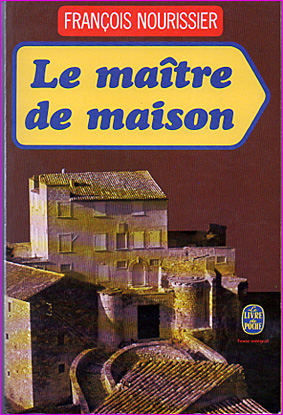
La crise de la quarantaine : l’auteur a 41 ans lorsqu’il publie ce roman, en écriture depuis deux ans. Né en 1927, adolescent pendant la guerre, affamé de femmes, de tabac et d’alcool selon les habitudes d’après-guerre, son personnage d’écrivain arrivé, père de trois enfants avec son épouse Geneviève, décide de se fixer. Acheter une maison, un nid familial, une forteresse contre les aléas du monde. Dans l’arrière-pays ensoleillé et sec du Midi, le Lossan est une bâtisse forte achetée en hiver après beaucoup de visites et d’hésitation, que de longs mois passent à restaurer, jusqu’au bassin craquelé qui devient piscine.
Car l’été arrive et avec lui les trois enfants depuis leurs internats, après un séjour en Angleterre pour Bettina, 16 ans, un camp scout dans les gorges du Tarn pour Roland, 14 ans, et des vacances sur la plage à Houlgate pour Robert, 10 ans. Le nid est prêt, frais, rassurant, et il s’anime. Les parents invitent des amis, qu’ils alcoolisent fortement, les enfants des copains, on fait du vélo, on ôte son tee-shirt, on vit en slip autour du bassin. Le père observe sa progéniture avec quelque inquiétude : Bettina déjà femme et trop belle pour ne pas susciter du désir, Roland à peine adolescent mais pas perverti par ses compagnons « aux mollets nus » comme papa l’observe sur son visage, Robert toujours enfant, éclatant de rire dans son bain, faisant des niches autour de la piscine.
Mais l’été finit et les enfants regagnent les internats, en Suisse pour la fille, à Lyon pour les garçons. Leur mère les emmène dans la Peugeot, probablement 404 vu l’époque. L’écrivain et critique se retrouve seul au manoir avec Rose, la bonne à tout faire. Il boit son gin martini chaque soir avec application, un peu trop peut-être. Sa femme s’attarde ailleurs car il déprime et rien ne vaut que de le laisser seul à ce moment-là. Tout se lézarde, la maison se met en noir, les scorpions reprennent du terrain dans les coins sombres, les cyprès s’étiolent. La vie est partie avec la jeunesse, la maison se déshabite et devient froide, comme l’âge qui vient, les courbatures, les vertiges, les insomnies. Tirer une maison de son assoupissement exige de l’énergie, l’auteur n’en a plus guère, il se repose sur sa femme.
Les enfants grandissent, s’éloignent, la vie familiale se dégrade, le corps ne suit plus et l’œil rêve des filles jeunes et minces dans la rue mais sait qu’il faut renoncer par impuissance. Il le raconte avec pudeur dans une introspection hachée dont le contrepoint est fourni par l’agent immobilier, venu lui aussi d’ailleurs mais assez popu pour s’être fait accepter du pays tout en gardant un certain détachement de bon sens dû à son métier toujours sur les routes à rencontrer des acheteurs venus de partout.
Habiter une maison est habiter sa vie mais, pour y réussir, il faut avoir appris à vivre. Nul n’est maître de maison sans être aussi maître de soi. Or l’enfance et les complexes ressurgissent comme des poisons dans la solitude et les ragots de village. Les gens épient la famille, étrangère au pays, commentent leurs faits et gestes, critiquent mais envient. Le contrepoison est l’alcool, pris à haute dose au point d’en être écœuré à notre époque plus saine, et les somnifères, cette médication fort à la mode américaine des années soixante. Reste le travail, assidu mais lassant, dont l’auteur ne dit pas grand-chose. Il gagne bien sa vie pour avoir acheté ce mas, assuré de lourds travaux, et laissé ses enfants en internat à l‘année. Mais ce n’est jamais assez. La vie est une lutte de chaque jour contre l’usure, la ruine, la décrépitude, la mort qui s’infiltre entre les pierres et dans les corps et dont la chienne Polka, paralysée un temps de l’arrière-train, annonce l’inéluctable venue.
Un livre de vieillesse prématurée comme on la connaissait après avoir brûlé la vie par tous les bouts après la guerre, une façon déjà passée en 1968 lors de la parution du roman. De belles pages sur la bâtisse, la chienne, les gosses. Un drôle de livre pour notre temps, très bien écrit, prix Plume du Figaro en son temps.
François Nourissier, Le maître de maison, 1968, Livre de poche 2000, 287 pages, occasion €5.11 e-book Kindle €8.99

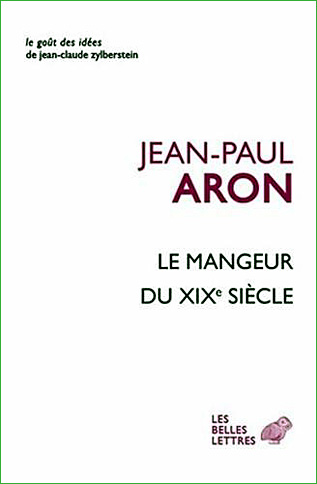

Commentaires récents