Nous sommes à la moitié du séjour. J’ai passé une bonne nuit et mes narines s’ouvrent au petit matin aux odeurs d’eau douce et de terre, le plaisir du bateau. Le petit-déjeuner est à sept heures, une heure plus tard que d’habitude. Nous sommes tous levés avant. Les faucons ont leur nid un peu plus haut sur les rochers, ils surveillent les alentours.
Hier soir, un lézard et une araignée assez gros ont tenté de pénétrer sur le bateau par le câble d’amarrage. Ils ont été chassés à coup de balai, engendrant une cavalcade qui nous a un moment inquiétés. Les pêcheurs sont partis tôt ce matin en barques et leurs cabanes sont désertes. Ils vivent ici à l’année mais pas tous en même temps ; chacun passe trois mois, sauf le mois interdit qui se situe en mai.
Après un petit-déjeuner d’omelette et de Vache-qui-rit, nous partons pour deux heures de randonnée. L’objectif est de « voir les oiseaux ». Sur les rives où pousse le tamaris et le roseau, de nombreux oiseaux ont leur nid : les aigrettes, les hérons cendrés, les vanneaux à éperon, même les cigognes. Nous les voyons surtout de loin, nous sommes trop agités et trop bruyants pour eux. En revanche, d’innombrables traces marquent le sable ocre : les chèvres, un félin, le renard des sables, le lézard, les serpents. Des trous de fourmi-lion parsèment le sable. Tous les serpents ondulent vers l’eau.
Le campement du chevrier et (probablement) de son fils n’est pas établi au bord de l’eau, les fauves et les reptiles vont boire, mais à l’intérieur, sur le désert. Les matelas sont dressés sur des armatures de lit surélevé pour éviter les rampants. Pas de troupeau en vue, ni de chevrier. Des toiles d’araignée indiquent qu’ils sont partis depuis un moment, le troupeau ramené à son propriétaire, comme en témoigne un carnet à spirale laissé là qui liste une série de courses avec leur prix pour se faire rembourser. Un abri en briques séchées permet d’entreposer quelques bidons tandis qu’un enclos non terminé protège un peu les chèvres. Le sol est parsemé de crottes de bique et une chèvre morte pue dans un coin. Le coup d’un serpent, peut-être.
Nous retournons au bateau par une boucle dans le désert. La marche dans le sable est toujours aussi pénible au col du fémur, mais dure aujourd’hui moins longtemps. À 10 heures, nous sommes de retour sur le bateau où un grand gobelet de tamarin sucré bien frais nous attend.
Nous avons visité à l’aller les abris des pêcheurs. Une allée bordée de plantations d’herbes aromatiques, de basilic, de citronnelle et d’un plan de pastèque aboutit aux baraques qui sont ouvertes sur un côté. Des centaines de pains sans levain sèchent sur une claie et sur le pont d’une vieille barque. Des mouches agaçantes nous harcèlent lorsque nous sommes près des côtes la journée et les moustiques le soir.
Navigation et lecture jusqu’à une dune de sable jaune d’œuf qui tombe dans le lac. Le bateau amarré à la rive, nous pouvons à nouveau nous baigner. L’eau est encore glauque mais moins chargée cette fois, surtout rafraîchissante. L’un des hommes se baigne avec nous, non par plaisir mais pour déboucher une canalisation sous la coque. La plage est en pente et Prof s’y vautre, le roi n’est à ce moment-là pas son cousin.



































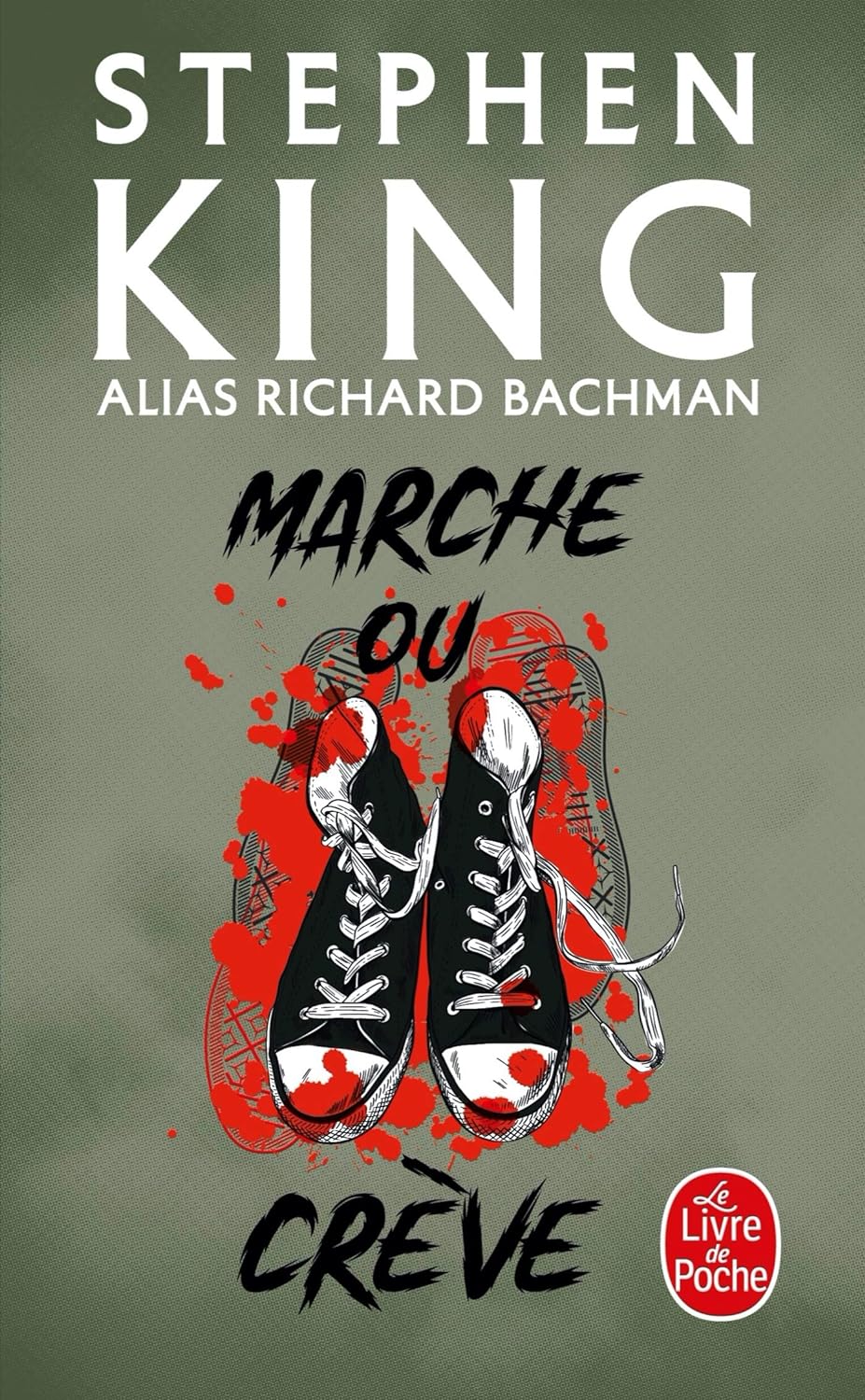

Commentaires récents