
L’enfance, paradis perdu éternellement ressassé. Christian Signol, rédacteur administratif dans sa province natale avant de devenir écrivain, ne cesse de chanter le terroir, la vie d’avant, l’harmonie idéale entre l’être humain, les bêtes et la nature. Le causse, en ses sommets, c’est le ciel en été : bleu insoutenable au jour et piqueté d’étoiles la nuit. Un bleu qui lui est resté dans les yeux depuis que, tout petit, il y a vécu son enfance entre parents, grand-parents, oncles et tantes.
Il dit :« Sur ce causse à la magnifique lumière, vivait mon oncle solitaire qui m’a inspiré le personnage de Bleus sont les étés. Lui qui n’avait jamais quitté son hameau natal se désolait de devoir mourir sans descendance. J’ai alors imaginé cette histoire : au cours d’un été radieux un jeune Parisien et Aurélien nouent une complicité immédiate »
Aurélien a atteint les 80 ans et vit toujours au village sur le causse, avec ses brebis. Il n’en a plus qu’une dizaine, qui lui font des agneaux une fois l’an, qu’il vend pour subsister. Mais il est seul. Sa mère, égoïste et jalouse, l’a dissuadé d’épouser la Louise lorsqu’il avait 30 ans, au motif que « deux femmes dans une maison, c’est toujours une de trop » p.15. Non, ce n’était pas mieux avant… Le respect filial de tradition l’a empêché de vivre sa vie, et surtout d’être père. Il aurait dû contrer sa mère.
Le fils qu’il n’a jamais eu le hante. Il va même jusqu’à découper depuis des années des photos de garçonnets dans les journaux pour les adopter un ou deux ans comme fils, avant d’en changer. Il le voit, ce fils : « Sa peau avait la couleur des abricots, il était grand, fin comme de l’ambre, avec des yeux dorés » p.24. Il voudrait partager sa propre enfance, transmettre ce qu’il a reçu lui-même et qui lui a été si précieux : « Son enfance à lui ? oh ! c’était du ciel, beaucoup de ciel, des bêtes chaudes dans ses bras, du vent, de l’eau, la tiédeur des pierres et celle, plus rare mais si précieuse, de la main de son père. C’étaient d’interminables journées entre les buis et les genévriers, de magnifiques silences plein de soupirs, des nuits sous les étoiles, serré contre le corps de celui qu’il n’avait jamais pu oublier de malgré les années » p.18.
Alors, lorsqu’il voit débarquer aux vacances de Pâques une famille de « Parisiens » qui ont acheté une masure au village pour y passer les vacances « nature », il sent son rêve se réaliser. Un gamin de 10 ou 11 ans vient à lui, tout naturellement, et le suit dans tout ce qu’il fait. Benjamin aime la nature, les bêtes, le pays. Il est très sensible à l’attention qu’on lui porte, à l’amour qu’il sent sourdre des êtres authentiques. Ses parents l’ont adopté à l’âge de 3 ans mais sont trop citadins, trop intellos, trop à se recevoir les uns et les autres, pour l’aimer vraiment ; il ne leur ressemble pas. Le vieil Aurélien, en revanche, est une sorte de grand-père apaisé, en phase avec l’univers ; une balise en ce monde qui devient fou, un bol d’air après le métro parisien et l’école grise.
Benjamin suit tout le jour Aurélien, mange à sa table, dort même dans sa maison, avec l’autorisation initiale de ses parents. Il est heureux et voudrait ne jamais repartir. Mais la demi-sœur se méfie, pour elle, ce n’est pas « normal » (ah, les filles et la norme sociale !). Les parents s’inquiètent de l’attachement du garçon à ce vieil homme, qui va bientôt mourir. Ils sont même jaloux de cet amour qui ne va pas vers eux. Ils commencent par limiter, puis à « interdire » (ah, les bobos socialistes et l’interdiction !).
Ils reviennent aux vacances d’été, et c’est pareil, le gamin leur échappe, tout à Aurélien. Cette fois, c’en est trop. Ils décident de partir en catastrophe et de mettre le maison en vente. Ils ne reviendront plus, « pour le bien de l’enfant » (ah, le démon du bien d’adultes qui se croient détenteurs de la vérité des êtres !). Benjamin est désespéré, mais doit obéir. Aurélien est désespéré, mais décide de réagir. Lui qui n’est jamais sorti, « sauf pour mon service militaire à Montauban » (n’a-t-il pas été mobilisé en 40 ?), il va monter à Paris. Prendre le train, d’abord le tortillard jusqu’à la ville, puis le train pour la capitale, puis le métro – où il se trompe – puis un taxi. Benjamin lui a heureusement donné son adresse pour qu’il lui écrive, mais ses lettres sont interceptées par les parents qui veulent « le protéger » (ah ! mais de quoi, s’il est heureux ?). Ils habitent évidemment le sixième arrondissement, le nid des bobos bourgeois progressistes autour de Saint-Germain-des-Prés.
Autant dire qu’il n’est pas bien accueilli et doit repartir le jour-même. Benjamin, désormais pré-ado et destiné à être vissé en pension, obtient quand même l’autorisation de le guider jusqu’au train à Paris-Austerlitz. Il en profite pour passer la journée avec lui, montrant son école, Notre-Dame, la Seine, le métro, tout son univers de citadin. Aurélien repart, mais ce n’est pas la joie. Il est abattu, il n’a plus envie de vivre.
Pourtant, un espoir : Benjamin lui a juré que, si on l’empêchait de le revoir, il ferait une fugue. Il débarque donc le soir de Noël, ayant quitté sa pension pour les vacances et utilisé son argent de poche pour le train. C’est la fête, mais le dernier éclat. Les parents en furie, qui ont deviné où le gamin allait, débarquent en voiture, ayant roulé toute la nuit. Ils préviennent les gendarmes. Et l’enfant est repris, Aurélien privé de fils et Benjamin de (re)père. L’auteur ne dit pas ce qu’il est devenu, mais le vieux paysan ne tarde pas à avoir une crise cardiaque. Il aura au moins vécu la réalisation de son plus cher désir dans les derniers mois de sa vie.
L’auteur décrit des caractères absolus tels qu’on les aimait dans les années soixante-dix, et fait de ses personnages des sortes de caricatures. Le vieux paysan en patriarche biblique, le garçon de 10 ans en jeune Isaac prêt au sacrifice, les parents néo-ruraux écolos progressistes comme dans Les Bronzés, sont excessifs. Pourquoi Benjamin n’aurait-il pu venir aux vacances, et rester en ville le reste de l’année ? Cela ne l’aurait-il pas motivé pour l’école, lui qui voulait plus ou moins être vétérinaire ? Gageons qu’à l’adolescence, le fils se rebellera contre ses bobos imbéciles de parents adoptifs ; peut-être se fera-t-il berger ou éleveur de chèvres au Larzac. Qu’auront-ils gagné ? De la haine, pas de l’amour.
Reste un roman sensible où l’émotion sourd sans cesse des situations. Le lecteur plaint Aurélien et son désir de fils ; il comprend que collectionner des photos de jeunes garçons n’a rien de pervers mais résulte d’une affectivité en manque ; il sait que Benjamin l’adopté a besoin de repères stables dans son existence et qu’il suffirait de peu pour l’apaiser. Un beau roman, un peu appuyé, mais qui fait compatir.
Christian Signol, Bleus sont les étés, 1998, Livre de poche 2000, €8,40, e-book Kindle €7,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les romans de Christian Signol déjà chroniqués sur ce blog

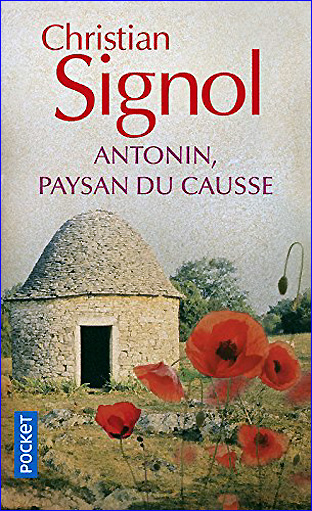
Commentaires récents