
Pour le premier roman industriel français (un exploit !), pas de préface morale (ouf !) et une longueur raisonnable (c’est heureux !). La ville noire, c’est Thiers que George Sand a visité en 1859, la coutellerie et la papeterie enserrée dans la gorge de la Durolles, ses ateliers d’artisans bâtis de bric et de broc sur l’à pic de la cascade qui fournit l’énergie de l’eau. Il y a la ville basse populaire des besogneux, jusqu’au Trou d’Enfer où la gorge est la plus étroite et le rocher le plus branlant, et la ville haute de la grande usine et des bourgeois qui ont construit une ville « peinturlurée ».
Etienne, dit Sept-Epées, a déjà douze ans d’expérience en coutellerie à 24 ans. Il a commencé apprenti à 12 ans lorsque ses parents sont morts tous deux de maladie, recueilli par son parrain coutelier célibataire, colérique mais généreux. Il est salarié et travaille bien mais a de l’ambition. Il sait lire, écrire et compter et veut monter son propre atelier pour, un jour, émerger à la ville haute. Il tombe amoureux de Tonine, dite la Princesse, qui n’a que 18 ans et qui est la petite sœur d’une fille montée à la ville haute par mariage mais que son mari débauché a délaissée jusqu’à ce qu’elle meure. Tonine n’a aucune ambition, sinon de rester parmi les siens, dans son milieu, dans l’enfer de la ville basse.
Ces deux-là sont comme l’eau et le feu, bien mâle et femelle, celui qui veut grimper et celle qui veut rester. D’où les deux étapes de l’amour que Tonine appelle encore « amitié » : « Il y a amitié et amitié ! Il y a celle qui fait qu’on ne peut pas vivre l’un sans l’autre et que l’on se marie ensemble ; (…) mais il y a une amitié plus tranquille et qui n’enchaîne pas tant : c’est celle qui fait qu’on s’intéresse aux peines d’un autre et qu’on voudrait l’en tirer » p.868 Pléiade. Ils mettront des années à se convenir, amoureux mais incompatibles, jusqu’à ce que le destin s’emmêle ou que Dieu s’en mêle (Sand mélange volontiers les deux). Tout finira bien mais dans un délire rousseauiste habituel à l’auteur avec hymne au socialisme suprême en chapitre final. Et l’égalité entre l’homme et la femme sera réalisée : « Avec le changement de position, l’horizon de Tonine s’était grandi. Elle avait voulu entendre de son mieux la science et les arts de l’industrie qu’elle avait à gouverner et, sans être sortie de son Val-d’Enfer, elle s’était mise au courant du mouvement industriel et commercial de la France. Sept-Epées fut donc très heureux de pouvoir causer, devant elle et avec elle, de tout ce qu’il avait acquit et observé, sans craindre de trouver en elle des préoccupations étrangères à la nature de ses connaissance » p.924.
Malgré le rousseauisme béat, le roman se lit bien, sans aucun de ces excès d’autres romans de « sentiment ». Le travail semble ancrer les personnages à la réalité bien plus que « l’art » d’une Elle ou d’un Lui ! La fable morale ne se fait pas trop sentir même si les héros sont toujours beaux, gentils et avisés. Leur initiation sera de montrer qu’ils peuvent errer avant de trouver – de droit – la voie. Etienne fera son chemin de croix semé d’embûches de caractère, de travail et d’argent tandis que Tonine se contentera de s’épanouir naturellement en femme de raison maternant tout le monde. Si l’homme agit, la femme se contente d’être : telle est la faiblesse de George Sand.
L’ambition de l’ouvrier à devenir son propre patron contredit trop le socialisme naïf de l’idéalisme à la Pierre Leroux que Sand a fréquenté : ce serait devenir « capitaliste », déjà un gros mot il y a deux siècles en France ! Aussi, lorsque le phalanstère se crée et que les ouvriers parviennent à devenir maîtres de leur outil de travail, ce n’est pas par leur initiative mais par la main d’en haut. Le bourgeois qui avait épousé la sœur meurt en laissant l’usine en héritage à Tonine. Elle n’a plus qu’à se laisser vivre dans l’idéal réalisé, sans avoir rien fait pour le mériter. Elle attire à elle par mariage le pauvre Etienne dont l’atelier à demi en faillite est emporté par les eaux, malgré ses efforts et sa bonne volonté. Le travail ne paie pas et seule « la vertu » est récompensée par le ciel. Voilà qui n’est guère révolutionnaire pour une soi-disant « socialiste » !
Une telle conception du destin écrit d’avance et de l’administration des choses par une super maman reste bien dans le socialisme français, comme en témoignent les nationalisations-sanctions de 1981, la faillite des énarques mis par les copains de leur bord à la tête des grandes entreprises devenues nationales et la gabegie distributrice sans souci de produire qui s’en est ensuivi. Pour ce genre de socialisme encore imbibé de Bible, donnez et Dieu y pourvoira (il a bien multiplié les pains et les poissons) ! Il y aurait même un orgueil un brin diabolique à vouloir maîtriser la nature et assurer sa propre destinée. C’est ce que n’est pas loin de penser George Sand lorsqu’elle fait dire à Etienne, à propos du parcours qu’il a tenté : « La vie de fer et de feu de l’industriel est un délire, une gageure contre le ciel, un continuel emportement contre la nature et contre soi-même. Celle du paysan est une soumission prolongée, demi-prière et demi-sommeil. Le mépris des tourments et des joies qui nous consument est écrit sur sa figure, qui ne sait ni rire ni pleurer. Il contemple et médite » p.904. Déjà l’écologisme pointait sous le socialisme version idéaliste !
Nous sommes dans une fiction expérimentale, avec le talent de l’auteur pour disséquer avec minutie les sentiments des uns et des autres. C’est bien cette dissection, ici raisonnable, qui est le sel du livre, ainsi que la description du milieu ouvrier français milieu XIXe. L’utopie du familistère n’est qu’un greffon final peu convainquant : l’autogestion ouvrière, que ce soit dans les coopératives ou les phalanstères, a montré clairement ses limites car aucune n’a survécu aux années. Quant à la critique de l’ambition qui serait menée par l’individualisme et l’argent, elle tombe à plat car ce qui hante George Sand est qu’un jour l’ouvrier devienne « bourgeois » (autre gros mot né alors en France). C’est pourtant ce que les Trente glorieuses ont réalisé un siècle plus tard, et je ne sache pas que les « ouvriers » s’y sentent plus malheureux. Si l’inégalité sociale subsiste, elle n’est criante que pour quelques milliers d’individus réellement plus « riches » que la moyenne, en général grâce à leur propre talent de créateur (footeux, écrivains, chanteurs, comédiens, en plus des créateurs d’entreprise et des inventeurs). Pourquoi donc « s’enrichir » serait-il un « péché » moral ? Le profit n’est que la résultante de tout un enrichissement intellectuel, personnel et technique, en général partagé par tout une série de métiers induits. C’est cette naïveté moralisatrice qui agace le plus aujourd’hui chez George Sand comme chez Jean-Jacques Rousseau.
Un court roman agréable à lire qui réconcilie avec la prose diarrhéique de l’auteur, montrant que dans le flux issu des entrailles peuvent naître parfois de bonnes histoires.
George Sand, La ville noire, 1861, Amazon media, €2.24 e-book Kindle €1.74
George Sand, Romans tome 2 (Lucrezia Floriani, Le château des désertes, Les maîtres sonneurs, Elle et lui, La ville noire, Laura, Nanon), Gallimard Pléiade, 1520 pages, €68.00
Les romans de George Sand chroniqués sur ce blog
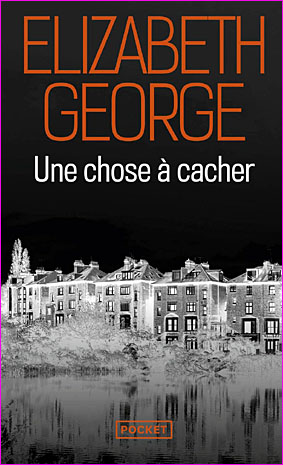


Commentaires récents