
Un schéma classique, mais toujours efficace : un étudiant bien sous tous rapports, avec la vie devant lui, a une vision, celle d’une catastrophe. Il en fait part à ses amis, qui ne le croient pas vraiment, mais les entraîne hors du danger, suscitant l’ire des spectateurs dérangés. La catastrophe survient, exactement comme il l’avait prédit. Il connaît alors le sort de Cassandre : il porte malheur. C’est le cas de Nick (Bobby Campo), jeune homme gentil et musclé, qui assiste à une course automobile avec sa petite amie Lori (Shantel VanSanten) et ses copains Hunt (Nick Zano) et Janet (Haley Webb). Nick a la prémonition d’un accident de voiture qui envoie des débris dans les gradins, provoquant l’effondrement du stade.



Évidemment, tout se passe comme prédit, mais la bande des quatre est sauvée, avec ceux qu’elle a entraîné à sa suite. Dont Carter (Justin Welborn), un chauffeur de dépanneuse raciste dont la fiancée a péri parce que, selon lui, le garde de sécurité noir George (Mykelti Williamson) l’a empêché de replonger dans les débris pour la sauver. Il n’aurait rien pu faire mais serait mort lui aussi. Mais que peut-on contre l’obstination paranoïaque du plouc empli de ressentiment ?
Évidemment, ceux qui sont sauvés ne sont que des morts en sursis, et Carter le mauvais y passe en premier. En voulant se venger du Noir, une suite d’enchaînements mécaniques le jette à terre, enchaîné derrière sa dépanneuse dont les freins sont desserrés, et cramés par le bidon d’essence qu’il avait apporté pour jouer au Ku Klux Klan. Il périt, lui le Blanc raciste, comme les Noirs lynchés par ses semblables texans. Nick et ses amis se demandent quel est l’ordre de la liste à périr. C’est ensuite le tour du garagiste.



Évidemment, Hunt n’y croit pas. Jeune, bien bâti, sexuellement au top, il sent la vie devant lui et balaye ces superstitions malgré les récits sur Internet. Il périra en second, par où il a « péché ». Bien que Nick cherche à le joindre sur son mobile pour le prévenir d’éviter à tout prix l’eau, ainsi qu’il l’a vu dans un cauchemar, Nick sort en slip de la cabine où il a baisé longuement une fille jeune. Il marche, avantageux, lorsqu’un gamin obèse et balourd lui flanque une giclée dans sa paire de pectoraux soigneusement cultivés, que le môme rêverait sans doute d’avoir, en mimétisme homo-érotique. Le jet symboliquement spermatique fusille le téléphone et Hunt est furieux. Il crève… le matelas du gros gamin, lui pique son flingue à flotte et le balance dans les profondeurs sans regarder s’il sait nager. En jetant le pistolet à eau en plastique derrière une cloison, il actionne sans le savoir le levier de vidange de la piscine, dont le trou aspire violemment tout ce qui passe à portée. Jouant toujours avec sa pièce « porte-bonheur », il fera son malheur. Ladite monnaie tombe à l’eau et le jeune fat plonge pour la retrouver. Il se fait aspirer par le fondement, sans pouvoir s’en dépêtrer, au point de se vider par le cul. Gros plan sur le foie, les viscères – et la pièce – que régurgite le système bête et méchant, programmé pour bien faire son boulot.



Lori et Janet veulent absolument voir le film d’horreur catastrophe dont « tout le monde parle ». Nick prévoit qu’il va y avoir un accident et tente de les sauver mais Janet refuse, en conne américaine persuadée de son bon droit féministe de n’écouter qu’elle-même. Quant à Lori, il l’entraîne avec lui, mais l’explosion du cinéma (tout saute toujours à Hollywood) fait s’éventrer l’escalator et la fille est entraînée dans les engrenages à cause d’un lacet de basket mal attaché (toujours la flemme ado typiquement yankee). En réalité, lorsque les filles vont au ciné, Nick se précipite au centre commercial et parvient à éviter la catastrophe ; il les sauve.
L’homme au chapeau de cow-boy qui a dû changer de place sur les gradins est blessé à l’hôpital : c’est le prochain sur la liste. Il se prend une baignoire pleine du plafond, laissée se remplir par un infirmier insouciant. Puis George, fataliste depuis l’accident de sa femme et de sa fille, se fait faucher par une ambulance. La mère de deux kids turbulents (qu’on laisse faire), a été remarquée par Nick parce qu’elle sortait de son sac des tampons hygiéniques féminins pour mettre dans les oreilles de ses fils, assourdis par le vacarme de la course. Il avait trouvé ça marrant ; la femme l’avait suivi lorsqu’il avait dit qu’il fallait sortir. Elle est aussi sur la liste – on ne sait pas ce qu’il est advenu des kids, qui devraient y être aussi. Elle périt en sortant de chez le coiffeur, où un ventilateur tombé du plafond a failli la décapiter, et après une chute de siège jamais réparé. C’est en fait le palet jeté par l’un des gamins sur la pelouse en face, pour viser un panneau, qui est éjecté par la tondeuse du beauf clopeur qui remplit sa machine sans faire attention, qui finit par l’éborgner à mort ; elle venait de dire à ses gamins qu’elle allait garder l’œil sur eux…
Deux semaines plus tard, c’est leur tour. Ils se rejoignent au café pour fêter leur avenir après avoir leurré la Mort. Nick s’aperçoit qu’un échafaudage est mal étayé et prévient, mais l’ouvrier (noir), fataliste, dit qu’on doit le réparer. De fait, il s’écroule, et un gros Truck massif est forcé à faire un écart pour l’éviter, éventrant la vitrine du café dans lequel les trois qui se croyaient sauvés sont écrabouillés. Les filles parlaient chiffons et achats, comme des têtes de linotte, tandis que Nick pensait que tout avait peut-être été prévu pour cet instant précis.

Humour noir, contraste entre la jeunesse éclatante et la perspective mortelle, fatalité biblique – ce film en particulier dans la série point les défaillances humaines. La bêtise, le laisser-aller, le ressentiment, l’insouciance, la frivolité, tuent plus sûrement que les bêtes machines. Celles-ci n’échappent aux humains que parce qu’ils les laissent faire. Ils oublient de serrer le frein, laissent un bidon d’huile ou d’essence ouvert en équilibre, font se côtoyer des explosifs avec un tas de sciure, négligent de ranger une paire de lunettes-loupes au soleil, ne font pas attention aux instructions du lavage automatique, ne réparent pas le banc du circuit, ni l’échafaudage, ni le siège du coiffeur…
On ne peut rien contre la Mort, qui surviendra, inéluctable pour tous les vivants ; on ne peut rien contre le destin, suite de hasards et de nécessité ; mais on peut agir en adulte responsable et faire attention. Ce n’est pas le cas des personnages qui périront écrabouillés, transpercés, cramés, happés, cloués, aspirés. Le moins bon mais le plus rentable des films de la série.
DVD Destination finale 4 (The Final Destination), David Richard Ellis, 2009, avec Bobby Campo, Shantel VanSanten, Mykelti Williamson, Nick Zano, Haley Webb, Metropolitan Film & Video 2010, 1h18, doublé anglais, français, €26,80, Blu-ray €13,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les films Destination finale précédents déjà chroniqués sur ce blog :
https://argoul.com/2024/12/01/destination-finale-de-james-wong/
https://argoul.com/2024/12/04/destination-finale-2-de-david-richard-ellis/
https://argoul.com/2025/02/23/destination-finale-3-de-james-wong/

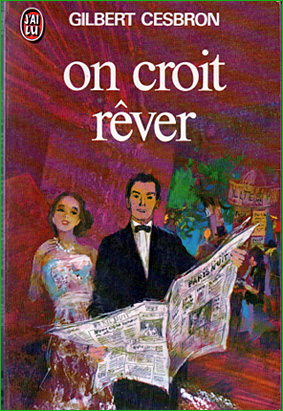
Commentaires récents